Question d'origine :
Bonjour, je cherche le titre d'un roman traitant d'un sujet délicat...comment un soldat allemand de la première guerre mondiale devient de plus en plus atroce et inhumain, au cours de la deuxième et après aussi..
Réponse du Guichet
Le 20/11/2020 à 14h45
Réponse du Département Langues et Littérature :
Bonjour,
En nous penchant sur votre question nous nous sommes rendu compte que parmi la masse de romans abordant les deux guerres mondiales, seule une minorité aborde la question du point de vue du soldat allemand, et encore moins d’ouvrages mettent en scène une déshumanisation progressive de celui-ci.
S’il est bien un auteur chez qui vous trouverez certainement votre bonheur c’est chez Erich Maria Remarque dont une grande partie de l’œuvre traite de la Première Guerre Mondiale. Dans trois romans en particulier, À l’Ouest rien de nouveau, Après et L'ennemi, il aborde la perte d’innocence du soldat, sa plongée dans l’horreur et sa difficulté à redevenir homme une fois la guerre passée.
Dans La mort est mon métier, Robert Merle met en scène Rudolf Höß, le commandant en charge du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz. Empruntant la forme de pseudo-mémoires, ce roman montre un homme incapable d’empathie ou de décision personnelle, chez lequel sentiments et remords semblent totalement absents. À la différence d’Erich Maria Remarque qui illustre une déchéance ou un appauvrissement en humanité chez certains soldats au fil des ans, chez Robert Merle, le personnage de Rudolf Höß semble présenter dès l’enfance certains traits psychopathiques.
Avec le personnage de Max Aue dans Les Bienveillantes, Jonathan Littell propose lui aussi une figure de soldat allemand dépourvu d’humanité. Dans ce roman, le protagoniste principal fait preuve d’un fanatisme tel qu’il est incapable de remettre en question les ordres auxquels il obéit ou ses propres actes. En outre, l’érosion de sa capacité à faire preuve d’empathie ne se borne pas chez lui à ses seuls actes militaires, mais viennent déborder sur ses relations familiales : il a deux enfants pour lesquels il ne ressent rien, et ira jusqu’à tuer sa propre mère ainsi que son beau-père.
Deux autres romans anglophones actuellement non traduits en langue française pourraient également correspondre à vos critères de recherches : We Germans d’Alexander Starrit qui traite de la culpabilité individuelle et s’interroge sur ce que ces soldats ont transmis aux générations suivantes, et A stranger to myself de Willy Peter Reese qui aborde de front la transformation progressive du narrateur au gré des atrocités qu’il perpètre et observe sur le front Russe.
Bonne lecture et bonne continuation dans vos recherches.
Bonjour,
En nous penchant sur votre question nous nous sommes rendu compte que parmi la masse de romans abordant les deux guerres mondiales, seule une minorité aborde la question du point de vue du soldat allemand, et encore moins d’ouvrages mettent en scène une déshumanisation progressive de celui-ci.
S’il est bien un auteur chez qui vous trouverez certainement votre bonheur c’est chez Erich Maria Remarque dont une grande partie de l’œuvre traite de la Première Guerre Mondiale. Dans trois romans en particulier, À l’Ouest rien de nouveau, Après et L'ennemi, il aborde la perte d’innocence du soldat, sa plongée dans l’horreur et sa difficulté à redevenir homme une fois la guerre passée.
Dans La mort est mon métier, Robert Merle met en scène Rudolf Höß, le commandant en charge du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz. Empruntant la forme de pseudo-mémoires, ce roman montre un homme incapable d’empathie ou de décision personnelle, chez lequel sentiments et remords semblent totalement absents. À la différence d’Erich Maria Remarque qui illustre une déchéance ou un appauvrissement en humanité chez certains soldats au fil des ans, chez Robert Merle, le personnage de Rudolf Höß semble présenter dès l’enfance certains traits psychopathiques.
Avec le personnage de Max Aue dans Les Bienveillantes, Jonathan Littell propose lui aussi une figure de soldat allemand dépourvu d’humanité. Dans ce roman, le protagoniste principal fait preuve d’un fanatisme tel qu’il est incapable de remettre en question les ordres auxquels il obéit ou ses propres actes. En outre, l’érosion de sa capacité à faire preuve d’empathie ne se borne pas chez lui à ses seuls actes militaires, mais viennent déborder sur ses relations familiales : il a deux enfants pour lesquels il ne ressent rien, et ira jusqu’à tuer sa propre mère ainsi que son beau-père.
Deux autres romans anglophones actuellement non traduits en langue française pourraient également correspondre à vos critères de recherches : We Germans d’Alexander Starrit qui traite de la culpabilité individuelle et s’interroge sur ce que ces soldats ont transmis aux générations suivantes, et A stranger to myself de Willy Peter Reese qui aborde de front la transformation progressive du narrateur au gré des atrocités qu’il perpètre et observe sur le front Russe.
Bonne lecture et bonne continuation dans vos recherches.
Réponse du Guichet
Le 23/11/2020 à 08h24
Bonjour
Nous avons bien reçu votre message précisant que vous avez retrouvé le titre du roman que vous recherchiez. Nous ajoutons la référence ici au cas où d'autres internautes seraient intéressés :
Le testament Aulick / Pierre Servent
Alexandre, professeur d'histoire, découvre chez un brocanteur le témoignage d'un Allemand emprisonné. Il fait appel à une collègue, Clara, pour traduire le manuscrit : il s'agit de la confession d'un ancien officier du IIIe Reich à la veille de son exécution, en 1946. Karl Aulick, soldat en 1914-1918 et lieutenant d'Hitler, décrit son parcours depuis Budapest. Premier roman.
Bonne journée.
Nous avons bien reçu votre message précisant que vous avez retrouvé le titre du roman que vous recherchiez. Nous ajoutons la référence ici au cas où d'autres internautes seraient intéressés :
Le testament Aulick / Pierre Servent
Alexandre, professeur d'histoire, découvre chez un brocanteur le témoignage d'un Allemand emprisonné. Il fait appel à une collègue, Clara, pour traduire le manuscrit : il s'agit de la confession d'un ancien officier du IIIe Reich à la veille de son exécution, en 1946. Karl Aulick, soldat en 1914-1918 et lieutenant d'Hitler, décrit son parcours depuis Budapest. Premier roman.
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



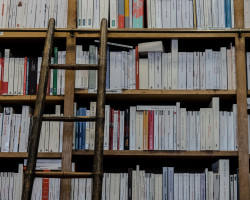
 Goupil ou Face
Goupil ou Face