Je recherche des informations sur les jugements de valeur
Question d'origine :
Est-ce que nos jugements de valeur révèlent nos valeurs? Que pouvez-vous me dire sur les jugements de valeur? Est-ce que tout le monde fait des jugements de valeur à un moment ou un autre? Est-ce que les jugements de valeur peuvent prendre plusieurs formes: par exemple si on critique une action de quelqu'un en disant 'ça ne se fait pas', n'est ce pas un jugement de valeur? À quoi servent les jugements de valeur, pourquoi en fait-on?
Réponse du Guichet
Le jugement de valeur désigne l'application d'une loi morale à un cas particulier pour en estimer la conformité ou la non conformité. Nous vous renvoyons vers les références citées dans nos précédentes réponses pour approfondir le sujet ainsi qu'à quelques ouvrages de philosophie et de sociologie.
Bonjour,
Nous avons déjà répondu à plusieurs de vos interrogations sur les valeurs et les jugements de valeur.
Nous vous recommandons vivement de les lire ainsi que les références mentionnées en leur sein.
En voici quelques exemples :
- Est-ce vrai que la science peut nous apporter des 'jugements de fait' ?
- Que pouvez-vous me dire sur le jugement ?
- Pourquoi est-ce que l'on confond souvent notre subjectivité personnelle avec la vérité ?
- Est-ce que notre comportement et nos valeurs sont subjectives ?
- Que veut dire "avoir des valeurs" ?
- Nos ressentis personnels rentrent-ils en conflit avec les valeurs la société ?
- Nos valeurs influent-elles sur la construction de notre ressenti ?
En complément, voici quelques titres que vous pourrez consulter à bon escient pour en savoir plus sur les jugements de valeur :
- Jugements de valeur et jugements de réalité / Durkheim, Emile (1858-1917) - chapitre IV, page 117, de l'ouvrage intitulé Sociologie et philosophie
- Rhétorique et éthique : du jugement de valeur / Roselyne Koren
- Des valeurs : une approche sociologique / Nathalie Heinich
- D'une éthique des valeurs au jugement de valeur / Michel Demaison
- Émotions et valeurs / Christine Tappolet
- Qu'est-ce qu'un jugement de valeur ?
et une définition extraite du dictionnaire intitulé Vocabulaire philosophique. 5 : Les mots de la morale de Yvan Elissalde et Jean-Michel Leder :
Jugement de valeur (pages 301-302)
Application d'une loi morale à un cas particulier pour en estimer la conformité ou la non conformité.
Le jugement de valeur est toujours comparatif, parce qu'il met en relation une généralité abstraite avec une particularité concrète. Dire "c'est bien" ou "c'est mal", c'est évaluer une chose à l'aulne d'une valeur. On distinguera donc, pour commencer, le jugement de valeur du jugement de connaissance, qui se contente de prédiquer un attribut à un sujet. "Le soleil brille" n'est pas un jugement de valeur ; "Le soleil est bon pour la vie" en est un. Encore faut-il que le jugement de valeur spécifiquement morale ne soit pas un jugement de valeur extramoral : les jugements sur l'utilité ("bon" et non pas "bien") ou sur le plaisir ("c'est bon", "c'est agréable" sont des évaluations étrangères à la moralité comme telle (Kant), parce qu'ils prennent pour principe des étalons non relatifs à la vertu. Même remarque avec les jugements esthétiques ("c'est beau", "c'est laid"), étrangers à l'éthique parce qu'ils sont d'une part sensibles (alors que les jugements moraux sont en partie rationnels), d'autre part n'évaluent pas la moralité des choses jugées mais leurs effets subjectifs. Enfin, le jugement de valeur n'est pas non plus un jugement juridique (sauf conclusion à la fois usuelle, funeste et sotte), lequel prend pour principe non une loi morale mais une loi politique : un juge ne dit pas ce qui est bien et mal mais ce qui est licite et illicite ; il ne condamne pas des fautes ou des vices mais des délits, des infractions ou des crimes. [...]
En philosophie, le jugement de valeur est strictement subordonné à l’élucidation de l'essence ou du sens de la chose jugée, car il serait sot de se demander ce que vaut une chose sans avoir d'abord établi ce qu'elle est (Platon). Tant que le débutant ne s'en est pas persuadé, se contentant d'évaluer machinalement toute chose au lieu de définir les concepts, il ne peut espérer entrer en philosophie. On distinguera donc en outre le jugement moral du jugement logique, distinction décisive. Une fois la notion élucidée, le philosophe peut se permettre de juger la valeur des choses particulières (par exemple, que la rhétorique est une chose mauvaise)., non sans s'être au préalable interrogé sur la loi dont il se sert pour évaluer. Autrement dit, la connaissance de l'universel l'emporte sur celle du particulier (la rhétorique est mauvaise parce que la flatterie en général est mauvaise - Platon encore). Cela revient, de proche en proche, à remonter jusqu'au souverain bien qui donne son sens aux diverses lois constitutives de l'éthique du philosophe (la flatterie est mauvaise parce que faire plaisir n'est pas faire le bien, le quel est à rechercher du côté de l'intelligence et non de la sensation - Platon toujours). Le débutant qui a le souci de ne plus porter de jugement de valeur aveugle doit donc commencer par se demander ce qu'est pour lui le bien, et spécialement ce que veut dire bien.
Valeur (page 307 et suivantes)
1. Qualité de ce qu'on juge être bon, dès lors posé comme désirable.
2. La valeur est le résultat d'un acte d'évaluation nommé jugement (de valeur précisément), la valeur n'existant pas indépendamment de lui, a priori, mais relativement à lui, a posteriori. Le jugement de valeur est qualitatif et non quantitatif : il ne s'agit pas de mesurer une grandeur mais une propriété invisible transcendant l'espace-temps, étant entendu que ladite propriété n'appartient pas en soi à la chose évaluée mais lui est subjectivement attribuée par l'esprit. La mesure de la qualité, comme toute mesure, implique une référence servant d'étalon. Or, la valeur d'une chose est mesurée à partir d'un étalon lui-même considéré comme une valeur. La notion se dédouble donc valeur comme principe du jugement et valeur comme résultat du jugement. La valeur-principe est fondement du jugement, mais abstraite (comme une loi générale), tandis que la valeur-résultat est dérivée du jugement, mais concrète (comme application de la loi à un cas particulier). Par exemple, la valeur Beauté et cette œuvre d'art jugée belle, la valeur Plaisir et ce vin jugé bon, la valeur Justice et cet homme jugé juste, etc. Le jugement de valeur qui part d'une valeur étalon pour effectuer son évaluation particulière n'est pas à vocation contemplative ou théorique : il règle l'action et la production, dans la mesure où ses évaluations vont susciter le désir, c'est-à-dire la force mobilisatrice des conduites humaines. C'est pourquoi le valable s'identifie d'abord au désirable sinon en fait du moins en droit.
[...]
Nous vous laissons poursuivre la lecture de ces définitions dans nos rayons.
Bonne journée.



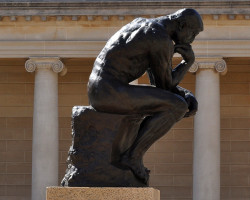
 Estime de soi et fin du monde
Estime de soi et fin du monde