Quel est le rapport entre E. Keller et les marchés de Lyon en 1873 ?
Question d'origine :
Bonjour,
Quel est le rapport entre E. Keller et les marchés de Lyon en 1873 (trouvé dans wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Keller ) ?
Cela-a-t-il à voir avec le marché de la Martinière (http://francmachon.com/les-halles-de-la-martiniere-le-plus-vieux-marche-couvert-de-lyon/), celui des Cordeliers, sous des halles à fermes Polonceau?
Merci.
Réponse du Guichet
Les discours de Keller concernent vraisemblablement la Commission des marchés et plus précisément le financement par les marchés publics de la guerre franco-prussienne à Lyon.
Il semble que la source de cette information concernant ces "marchés de Lyon" remonte au Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 (Adolphe Robert et Gaston Cougny). Wikipedia reprend en fait de large portion de la notice d'Emile Keller sur le site de l'Assemblée nationale, dans laquelle il est fait référence à cet ouvrage.
Keller a donc semble-t-il bien tenu un discours à l'Assemblée sur ce sujet. Idéalement, pour s'en assurer il faudrait se référer aux Discours et rapports à l'Assemblée nationale (1871-1875) d’Émile Keller. Malheureusement nous ne le possédons pas dans nos fonds, et d'après le catalogue universel worldcat.org l'ouvrage n'est localisé qu'à la BNF et dans les bibliothèques universitaires de Strasbourg BNU et Histoire.
Un exemplaire de ce Discours et rapports à l'Assemblée nationale (1871-1875), dédicacé par Émile Keller est également conservé aux archives municipales de Belfort.
Bien que référencé sur Google Books, son contenu n'a semble-t-il pas été numérisé, ou du moins demeure-t-il inaccessible même à une simple recherche plein texte (et a fortiori à la consultation).
En revanche nos recherches nous apprennent que d'autres députés, à l'instar de Keller, se sont illustrés sur ce sujet devant l'Assemblée, et dans leur cas, les comptes rendus qu'ils ont laissés nous sont facilement accessibles. Par exemple, Les Marchés de la guerre à Lyon et à l'armée de Garibaldi (1873) qui contient le rapport du comte Louis de Ségur et le discours du duc d'Audiffret-Pasquier est disponible sur GoogleBook en consultation libre. Louis de Ségur y est présenté comme rapporteur des marchés : on comprend dès lors que ce qui nous intéresse ici ne concerne par les "marchés" (alimentaires) Lyonnais, mais les marchés publics, et plus précisément ceux se rapportant aux dépenses de la guerre franco-prussienne de 1870, sujet, on le conçoit alors plus aisément, pouvant impliquer l'alsacien Émile Keller, qu'on avait déjà vu s'élever vigoureusement contre l'annexion à l'Allemagne de l'Alsace et de la Lorraine.
Ces dépenses municipales sont en outre effectuées dans un cadre bien particulier puisque le 4 septembre 1870, un Comité de Salut Public prend le contrôle de la ville de Lyon, avant d'imposer une série de mesures révolutionnaires qui traduisent l'inspiration socialiste d'un mouvement préfigurant la Commune parisienne à venir. On devine donc en filigrane de ces débats autour des financements de la guerre, une critique virulente des mouvements républicains plus ou moins radicaux - puisque finalement c'est le Docteur Hénon, plutôt modéré, qu'on retrouve à la tête du Conseil municipal après la Commune de septembre - , accusé d'incompétence politique et d'irresponsabilité. C'est donc un débat politicien qui se joue à l'Assemblée autour de ce sujet, et on peut comprendre les vagues qu'il soulève dans le Landerneau politique de l'époque. Quand à la position de Keller à ce propos, il faudrait se référer à ses Discours et rapports à l'Assemblée nationale (1871-1875) pour les connaître avec précision, mais il fait peu de doute que, de toute façon, l'enjeu ne relève pas du seul sort des finances de Lyon, mais qu'il s'agisse d'un débat de fond entre républicains et anti-républicains.
Dans son compte rendu, Louis de Ségur introduit le sujet :
Bien que la Commission des marchés ait surtout à présenter l'aspect financier des événements qui se sont passés à Lyon, il est indispensable, pour l'intelligence des marchés, de peindre rapidement la politique et l'administration qui ont dominé la ville pendant la guerre ; l'équité même exige que l'histoire locale soit connue, pour permettre de juger sainement les hommes et leurs actes. Sans cette histoire, on ne s'expliquerait que très difficilement les aventures financières dont nous avons à faire le récit. Quand on connaîtra, au contraire, les tendances politiques et administratives du parti qui a occupé le pouvoir, on ne s'étonnera pas des fruits qu'un tel arbre a portés.
Cette administration a dépensé pour la guerre près de trente millions en dehors de ce qu'a payé le ministère de la guerre : 14,532,513 fr. sont déjà au compte de l'État ; sur 14,544,945 fr. dépensés en outre par la ville, elle réclame à l'État près de 9 millions. Pour pouvoir apprécier cette réclamation et distinguer les dépenses, nous serons amenés à examiner toutes celles de la ville.
Suivent l'énumération détaillée des différentes dépenses de l'administration Lyonnaise dans le cadre du conflit opposant la France aux prussiens. Le député n'est pas tendre avec les choix de la municipalité :
Ainsi, Lyon avait dépensé des sommes énormes et se trouvait sur le point de subir un siége, avec une artillerie de campagne dont les pièces étaient chez les ajusteurs , les affûts chez les constructeurs, les projectiles encore en lingots, avec des fortifications qui étaient plutôt des abris que des remparts, et auraient été de bons travaux de champ de bataille pour des soldats aguerris.
Et finalement Louis de Ségur en vient à conclure :
La ville fut en état de banqueroute durant toute l'année 1871. Le 13 mai, le receveur municipal prévint le maire qu'il allait suspendre le payement des mandats ; quelques fonds rentrèrent à la suite de la vente des bestiaux, mais ces valeurs étaient le gage de la Banque de France, qui fit signifier une saisie-arrêt sur les fonds provenant de cette ressource. Malgré cette saisie-arrêt, les fonds furent dépensés [...]
En amenant une telle situation, avait-on du moins obtenu des résultats militaires ? De toutes les dépenses effectuées par la ville, on n'en voit pas une seule qui ait été utile à la guerre, directement ou indirectement. La seule qui n'ait pas été une pure perte, est celle qui fut faite pour approvisionnement, parce que la revente permit de rentrer dans une partie des déboursés : on a même vu ( chapitre IV ) que la ville aurait pu réaliser des bénéfices sur cette opération, si elle avait été dirigée avec autant d'intelligence que les achats. Mais tout le reste a été entièrement inutile. Simple satisfaction donnée à la pression populaire qui demandait des armements [..]
L'administration municipale a donc déjà grevé , depuis le 4 septembre 1870 , de 18 millions la dette de la ville. Le département, aussi maltraité dans ses finances que la ville, dut aussi contracter un emprunt [...]
La France épuisée se lasse enfin de tant de désastres, de déchirements et d'incapacités. Elle remet son sort aux mains de l'Assemblée nationale et lui confie la tâche de faire luire, après une longue période de deuil, des jours de réparation et d'espérance. L'avénement de son pouvoir fut accueilli à Lyon par des cris de rage. La démagogie , bien qu'elle n'ait pas désarmé de suite, s'est sentie blessée à mort. La Commune de Lyon, comme toutes les parties du territoire français, a été forcée de se soumettre à l'autorité et au contrôle de l'Assemblée. Les marchés du département du Rhône ont été l'objet d'une longue et laborieuse étude de la Commission des marchés. Il a été difficile de jeter quelque clarté dans ce chaos d'éléments confus [...]
A Lyon , l'État a payé 15 millions pour la guerre en dehors de ce qu'a dépensé le ministère de la guerre. La ville réclame encore à l'État 8 millions et 200,000 fr. sur la somme que lui a coûté la gestion de sa municipalité. Toutes les prétentions de la ville ne sont pas admissibles.



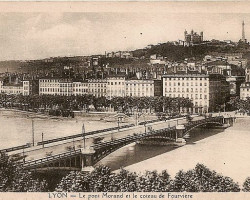
 Fauché à 18 ans, millionnaire à 23 : la méthode ultra...
Fauché à 18 ans, millionnaire à 23 : la méthode ultra...