Pourquoi les enlumineurs du Moyen-Âge incluent-ils beaucoup de dessins liés la sodomie ?
Question d'origine :
Bonjour,
J'aimerais savoir pourquoi les enlumineurs du Moyen-Âge incluent beaucoup de dessins liés la sodomie ou à des pratiques anales originales comme en témoigne le lien dans ce site Internet :
Merci beaucoup,
Réponse du Guichet
Nous n'avons que des pistes à vous suggérer, qu'il vous faudra approfondir, le sujet ayant été peu traité jusqu'à présent.
Bonjour,
Pour ce qui concerne votre sujet, l’état de la recherche est lacunaire et demeure encore à faire. Nous ne pourrons donc être affirmatives et nous nous contenterons de partager les réflexions et les possibles hypothèses. Nous nous attacherons dans un premier temps à la notion de « beaucoup ». Est-il certain que les scènes de sodomie ont été prépondérantes dans les enluminures ? Celles qui existent n’ont-elles pas attirés l’œil du contemporain qui les aurait alors abondamment relayées ?
A titre d’exemple, la bibliothèque municipale compte environ 500 manuscrits dont une centaine illuminée. Or sur cette centaine, seul un volume de droit canon comporte une représentation sexuelle, celle d’une femme chevauchant un sexe masculin.
Néanmoins, si elles semblent peu nombreuses, on s'interroge effectivement du pourquoi d’une représentation de la sodomie dans les enluminures ?
La réponse pourrait avoir trait avec les marginalia qui proposaient une plus grande liberté, les marges étant un prétexte pour représenter des sujets comme les scènes sexuelles dits repoussoirs. Les livres de moral pouvaient ainsi comporter des contre-modèles comme un exemple de choses à proscrire. Il en est de même des livres de droit canon comportant des descriptions de péchés.
Dans l’article Aux marges du manuscrit : les drôleries gothiques, entre satire et transgression, Benoît Durand défend cette thèse :
Entre le XIIIe et le XIVe siècle, de nombreux manuscrits médiévaux voient leurs marges être envahies par des représentations du quotidien. Inspirées de la vie courtoise de l’aristocratie, ces scènes revêtent souvent un caractère comique mais semblent aussi parfois sombrer dans l’obscène et le blasphématoire (…) ces images autoréférentielles, qui accompagnent le texte sans y faire référence, arrivent à trouver leur raison d’être dans une société de l’ordre et de la moralité à travers des logiques d’inversion, de modèle et de contre-modèle.
(…)
Certaines de ces productions peuvent encore aujourd’hui choquer l’observateur contemporain par leur caractère transgressif, voire obscène. C’est le cas des marginalia, ces enluminures placées dans les marges de certains manuscrits gothiques et dont la frivolité, frôlant parfois l’odieux, montre bien que les enlumineurs médiévaux n’étaient pas soumis à un contrôle dogmatique totalitaire dictant la production visuelle de l’Occident médiéval
(…) Les marges à drôleries se développèrent surtout à partir du 13e siècle en Angleterre. Dès 1250, le genre est bien connu et sera structuré par les ateliers parisiens
(…)
Au XIIIe siècle, lors de l’essor des ornements marginaux, le psautier est le livre de dévotion enluminé le plus fréquent, loin devant le bréviaire (peu utilisé par les laïcs) et le livre d’heures, qui finira par le supplanter à la fin du siècle. Le psautier est à l’époque le livre par excellence : souvent l’unique que l’on possède (…) ses marges se voient rapidement investies par les drôleries. Cette grande concentration de drôleries au sien de manuscrits de dévotion privée peut surprendre. En effet, on serait en droit de s’attendre à ce que des images marginales, voire « transgressives », ne puissent se retrouver à l’intérieur de livres dédiés à l’usage personnel des laïcs(…) les enlumineurs, répondant aux commandes des laïcs, n’étaient pas soumis à un contrôle de leur production et jouissaient d’une relative liberté dans les choix des images qu’ils créaient.
L’auteur poursuit en évoquant des drôleries à l’adresse du clergé comportant des représentations sexuelles et écrit à ce propos :
L’étonnement que nous entretenons encore à l’égard des drôleries découle de leur caractère tabou et subversif. C’est ce qui permet à ces images d’être efficaces : en franchissant une limite, en portant atteinte à l’ordre établi des choses, les drôleries permettent de questionner l’ordre social en créant dans celui-ci des inversions critiques. C’est cette même qualité qui nous permet d’attribuer à ces images encore aujourd’hui un caractère comique. Une blague fonctionne généralement sur les mêmes fondements : c’est le fait d’entrouvrir un interdit et de pousser la limite qui engendre le rire.
Rappelons-nous que les drôleries demeurent également le privilège exclusif de l’élite, cette même élite qui les commande et qui est la cible de leurs railleries. Ainsi pouvons-nous parler d’autodérision, qui, loin d’être anodine, joue un rôle de cohésion à l’intérieur d’une classe sociale : rire de ses défauts et de ceux de ses
semblables permet de se recentrer autour de valeurs communes.Il ne faut pas non plus croire que ce jeu et son fonctionnement ne soient complètement innocents. En faisant un tel usage de l’humour et de la satire, la norme est rappelée et la limite marginale (au sens social du terme) est identifiée. Si elle est franchie par ces images, s’il y a transgression, c’est afin de produire un contre-modèle, une image (dénonciatrice) des dysfonctionnements sociaux. Ainsi en produisant sa propre satire, en créant sa propre critique interne,
un corps social peut se protéger des atteintes externes. Tout ordre, afin d’assurer sa stabilité, doit admettre, permettre et intégrer le désordre. Le caractère parfois obscène du monde des marges à drôleries peut être perçu comme blasphématoire envers les textes sacrés qu’elles accompagnent, mais la juxtaposition d’idées visiblement contradictoires n’est plus transgressive si elle est soumise à une hiérarchie. Dans le cas des drôleries, cette hiérarchisation se traduit par les relations entre le centre et la périphérie. Alors que le
texte sacré demeure toujours central, les drôleries sont reléguées aux marges, qu’elles ne doivent pas quitter ni franchir.
Il ne faut pas voir dans ces relations une simple division positif/négatif mais plutôt un dialogue : le décor marginal, périphérique, demeure en relation avec le centre même s’il est en opposition avec lui. La page est donc soumise à une distinction spatiale des discours : alors que la norme et l’ordre règnent au centre, la marge devient, par opposition, toute désignée pour recevoir les représentations transgressives. Cette forte hiérarchisation des contenus rappelle le statut moral spécifique de ce qui transgresse et de ce qui est bon et juste. Ainsi la marge « participe à l’effort de clarification normative : désignant la transgression, elle la dénonce et, ce faisant, elle l’intègre dans un discours normatif globalisant »
Chloé Clovis Maillet, dans l'article « Apercevoir l’amour entre personnes de même genre au Moyen Âge » (Images Re-vues, 17 | 2020) s'appuie sur l'étude de Robert Mills pour expliquer :
Mills donne du sens à l’omniprésence difficilement explicable de la « phénoménologie de l’anus », dans les marginalia peuplées d’êtres ayant souvent un visage sur le derrière et se pénétrant avec diverses lances. Les images marginales des manuscrits longtemps interprétées par l’histoire de l’art comme des fantaisies dépourvues de sens, sont désormais perçues comme des images sociales, les marges des images se mettant au diapason des marges du monde, et en présentant la face inversée, présente et absente
(…)
Mills insiste sur le fait que l’anus est présenté dans les images comme un signe de pouvoir plutôt que de vulnérabilité, une manière d’interagir avec le monde, potentiellement grotesque, mais jamais faible.
Pour approfondir la question, nous vous suggérons la lecture de l’ouvrage Robert Mills, Seeing Sodomy in the Middle Ages (2015) qui est en partie reproduite et donc consultable en ligne ainsi que de Les marges à drôleries dans les manuscrits gothiques (1250-1350).
La question est également abordée dans les études portant sur la condamnation de l’homosexualité. Ainsi, Françoise Biotti-Mache dans « La condamnation à mort de l’homosexualité. De quelques rappels historiques », Études sur la mort, 2015/1 (n° 147), p. 67-93) mentionne :
En dehors des misérables jetés aux flammes, le Moyen Age nous a laissé des traces très explicites, dans l’art, de l’homosexualité. Parfois dissimulées, subtilement distillées dans les miniatures, les enluminures des lettrines qui demandent des loupes pour être justement appréciées, les amours interdites s’étalent pourtant sur les murs des églises, partout dans le monde chrétien, dès que les enfers y sont représentés à la suite du Jugement dernier et, dans tous les maux que les damnés y pouvaient subir, il est bien rare de ne pas y voir une fellation ou une pénétration anale par quelque démon affreux. Cela effrayait-t-il vraiment les paroissiens ou cela leur donnait-il des idées, si effroyable qu’ait été le châtiment ? N’oublions pas que Dante Alighieri (1265-1321), dans sa sublime Divine Comédie, n’hésite pas à placer les sodomites dans le septième cercle de l’enfer qui n’en compte que neuf. Mais il est guidé par Virgile dont l’homosexualité n’est plus à démontrer.
Dans Hommes et femmes au Moyen âge : histoire du genre, XIIe-XVe siècle Didier Lett rappelle que dans les manuscrits médiévaux enluminés et sur les fresques, sont figurés des sodomites tel celui qui est embroché de l’anus à la bouche par un démon.
De même, Thierry Pastorello écrit en introduction de l’article « La sodomie masculine dans les pamphlets révolutionnaires », (Annales historiques de la Révolution française, 2010/3 (n° 361), p. 91-130) :
Une longue tradition française de pamphlets et autres écrits satiriques témoigne du recours au sexe comme arme de critique et de caricature, depuis l’érotisme goliardique au XIIIe siècle (qui exprime dans des termes crus l’obsession sexuelle du passage à l’acte), en passant par les poésies libres et satiriques au début du XVIIe siècle sans oublier les mazarinades qui sont d’une particulière crudité.
Nous avons été intriguées par la notion, évoquée ci-dessus, d’érotisme goliardique et voici ce que nous trouvons dans Farceurs, polissons et paillards au Moyen Age :
Les plus drôle de ces vagants, de ces chantres des rues et des tavernes ; peut-être 400 connus ou anonymes ; sont des goliards, de goliaths, gouliars ou géants païens ; ou de gojlan qui, chez les Germains, désigne celui qui crie et qui chante des incantations (.. ;) ce sont des experts en dérision, grands amateurs de grivoiseries, de miroirs sans concession sur la vraie nature humaine. On les accuse volontiers de ridiculiser la morale, de rire de tout, aussi bien des tabous sexuels que des descriptions de l’enfer et des sermons des prédicateurs.
En rapport avec ces « goliards », nous nous sommes tournées vers les fabliaux. Dans Sexe et amour au Moyen Age, Bernard Ribémont évoque :
Au XIIIe siècle apparaît un nouveau genre de littérature, qui s’inscrit dans le développement d’une culture urbaine intégrant en particulier de nouvelles formes de dérision, à travers l’auto-ironie : il s’agit des fabliaux, pièces en vers, en général courtes. ( de l’ordre de 2-300 vers) visant à amuser ..
Mais l’auteur précise que les œuvres érotiques « forment une petite part de la production fabliesque et que le fabliau n’est pas un lieu de transgression », ne mentionnant « jamais de pratiques considérées alors comme contre nature : fellation, sodomie ».
Même si le site de l’université de Rennes publie un article sur « si me too avait existé au moyen age, qu’aurait-fait les textes médiévaux dans lequel il est indiqué :
Il existe de la littérature libertine à toutes les époques, et la société médiévale était à la fois plus répressive et plus libérale que la nôtre, les fabliaux étaient notamment très largement copiés et diffusés. Et le roman de chevalerie, que l’on considère souvent à l’opposé, comme idéalisant l’amour et les femmes, comporte souvent, si l’on regarde de plus près, une lecture à double sens avec des représentations sexuelles latentes, métaphorisées. C’est une époque où la religion imprégnait les comportements, il existait une morale sexuelle - et en même temps, on retrouve de nombreuses images explicites de sexe masculins et féminins ou de personnages grivois dans les marges des manuscrits, même quand cela n’a pas de rapport avec ce qui est copié, alors qu’il s’agit d’objets précieux, très couteux.
Il vous faudra donc suivre toutes ces pistes et approfondir la question en multipliant les entrées. Nous ne pouvons que vous suggérer :
Anthologie de la littérature érotique du Moyen Age
L’art de l’amour au Moyen Age. Objets et sujets du désir
Bonnes recherches.



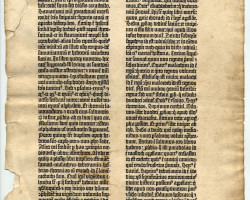
 Méditerranée
Méditerranée