Avons-nous été trop vite séduit par les théories anthropomorphiques ?
Question d'origine :
Bonjour,
Suite à cet article du Monde : Controverse sur la communication souterraine entre les arbres (lemonde.fr) j'ai repensé à une de mes précédentes question datée du 15.11.2013 "Les arbres parlent aux arbres" .
J'ai aussi consluté le compte X-Twitter de Justine Karst Justine Karst (@karst_justine) / X (twitter.com) qui bat en brèche beaucoup d'idées reçues et sans fondement scientifique sur la communication entre les arbres.
Nous avons trop vite, semble-t-il, été séduits par des théories anthropomorphiques avec notamment le livre de Peter Wohlleben : "La vie secrète des arbres" vendu à plus d'un million d'exemplaires, à votre avis ?
Merci pour votre travail .
Réponse du Guichet
Les débats rentrent dans le champ normal de la controverse scientifique. Ils permettent de faire avancer et évoluer les connaissances.
Bonjour,
L'idée de considérer les arbres comme des êtres vivants doués de certaines caractéristiques anthropomorphiques a gagné en popularité ces dernières années, en partie grâce à des ouvrages tels que "La Vie Secrète des Arbres" de Peter Wohlleben. Ces théories anthropomorphiques suggèrent que les arbres ont une forme de communication, de coopération et de conscience. Certain.e.s scientifiques soulignent que l'utilisation de termes anthropomorphiques pour décrire le comportement des arbres peut être trompeuse. Les processus biologiques des arbres sont souvent le résultat de mécanismes évolutifs adaptatifs qui diffèrent considérablement de ceux des êtres humains. Si la vie des arbres est fascinante, il est essentiel de rester fidèle aux principes scientifiques lors de la discussion de ces sujets.
Ainsi votre question rentre dans le champ habituel de la recherche scientifique que l’on nomme «Controverse», ce qui n’est pas nouveau et parcourt toute l’histoire des sciences. On en connait depuis l’antiquité, comme en débattent fort bien les participant.e.s de la table ronde qui s’est tenue au festival «l’histoire à venir» à Toulouse ayant pour thématique: «Faut-il avoir peur des controverses scientifiques? Le progrès mis à l’épreuve»
Ces débats jouent un rôle crucial dans le processus d'avancement des connaissances. Si la recherche scientifique vise à produire des résultats fiables et stabilisés selon un processus connu, décrit par le site «papier mâché» :
1. Importance des conditions témoins
2. Répétabilité et reproductibilité
3. Modèles d’études et modèles animaux
4. Incertitudes de mesures
5. Statistiques, hypothèses et seuil de significativité
la nature complexe du monde et des phénomènes étudiés, peut conduire à des interprétations divergentes, à des opinions divergentes et à des débats entre les chercheur.euse.s. Ce que est assez sain, comme l’explique Léo Coutellec dans son intervention expliquant la recherche en action lors de la crise du Covid !
Voici quelques-uns des intérêts de la controverse dans la recherche scientifique :
- Révision par les pairs permet une évaluation critique des travaux scientifiques par d'autres experts du domaine. Cela implique souvent des débats et des discussions sur la validité des méthodes, l'interprétation des résultats et la pertinence des conclusions.
- Remise en question des idées préconçues peuvent remettre en question des idées établies et encourager les chercheur.euse.s à remettre en cause leurs propres hypothèses. Cela favorise un environnement intellectuel où les idées nouvelles et innovantes peuvent émerger.
- Amélioration de la méthodologie : les débats qui surgissent peuvent inciter les chercheur.euse.s à améliorer leurs méthodologies expérimentales, à affiner leurs protocoles et à renforcer la robustesse de leurs travaux.
- Identification des lacunes dans la connaissance : Les divergences d'opinions et les débats mettent souvent en lumière des lacunes dans la compréhension actuelle d'un sujet. Ces lacunes peuvent stimuler de nouvelles recherches visant à combler ces manques.
- Évolution des théories scientifiques en favorisant des ajustements ou des révisions basés sur des preuves et des arguments contradictoires.
- Engagement du public : en attirant l'attention du grand public sur des questions importantes, en suscitant ainsi l'intérêt et l'engagement de la société dans les développements scientifiques.
- Formation intellectuelle : en exposant les chercheur.euse.s à une diversité d'opinions et en les encourageant à développer des compétences critiques.
Ainsi, une controverse peut se terminer de diverses manières :
Selon Tom Beauchamp(en), les controverses scientifiques peuvent se distinguer par leur mode de résolution, qu'il appelle clôture ou closure en anglais12:
- argumentation validée: une position reconnue correcte et son opposition est rendue incorrecte;
- consensus: une position majoritaire d'experts est dite meilleure et son opposition parait incorrecte;
- procédure: par consensus formalisé pour mettre un terme à la controverse;
- mort naturelle: la controverse disparait d'elle-même (absence de pertinence, perte d'intérêt...);
- négociation: l'ensemble des acteurs de la controverse s'accordent pour trouver une solution acceptable par et pour tous.
Ernan McMullin(en)propose une classification en trois types12:
- résolution: quand un accord est atteint selon les critères scientifiques standards;
- clôture: quand la controverse se termine par argument d'autorité, voire par empêchement ou contrainte;
- abandon: quand la controverse n'a plus d'acteurs qui s'y intéressent.
Pour un.e personne curieuse, le livre scolaire propose une méthode pour se forger un avis lors d'une controverse scientifique :
-
- Caractériser le type de controverse. Est-elle scientifique - basée sur des faits - ou idéologique - reposant sur les croyances - ? Une controverse scientifique doit être tranchée de manière rationnelle, les croyances n'ont pas leur place au sein des débats, ceux-ci devant se limiter aux données scientifiques. Les controverses éthiques, quant à elles, se basent sur la définition par chaque groupe d'individus de ce qui est acceptable ou non.
- Faire un tri entre les différentes informations. Séparer les informations objectives et neutres des informations plus subjectives. Les débats peuvent être alimentés de données dont la fiabilité peut être très inégale. Il est donc important d'avoir un regard critique sur ces données.
- Lister les tenants et les aboutissants. Prendre position passe nécessairement par une vision la plus globale possible du problème énoncé. La réponse à une controverse scientifique peut amener à de grandes modifications dans le domaine des sciences, ou encore à l'ouverture de controverses dans des domaines sociétaux connexes.
- Se méfier des idées simples et évidentes. L'explication d'un phénomène est parfois plus complexe qu'elle n'en a l'air. Par exemple, dès qu'il fait froid en été, on pourrait être tenté de remettre en cause le réchauffement climatique. Pourtant, une analyse plus poussée permet de différencier climat et météo.
Il est important de noter que la controverse n'est pas toujours négative. Elle fait partie intégrante du processus scientifique qui, au fil du temps, contribue à la construction d'une compréhension plus solide et plus nuancée du monde qui nous entoure. Cependant, il est essentiel que les débats restent constructifs et soient guidés par des preuves et la rigueur scientifique, comme le soulignait Bruno Latour dans un article de «Sciences et Avenir».
Entement votre,
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter dans nos collections:
Quand les scientifiques se trompent de Jean Baudet et d’autres titres sur le même sujet.



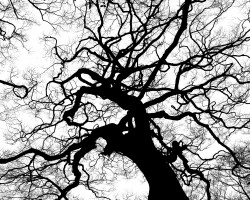
 Les origines du sacré : penser la nature
Les origines du sacré : penser la nature