Comment interpréter "aller tête nue" chez T. Mann d'un point de vue socio-culturel ?
Question d'origine :
Dans la Montagne magique de Thomas Mann, le narrateur insiste beaucoup sur le fait que les pensionnaires du sanatorium ne portent pas de chapteau, qu'ils vont "tête nue". Cela revient vraiment à plusieurs reprises au début, puis à la fin. Je me demandais comment l'interpréter d'un point de vue historique, social et culturel.
Merci !
Réponse du Guichet
Affranchis des convenances de la vie courante, les pensionnaires du Berghof, le sanatorium de la Montagne magique se démarquent en allant par les chemins sans chapeau. Une audace que le personnage central du roman, Hans Castorp, adoptera finalement.
Bonjour,
C'est lors d'un séjour à Davos, en Suisse, en 1911, avec sa femme qui était en traitement au sanatorium, que Thomas Mann (1875-1955) commença à écrire La montagne magique. Le roman est publié en 1924, et traduit en français en 1931.
Hans Castorp, jeune homme bourgeois, se rend pour quelques jours auprès de son cousin Joachim, en traitement dans un sanatorium de Davos. Mais une fois soumis à l'atmosphère envoûtante du lieu, Castorp se sent ou se croit lui-même malade et va demeurer là durant sept années : jusqu'au moment où la guerre de 1914, le tirant de son rêve, le conduit brutalement sur les champs de bataille. Source : Le nouveau dictionnaire des oeuvres.
En 1939, lors d’une conférence à Princeton, Thomas Mann définissait son roman comme un « document de l’état d’esprit et de la problématique spirituelle de l’Europe dans le premier quart du 20e siècle ». Un document qui contient des développements sur la notion de durée, sur la mort, la culture, et qui jette un éclairage sur les mentalités qui allaient affronter le carnage de la guerre.
Plusieurs passages du roman mentionnent effectivement que les protagonistes sortent sans chapeau, et ce dès le début du roman lorsque que Hans Castorp aperçoit son ami sur le quai de la gare :
Et, comme il regardait par la portière, il vit Joachim en personne sur le quai, en raglan brun, sans chapeau, avec un air de santé qu’il ne lui avait jamais connu de sa vie.
Hans Castorp est d'un milieu bourgeois, il a reçu une éducation faites de codes de conduite et de présentation. Le port du chapeau, à la fin du 19e siècle et au début du 20ème, fait partie intégrante de la tenue vestimentaire correcte et complète pour sortir. Il n'était en effet pas d'usage de sortir en cheveux. Aussi est-il étonné de voir son ami tête nue. L'expression s'emploie sous la forme figée nu-tête, attestée par le Dictionnaire culturel en langue française.
Cela lui pose d'ailleurs un problème de politesse puisqu'il est d'usage de saluer par un geste (différent selon la personne rencontrée) vers ou avec son chapeau.
– Voilà. Je me demande donc comment je dois me conduire en cette circonstance. Je n’avais pas de chapeau sur la tête que j’aurais pu enlever.
– Tu vois bien, l’interrompit encore rapidement Hans Castorp, tu vois bien qu’il faut porter un chapeau. Ça m’a naturellement frappé que vous n’en portiez pas, ici. Mais il faut en porter un, pour qu’on puisse l’enlever dans les circonstances où il sied de se découvrir.
Cet autre extrait souligne également l'embarras du personnage dans le respect des usages de politesse en l'absence de couvre-chef :
Pour les deux visiteurs mâles, c’eût été sans doute une occasion de se découvrir s’ils avaient eu des chapeaux, mais ils étaient tête nue, Hans Castorp, lui aussi l’était, et ils se bornèrent donc à marcher en une attitude respectueuse [...]
Au début Castorp résiste en quelque sorte, ce monde du sanatorium n'est pas le sien, il n'est là qu'en visiteur, et refuse de se conduire comme les "gens d'en haut" :
après que Hans Castorp se fut assuré qu’il avait sur lui de quoi fumer, il prit canne, pardessus et chapeau – ce dernier en quelque sorte par défi, car il était trop sûr de son propre genre de vie et de ses usages de civilisé, pour se soumettre aussi légèrement et pour trois petites semaines à des habitudes nouvelles et étrangères – et ils s’en furent donc ainsi, descendirent les escaliers…
Puis au fil du roman, et du temps qui passe, Hans Castorp va apprendre les us et coutumes qui l’initieront à la vie du Berghof. Plus il s'intègre à ce "monde d'en haut" plus son chapeau semble l'encombrer :
Cette montée réjouit Hans Castorp, sa poitrine se dilata, de la poignée de sa canne il repoussa son chapeau en arrière, et lorsque, arrivé à une certaine hauteur et regardant en arrière, il aperçut au loin le miroir du lac auprès duquel il était passé en arrivant, il se mit à chanter.
L'abandon de son chapeau signe son appartenance au microcosme si particulier qui est celui du sanatorium :
Ils s’en furent donc, tête nue, – car depuis que Hans Castorp était « entré en religion », il s’était bon gré mal gré adapté à l’usage régnant de sortir sans chapeau, quelle que fût au début la fermeté avec laquelle il opposait, à cette coutume, ses habitudes d’homme bien élevé, – et ils s’aidaient de leurs cannes.
Après la guerre de 14-18, le port général et obligatoire du chapeau va tomber en désuétude. Les "gens d'en haut", pensionnaires du Berghof étaient en quelque sorte en avance sur leur temps.
Article Hans Castorp et l’attirance pour le microcosme des « gens d’en haut » – une forme de snobisme ?
Bonne journée,



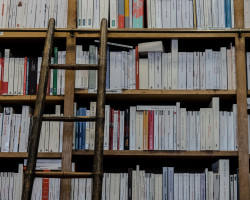
 Le boom des retraductions
Le boom des retraductions