Comment était encadrée juridiquement la prostitution à la Belle époque ?
Question d'origine :
Bonjour précieux et dévoué GdS.
Une question un peu générale cette fois sur les mœurs et les lois pendant la Belle Époque.
Cette période a été marquée semble t il par des mœurs plutôt légères et une pratique assez large de la prostitution. Pourrais tu, avec ta sagacité et ta précision habituelles, documenter ces pratiques et les évolutions règlementaires, législatives et institutionnelles qui ont visé à les "encadrer"? Par exemple: une lithographie de Steinlen représente un bal et, au milieu de tous les couples dansant, se tient ce gendarme en pleine attention, les bras croisés derrière son dos…Toulouse Lautrec a également fait une lithographie “Une Redoute à Montmartre” ou l’on voit des acteurs/actrices se déambuler dans les rues de Montmartre à moitié nus. Ceci en 1893. Et puis bien sûr il y a eu en 1908 une loi sur la prostitution des mineurs faisant suite au travail d'une Commission. Le détail de cette loi serait intéressant. La question aussi est de savoir si elle se limitait seulement aux mineurs ou bien concernait plus largement la prostitution. Et bien entendu quelles évolutions ont concerné la "Police des Mœurs" et le fonctionnement des "maisons closes" pendant cette période.
Je sais pouvoir compter sur ta clairvoyance et ta pugnacité pour éclairer cet aspect particulier, partie intégrante de la Belle Époque. Avec tous mes encouragements et, par avance tous mes remerciements chaleureux pour une recherche fructueuse et riche.
Bien cordialement.
Bien le bonjour et mille merci à toute l'équipe valeureuse du GdS.
Bien à vous.
iannaki
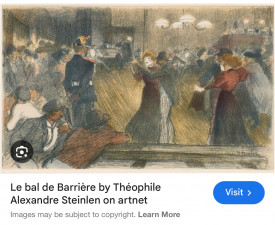
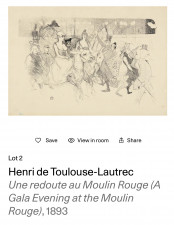
Réponse du Guichet
La prostitution à la Belle Époque : "un mal nécessaire" encadré pour des raisons d'hygiène, mais une manne financière pour les communes...
Bonjour,
En préambule, voici ce que nous dit le Dictionnaire de curiosités de Jacqueline Lalouette sur les maisons closes à la Belle Époque (La France de la Belle Époque):
« Pour les maisons de tolérance, la Belle Époque correspond à une période de «néoréglementarisme», caractérisée par le contrôle sanitaire des prostituées et l’enfermement de celles qui étaient atteintes d’une maladie vénérienne. Les filles devaient toutes être inscrites sur un registre ad hoc et posséder une carte sanitaire délivrée par le service des mœurs compétent, faute de quoi elles étaient considérées comme des «insoumises». Certaines étaient isolées. D’autres vivaient dans des maisons closes avec l’accord des autorités municipales, qui y trouvaient un intérêt financier ; ces établissements étaient considérés comme un «mal nécessaire», y compris «par plusieurs moralistes et même par certains membres du clergé», écrivit Victor Marchand, maire de Dijon en 1892. […] Dans chaque commune, un règlement, très strict, se rapportait à la prostitution. Celui de Dijon, établi en 1888, comprenait soixante-seize articles répartis en quatre titres : «Des femmes publiques», «Des maisons de tolérance», «Service de santé», «Des filles isolées». […] L’arrivée d’une pensionnaire devait être signalée le jour même au commissariat de police par la maîtresse de maison, qui devait prouver que la nouvelle venue était «reconnue saine» ; la tenancière devait aussi déclarer chaque départ. La municipalité fixait, pour chaque maison, le nombre de femmes publiques admises à y travailler. Chaque lundi, elles étaient «visitées à domicile» par un docteur du service de santé, qui recevait un franc, la même somme étant versée au receveur municipal. En outre, pour chaque visite ordinaire, à laquelle il n’assistait pas, l’agent de police «préposé à la surveillance des mœurs» percevait deux francs également destinés à la caisse municipale. […] ».
Michel Winock, historien contemporanéiste, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur cette période, en particulier La Belle Époque, dans lequel il évoque la prostitution : « considérée comme un système d’échanges entre les classes urbaines. […] La prostitution revêt plusieurs formes et ne se réduit pas à la maison close ou maison de tolérance. Son existence, dans toutes les villes de France, est tout de même un fait social qu’on en peut négliger. On peut dire d’une façon générale, que les autorités politiques, médicales, hygiénistes, policières, s’accordent avec l’opinion courante pour défendre la maison close […] La maison close satisfait à la fois le commerce des filles, leur surveillance et la volonté des hygiénistes de l’administration. Car si la prostitution est un mal nécessaire, encore faut-il qu’il soit enfermé et occulté. Le phénomène a aussi une utilité morale : il protège, par son existence même, les femmes et les filles des honnêtes gens.»
En introduction de l’ouvrage L’imaginaire de la prostitution, les auteurs nous expliquent que « […] la prostitution n’est ni interdite ni autorisée, mais simplement tolérée. Les règlements se succèdent sans que les administrateurs ne parviennent à une option claire entre les pratiques de la police et l’état de droit. Dans les premières années du XXème siècle, le préfet de Paris Louis Lépine observe que le délit de «racolage» ne procède en rien de la loi mais d’une «tradition administrative» consacrée par un long usage. Il faudra que les abolitionnistes (qui militent pour l’abolition de tout contrôle) puis les suffragettes mènent d’ardents combats et que des rumeurs relayées par la presse à scandales évoquent la «traite des Blanches» pour qu’on parle d’esclavage. Mais les règlementations, le plus souvent sans effet, sont une chose ; autre chose que l’opinion se fait des filles publiques.»
Nous vous conseillons tout particulièrement la lecture de l’ouvrage précité, tant il est riche de différentes approches. Un chapitre intitulé Points de vue savants et autorisés (sur la prostitution), recense tout à la fois des écrits médicaux, de policiers, de personnalités ou de clients comme Octave Mirbeau. Des écrits qui semblent plus vouloir lutter contre l’avancée de la syphilis (pour les hygiénistes), stigmatiser et pointer du doigt les parfaites suspectes que sont potentiellement toutes les femmes (pour les policiers), plutôt que de réfléchir aux questions morales ou juridiques soutendant la prostitution.
L’ouvrage dédié à la Police parisienne (La police à Paris en 1900) relate de multiples rafles opérées par les agents de la paix, police des mœurs et autre brigade mobile. 1/3 des personnes interpellées sont des femmes, et un certain nombre des prostituées. Mais comme le dit l’ouvrage « la tâche de la police est essentiellement psychologique : après ses interventions, mendiants, prostituées et vagabonds changent de quartier, la population «honnête» est rassurée, mais à moins d’utiliser des solutions extrêmes proposées par quelques eugénistes telles que la déportation voire l’enrôlement dans les colonies, la solution ne se trouve pas dans la répression, elle ne peut être qu’économique et sociale.»
Sur la question des « bonnes mœurs » :
Le concept de Bonnes mœurs et la notion d'outrage aux Bonnes mœurs ont bien sur évolué, et cette notion a disparu du code pénal en 1994. Une synthèse de Jean-Noël Jeanneney 1881: quand la IIIe République instaure un droit au blasphème aborde le sujet dans un sous-chapitre « Du respect des Bonnes mœurs ». En voici un extrait : « Précisons - et cet aspect des choses a pris plus de rides - que pour nos ancêtres de 1881, l'accord sur la punition des atteintes aux "bonnes mœurs"fut unanime et que chaque orateur prit grand soin de préciser que jamais, au grand jamais, il ne défendrait des citoyens faisant profession et profit de diffuser des images ou des écrits "licencieux". Au Sénat, un échange vif porta sur la question des dessins, gravures, emblèmes "obscènes". Alors que les "outrages aux bonnes mœurs"étaient déférés au jury des cours d'assise, on décida par exception (articles 27 et 43) que l'exposition de ces images serait "correctionnalisée" afin de rendre la répression à la fois plus sévère et plus facile.
La définition même des frontières de l'obscénité ne fut pas abordée, en dépit de l'intervention d'un sénateur de droite monarchiste, l'ancien procureur Henri de Gavardie, qui demanda ironiquement que l'on s'expliquât, chose ardue, sur ce terme de "bonnes mœurs". Elles "n'étaient pas dans l'Antiquité ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles ne sont pas dans les pays chrétiens ce qu'elles sont dans les autres pays. Vous aurez donc l'arbitraire à craindre quand il s'agira d'appliquer votre article." Mais les bons bourgeois qui entouraient ces propos dans l'Hémicycle jugèrent visiblement que la définition pouvait demeurer implicite et le président de la commission, Robert de Massy, se contenta de renvoyer un peu dédaigneusement l'orateur - pourtant assez lucide à nos yeux - à l'article 287 du Code pénal, qui utilisait l'expression sans plus de précision, comme portant une évidence. Observons que cette expression a disparu depuis 1994, le code ne réprimant plus que des "messages pornographiques", notion plus étroite. »
Dans l'ouvrage Les lois Veil, vous trouverez une longue introduction sur l’histoire des lois répressives en France. On y lit que « Les moralistes concentrent leurs efforts dès les débuts de la IIIème République contre l’obscénité et la pornographie. Ils sollicitent l’État pour promouvoir la moralité publique par des mesures coercitives. […] Tous, hommes et femmes de progrès ou conservateurs, se situent sur le terrain de la morale et se montrent obnubilés par les «mauvaises mœurs» comme cause première du désordre public et des «fléaux sociaux». […] L’obsession des bonnes mœurs recouvre la question sociale, du moins pour ce qui relève des rapports de genre et de sexualité. […] C’est vers l’État, garant de l’ordre public, que les différentes ligues se tournent pour réclamer une répression plus forte car, en effet, les magistrats ont souvent jugé que ces publications (affiches, cartes postales, romans légers et productions érotiques) ne rentraient pas sous le coup de la loi du 2 août 1882 sur l’outrage aux bonnes mœurs.»
Mais c’est dans l’ouvrage Tous républicains ! que vous trouverez le plus de renseignements sur cette question morale / juridique des bonnes mœurs. Le chapitre rédigé par Anne Simonin L’indignité ou les bonnes mœurs républicaines fait un très bon tour d’horizon, à la fois historique et juridique de cette question. Voici un court extrait : « Les bonnes mœurs marchent dans la jurisprudence main dans la main avec l’indignité qui assure leur protection juridique. Sur le temps long, on s’aperçoit que tous les législateurs républicains ont eu recours à l’indignité. Et ce pour préserve bien davantage les bonnes mœurs politiques que les bonnes mœurs sexuelles ». Cet ouvrage est, comme ceux cités précédemment, disponible à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Sur la question de la prostitution des mineurs et la loi de protection du 11 avril 1908, nous vous proposons un excellent article en pièce jointe à notre réponse La prostitution des mineurs dans le débat républicain à la Belle Époque, L’expertise juridique et l’échec d’une politique, Pascale Quincy-Lefebvre dans Histoire Politique 2011/2 (n°14). Dans son préambule, il évoque la prostitution en général. « Le réglementarisme a défini un cadre d’intervention qui, à partir du second XIXème siècle, est au cœur de nombreuses polémiques. Le système a ses origines dans les pouvoirs confiés aux municipalités en 1789. Il se précise à partir des années 1830 pour survivre jusqu’au milieu du XXème siècle. Pendant cette période, la réglementation de la prostitution signifie que cette activité est soumise à l’administration du préfet de police à Paris, à l’administration des maires en province. Encore au début du XXème siècle, aucune règle ne précise un âge minimal pour l'inscription sur les registres sanitaires.» Voici le cadre qui préexiste à cette loi de 1908.
Ci-dessous des ouvrages pré-cités et d'autres sur ce sujet :
La Belle Époque :
- La véritable histoire de la Belle Époque, Dominique Kalifa, Paris, Fayard, 2017
- La France de la belle époque : 1896 -1914, Dominique Lejeune, Paris, A. Colin, 2011
- Les Français de la Belle Époque, Antoine Prost, Paris, Gallimard, 2019
Mœurs et valeurs sous la IIIème République :
- Tous républicains ! : origine et modernité des valeurs républicaines, Robert Belot, Paris, A. Colin, 2011
- L'Enfer de la IIIe République : censeurs et pornographes, 1881-1914, Annie Stora-Lamarre, Paris, Imago, 1989
- La police des mœurs sous la IIIe République, Jean-Marc Berlière, Paris, Seuil, 1992
Sur la prostitution :
- Mémoires de Casque d'or, Amélie Elie, illustrés par Damien Levetti, Bordeaux, Ed. l'Apprentie, 2022 (un texte paru initialement en 1902, et qui retrace le parcours d’une jeune orléanaise venue vivre dans ce Paris de la Belle Époque)
- La Vie quotidienne dans les maisons closes, 1830-1930, Laure Adler, Paris, Hachette, 1990
- L'imaginaire de la prostitution : de la Bohème à la Belle Époque, Mireille Dottin-Orisini, Daniel Grojnowski, Paris, Hermann, 2017
- Les politiques de la prostitution du Moyen-Age au XXIème siècle, Amélie Maugère, Paris, Dalloz, 2009 (ouvrage disponible dans de nombreuses bibliothèques universitaires)
Sur Paris :
- La police à Paris en 1900, Jean-Marc Berlière,Paris, Nouveau Monde Editions, 2023
- Montmartre du plaisir et du crime, Louis Chevalier, Paris, la Fabrique, 2016
En espérant que ces différentes pistes correspondront à votre recherche, nous vous souhaitons de bonnes lectures !




 Rapport sur l’état des services publics
Rapport sur l’état des services publics