Je recherche des livres de vulgarisation pour aborder des notions philosophiques
Question d'origine :
Bonjour.
Je recherche des livres de vulgarisation concernant les termes philosophiques " existence , être , substance , accidents , etant ,..." , pour lecteurs grand public ou débutant en philosophie. Pourriez m'indiquer quelques uns ( leur titre , auteur ) svp ? En vous remerciant .
Réponse du Guichet
Vous trouverez ci-dessous des références de vulgarisation (dictionnaires, encyclopédies, généralités) consultables à la BmL pour vous permettre d'accéder à la définition des grands concepts philosophiques de façon pédagogique et claire.
Nous complétons cette bibliographie papier par le site Web Philomag de la revue Philosophie Magazine qui comporte une rubrique Lexique très complète. Enfin, l'Encyclopédie Universalis en ligne vous permettra de croiser ces notions philosophiques avec d'autres champs d'investigation comme les sciences humaines, la linguistique, la sociologie, la psychanalyse, etc.
Bonjour,
Vous recherchez des livres de vulgarisation concernant des concepts philosophiques (existence, être, substance, accidents, étant...), pour lecteurs grand public ou débutants en philosophie.
Les concepts philosophiques sont les outils principaux en philosophie pour définir une question, distinguer les choses, formuler les problèmes. Bref, pour mettre la pensée en mouvement. Ce qui faisait dire à Gilles Deleuze que le philosophe est "un créateur de concepts". Quand il ne les invente pas et qu’il utilise les notions communes, comme le bonheur ou la liberté, la vérité ou le temps, la raison ou la technique, c’est pour leur donner une signification nouvelle qui vient s’ajouter aux sens dont il était jusque-là porteur. De sorte que chaque concept, en même temps qu’il nous permet de saisir le réel par la raison, est un concentré de l’histoire de la pensée qui contient en lui toutes les interrogations du passé. (Site Web Philosophie Magazine)
Selon la définition du Trésor de la langue française, vulgariser c'est "mettre à la portée des non-spécialistes des notions, des théories de différents domaines de savoir."
Parmi les documents de philosophie listés ci-dessous, et présents dans le catalogue BmL, vous trouverez donc des dictionnaires, des encyclopédies et des ouvrages de généralités accessibles à tous, tout en étant des outils de référence fiables et complets.
Dictionnaires de philosophie
Grand dictionnaire de la philosophie [Livre] / dir. Michel Blay, 2003
Dans une démarche pédagogique orientée vers les grands problèmes contemporains, ce dictionnaire propose 1500 entrées définissant les concepts et les notions de la philosophie ainsi que 70 dossiers consacrés aux grandes questions philosophiques.
Le dico de la philo [Livre] / Christophe Verselle, 2006
La série Mémo propose des ouvrages de référence inédits, complets et accessibles, pour apprendre, comprendre ou se perfectionner dans les grands domaines du savoir. Christophe Verselle, professeur de philosophie, propose un dictionnaire clair et accessible des principales notions et des thèses des plus grands penseurs, de Platon à Foucault.
Dictionnaire des concepts philosophiques [Livre] / sous la direction de Michel Blay, 2006
De " absolu " à " vrai ", de " bonheur " à " mal ", de " darwinisme " à " phénoménologie ", ce dictionnaire présente en près de 800 articles, les principaux courants, les notions et les doctrines de l'histoire de la philosophie. Un index des philosophes facilite l'accès à ce dictionnaire, conçu pour satisfaire les besoins des étudiants, enseignants et chercheurs mais répondre aussi à la curiosité de chacun.
Dictionnaire amoureux de la philosophie [Livre] / Luc Ferry ; dessins d'Alain Bouldouyre, 2018
Ce dictionnaire aborde de façon aussi limpide et profonde que possible les questions les plus cruciales qui touchent les trois grands axes de la philosophie : la sagesse, la vérité et l'éthique. Il relie toujours la présentation des grandes doctrines du passé aux interrogations essentielles du temps présent.
Vocabulaire de philosophie. 1 [Livre] : Les mots du sujet / Yvan Elissalde, 2017
Mot après mot, la philosophie se présente comme une langue particulière, d'autant plus déroutante qu'elle semble reprendre le vocabulaire de tout le monde, mais en lui donnant un sens qui n'appartient qu'à elle. Ce rapport ambigu de continuité et de rupture avec la langue commune expose à bien des malentendus, que le présent ouvrage voudrait faire éviter au débutant, en précisant le sens des notions essentielles par des définitions critiques et raisonnées.
Organisée en cinq domaines de notions au programme des concours et examens (le sujet, la culture, la raison et le réel, la morale et la politique), cette série d'ouvrages définit chaque terme à partir d'une réflexion critique et d'une analyse tendant vers la problématisation de la notion.
Vocabulaire philosophique. 2 [Livre] : Les mots de la culture / Yvan Elissalde, 2017
Vocabulaire philosophique. 3 [Livre] : Les mots de la raison et du réel / Yvan Elissalde, 2017
Vocabulaire philosophique. 4 [Livre] : Les mots de la politique / Yvan Elissalde, 2018
Vocabulaire philosophique. 5 [Livre] : Les mots de la morale / Yvan Elissalde, 2018
Encyclopédies philosophiques
Le petit Larousse de la philosophie [Livre] / sous la direction de Hervé Boillot, 2018
Avec plus de 700 entrées, d'"absurde" à "vérité" et d'Aristote à Tocqueville, le Petit Larousse de la philosophie aborde de façon accessible les thèmes, le vocabulaire, les grandes théories et les débats clés, des plus classiques aux plus actuels (l'homme est-il un loup pour l'homme ? L'embryon est-il une personne ? Le devoir du politique est-il de donner satisfaction à l'opinion publique ?) Avec également une histoire de la philosophie et 50 modèles de dissertations, ce Petit Larousse est une approche idéale pour les lycéens et étudiants !
Encyclopédie de la philosophie [Livre] / éd. sous la dir. de Jean Montenot pour la version française, 2002
Réalisé à partir de l'"Encyclopedia Garzanti" ce dictionnaire propose 2500 entrées. Il met en perspective les courants doctrinaux et les notions fondamentales de la philosophie. Il propose une ouverture à divers champs d'investigation connexes : les sciences humaines, l'épistémologie, la linguistique, la sociologie, la psychanalyse, les doctrines religieuses et théologiques.
Généralités
Philosopher, les repères [Livre] / Olivier Dekens, 2014
L'auteur présente et oppose entre eux les principaux concepts de la philosophie depuis l'Antiquité. Il définit chacune des notions, résume les principales théories philosophiques qui s'appuient sur elles et propose une réflexion sur leur opposition ou leur distinction.
Philosopher, les mots [Livre] / Olivier Dekens, 2014
Ce lexique a pour seule ambition de définir les principaux concepts de la philosophie tels qu'on peut les trouver à l’œuvre dans des pensées, qui non seulement en font usage, mais souvent les inventent elles-mêmes. L'orientation de ce lexique est donc à la fois pédagogique et philosophique dans le but de fournir aux étudiants et lycéens les outils nécessaires à la lecture des textes et au travail de la réflexion.
La philosophie de A à Z [Livre] / Elisabeth Clément, Chantal Demonque, Laurence Hansen-Love, Pierre Khan, 2004
Les principales notions philosophiques, les concepts clés, les philosophes, les personnages symboliques de la philosophie, les textes de référence.
Nous vous invitons également à consulter le site Web de la revue Philosophie Magazine, que la BmL conserve par ailleurs sous forme papier.
Ce site (Philomag) possède une catégorie "Lexique" qui donne un accès alphabétique à différents concepts philosophiques.
On y trouve :
- le terme "existence"
Du latin ex- ("dehors") et sistere ("se tenir"). L’existence désigne le fait d’être, indépendamment de toute connaissance possible. Elle se distingue de l’essence, qui définit ce qu’une chose est, et du néant, qui, par définition, n’a pas de réalité. À l’exception de Dieu dont l’existence est éternelle, le propre de l’existence est d’être finie, c’est-à-dire limitée dans le temps. De ce point de vue, l’existence s’oppose à la mort. Le fait pour l’homme de savoir qu’il est mortel, l’invite à méditer sur le sens de l’existence, car celle-ci peut lui apparaître comme contingente (elle pourrait ne pas être) et donc absurde. Les philosophies qui centrent leur réflexion sur l’existence sont dites existentialistes. L’existentialisme chrétien (celui de Pascal ou de Kierkegaard) voit dans le tragique d’une existence perçue comme finie l’occasion d’une conversion à Dieu. L’existentialisme athée (en particulier celui de Sartre) estime que la finitude n’est pas un obstacle à la liberté et que l’homme se réalise par ses choix. À ces interprétations finalement heureuses du fait d’exister s’opposent celles, pessimistes, de Schopenhauer qui estime que « la vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais » ou de Cioran qui déplore "l’inconvénient d’être né".
- le terme "être"
Du grec einai et du latin esse. Être est d’abord un verbe prédicatif qui permet de rapporter un attribut à un sujet. C’est en étudiant les sens de ce verbe dans l’usage de la langue grecque (comme "Socrate est blanc", "Socrate est assis", …) qu’Aristote dégage les dix catégories qui servent de base à sa logique (comme la qualité, la position…). En tant que verbe substantivé, l’être est l’objet d’une discipline spécifique : l’ontologie, qui inaugure la réflexion métaphysique. Initiée par Parménide, qui affirme que "l’être est" et que "le non-être n’est pas", cette science problématique – parce que son objet est trop universel pour être défini – est approfondie par Aristote qui soutient qu’"il y a une science de l’être en tant qu’être" et que "l’être se dit de multiples façons" (Métaphysique). Occasion d’une multitude de débats comme, au Moyen Âge, celui qui oppose Thomas d’Aquin à Duns Scot sur l’être de Dieu (est-il différent de l’être des choses ?), l’interrogation sur l’être est centrale chez Heidegger pour qui la question : "Pourquoi y a –t-il quelque chose plutôt que rien ?" est la plus fondamentale de la philosophie. "L’oubli de l’être" caractérise, selon lui, la domination actuelle de la technique sur la pensée.
- le terme "substance"
Du latin sub-, "dessous", et stare : "se tenir"– d’où "ce qui soutient", "support", lui-même dérivé du grec hypostasis. Mais le sens latin renvoie davantage au grec ousia : "essence". Ce terme désigne d’abord ce qui est en soi et qui subsiste en permanence. Ainsi définie, la substance est ce qui sert de support aux attributs et aux accidents. Elle se confond avec la notion de substrat. Mais le mot signifie aussi ce qui est par soi, c’est-à-dire ce qui n’a pas besoin d’une causalité externe pour être. Aristote distingue la substance première (ousia protè) qui désigne pour lui l’être individuel (comme, par exemple, Socrate) et la substance seconde (ousia deutera) qui renvoie à l’espèce ou au genre (par exemple, l’homme ou les mammifères) en tant qu’ils peuvent être sujet d’une proposition. Chez Descartes, la substance pensante (res cogitans) et la substance étendue (res extensa) sont les deux seules substances, mais l’homme, étant un composé des deux, peut être considéré comme une troisième substance. Pour Spinoza, n’existe plus qu’une seule substance (définie comme "ce qui est en soi et est conçu par soi") : Dieu, la pensée et l’étendue n’étant que des attributs, parmi d’autres possibles, de cette substance. Kant fait de la substance la première des catégories de la relation. Forme abstraite du jugement d’attribution, elle devient problématique pour la raison qui voudrait lui donner une réalité métaphysique. Ainsi, vouloir prouver que l’âme est une substance relève pour Kant du paralogisme, de la faute de raisonnement.
- le terme "accident" :
Du latin accidere, "ce qui advient", traduit du grec symbebèkos, "aller avec". Se dit de ce qui, selon Aristote, "va avec" la substance et qui donc dépend d’elle mais sans lui être nécessaire. L’accident n’existe pas en lui-même mais toujours en une autre chose. C’est la propriété d’un être qui n’appartient pas à sa définition. Ce qui est "accidentel" pour un être ou pour une chose peut donc être modifié ou disparaître sans que la substance de cet être ou de cette chose en soit fondamentalement affectée. Un homme peut être amputé sans pour autant perdre son humanité, une table peut changer de couleur en restant une table. Lié au hasard, Aristote estime que "l’accident n’a jamais une cause déterminée" (Métaphysique), c’est-à-dire une cause nécessaire, de sorte qu’on ne peut pas la prévoir. Si, en philosophie, l’accident peut être heureux et pas seulement malheureux, comme lorsqu’on trouve un trésor en creusant un trou, le langage courant ne retient que son caractère négatif : l’accident est ce qui arrive (accidit) de manière imprévisible et fâcheuse.
N'hésitez pas enfin à consulter les articles et le dictionnaire de l'Encyclopédie universalis qui définit par exemple "l'étant" comme l'être en tant que phénomène chez Heidegger.
Bonnes lectures !



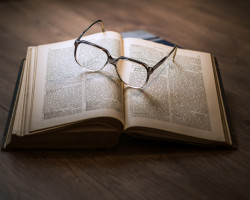
 Zones
Zones