Comment s'appelle le personnage de Mathieu Lindon dans le livre de Hervé Guibert ?
Question d'origine :
Le livre d'Hervé Guibert À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie (Gallimard, 1990), fait apparaître l'écrivain Mathieu Lindon comme personnage, sous un autre nom. Savez-vous sous quel nom, s'il vous plaît ?
Réponse du Guichet
Dans "Hervelino", Mathieu Lindon évoque son amitié et le surnom de son ami Hervé Guibert tandis que dans "L'incognito", Hervé Guibert met en scène son amitié intime et littéraire avec l'écrivain Mathieu Lindon, sous les traits du personnage Matéovitch.
Ce roman sera, selon le critique et spécialiste de son œuvre, Arnaud Genon, une étape littéraire qui le mènera vers sa trilogie du sida ("À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie" ; "Le Protocole compassionnel" ; "L‘Homme au chapeau rouge").
Le premier tome de cette trilogie "À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie" évoque l'écrivain Thomas Bernhard et met en scène des personnes réelles proches d'Hervé Guibert (Michel Foucault, Isabelle Adjani, Daniel Defert, Bruno Nuytten, Thierry et Christine Jouno) sous les traits respectifs des personnages Muzil, Marine, Stéphane, Richard, Jules et Berthe. Les sources consultées ne mentionnent pas Mathieu Lindon, mais il est certain que le cercle des proches de l'auteur nourrit ce roman à clés, tramé de secrets et d'intertextualités que nous vous invitons à approfondir par nos conseils de lectures.
Hervé Guibert et Michel Lindon sont par ailleurs des personnages d'un roman de Bernard Carvalho !
Bonjour,
Vous souhaitez savoir sous quel nom apparaît l'écrivain Mathieu Lindon dans le roman "À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie" d'Hervé Guibert.
Sur le mode de l'autofiction, l'auteur y raconte la maladie de son ami Muzil (Michel Foucault) et comment il a découvert qu'il avait le sida. Le style est sec et direct, et contaminé par l'influence de Thomas Bernhard. Ce récit fit scandale lors de sa sortie et révéla l'écrivain au grand public. Le Prix Colette lui fut attribué. Hervé Guibert passa notamment dans l'émission télévisée Apostrophes le 16 mars 1990, puis dans Ex-Libris le 7 mars 1991. "Le Protocole compassionnel" et "L'Homme au chapeau rouge" (1992) viennent compléter cette trilogie. (Source Editeur Gallimard 1992)
Les liens intimes et littéraires entre Hervé Guibert et Mathieu Lindon
Admirateur de Jean Genet, ami de Roland Barthes, Michel Foucault, Mathieu Lindon mais aussi de Dalida, Isabelle Adjani, Patrice Chéreau (pour lequel il fut scénariste), Pina Baush, ou encore Francis Bacon, Guibert fut un témoin privilégié d’une époque, celle des années 1980.
Hervé Guibert 1955-1991 et Mathieu Lindon, né également en 1955, sont tous deux journalistes (Guibert au Monde comme critique photographique, Lindon au Nouvel Observateur puis à Libération) et écrivains. C’est chez Michel Foucault que Mathieu Lindon rencontre Hervé Guibert en 1978. Ils passent deux ans à Rome à la fin des années 1980 où chacun d'eux est pensionnaire à la Villa Médicis. Leur amitié durera jusqu’à la mort en 1991 de l’auteur d"A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie".
Trente ans plus tard, Mathieu Lindon lui consacre un texte magnifique, Hervelino, entre Rome et Paris, la complicité et l’écriture, la joie et la maladie :
En 1978, l'écrivain rencontre Hervé Guibert, qu'il surnomme Hervelino dès le début de leur relation. Ils passent deux ans à Rome à la fin des années 1980 où chacun d'eux est pensionnaire à la Villa Médicis. M. Lindon évoque ces années romaines dans ce récit autobiographique qui porte avant tout sur la difficulté d'écrire et de raconter celui qui est aimé et admiré (Electre 2021).
Dans Les Inrockuptibles, Mathieu Lindon évoque le surnom de son ami, qui est également le titre de son roman éponyme "Hervelino" :
“Il y a pour moi dans Hervelino quelque chose d’affectueux, une façon de le prendre dans mes bras où je l’ai si rarement pris”, écrit Mathieu Lindon à propos du surnom italianisant qu’il donne à son ami Hervé, qui deviendra très vite “Guibert” pour le grand public, l’écrivain d’Eros et Thanatos, celui qui dit “je” et n’a pas peur d’écrire l’intimité vraie de la vie quand celle-ci est déjà mêlée à la mort, qui filmera son corps mutant sous le joug du sida.
La revue Zone critique consacre un article au roman "Hervelino" et à la relation qui s'y dévoile entre Guibert et Lindon :
Biographique d’une période de Guibert et autobiographie d’une période de Lindon, le roman s’organise comme un hommage et une confidence, comme une suite d’anecdotes et un deuil vivace. Manière biographique, puisque Lindon nous raconte Hervelino comme Guibert, à la Villa : «Hervé écrivit et fit paraître deux livres qui y eurent un grand retentissement (et au-delà !) durant son séjour à la Villa. L’Incognito raconte son arrivée et sa première année à l’Académie […].» Autobiographique aussi pour l’intimité qu’il dévoile et analyse avec le recul : «J’ai été un temps amoureux de lui, au sens le plus sexuel, on était en contact permanent, normal que ça déclenche des exaspérations. C’était d’une certaine manière le prix à payer, l’exaspération des sentiments avait aussi ses avantages.»
L'émission France culture Par les temps qui courent éclaire également cette amitié :
Ce livre paraît 29 ans après la mort d’Hervé Guibert, et je crois que j’ai compris pourquoi j’avais mis tant de temps à l’écrire : Je ne peux pas écrire sur le deuil. [...] Je ne fais pas des livres de deuil, même concernant les êtres les plus proches, j’écris sur la joie de les avoir connus, que ce soit Michel Foucault ou Hervé Guibert. Hervelino, c’est la joie d’avoir connu Hervé, la joie qu’on avait à être ensemble. Pour que la joie, après la mort d’un être aimé soit le sentiment dominant, il faut du temps : il faut du temps pour que le chagrin ne fasse plus le match.
J’ai voulu décrire quelque chose de notre relation, c’est pour cela que je me suis cantonné aux années romaines, parce que je ne pouvais pas décrire la totalité de notre relation, c’était trop compliqué, trop lourd, et je ne me suis pas senti de le faire. J’ai mis du temps à comprendre que notre relation était spéciale, et que cela avait du sens de ne raconter que cette période. Ca m’épargnait de raconter ce qu’on raconte d’habitude de l’amitié.
Le site La Reine blanche productions consacre quant à lui un article sur la rencontre du trio Hervé Guibert, Mathieu Lindon et Michel Foucault :
Après une adolescence passée à lire et à voir défiler les grands esprits de l’époque dans le salon familial, Mathieu Lindon découvre l’excitation d’une culture autre, transgressive, facile, légère. C’est à la fin des années 1970 que Mathieu Lindon rencontre Michel Foucault. Dans son appartement, rue de Vaugirard, on écoute Mahler sous LSD, on parle littérature, amours, on joue même au frisbee en craignant quand même que le projectile heurte le Picasso accroché au mur. [...] Il y a toute une bande de jeunes écrivains qui squatte ; Foucault ne les reçoit pas en philosophe, c’est un ami, un confident. Parmi eux, Hervé Guibert. Chez Guibert, Foucault s’appelait Muzil. [...]
En 1990, Hervé Guibert publiait "A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie". Michel Foucault y devenait Muzil, l’homme aux deux visages : une face diurne (un ami généreux) et une face nocturne (son goût pour le sado-masochisme).
L'ouvrage collectif Hervé Guibert, Les échos d'une œuvre, d'hier à aujourd'hui (sous la direction d'Arnaud Genon et Fabio Libasci et publié chez classiques Garnier en 2023) comporte un index des noms de personnes dans lequel apparaît Mathieu Lindon, cité plusieurs fois.
En effet, en s’appuyant sur le roman L’Incognito d'Hervé Guibert, et en proposant une lecture croisée de ce roman avec l’ouvrage plus récent de Mathieu Lindon Hervelino, Arnaud Genon évoque les liens intimes et artistiques de ces deux écrivains. Dans "L'Incognito" le narrateur, Hector Lenoir (double de Guibert), relate son séjour à "l’Académie espagnole" qui fait écho au séjour bien réel que passa l'auteur à la Villa Médicis avec son ami Mathieu Lindon entre 1987 à 1989.
Il n’épargne ainsi personne, tombant à bras raccourcis sur chacun des membres de cette noble institution dont il dévoile les coulisses, les petits arrangements, les guerres de pouvoir internes, les privilèges et autres petits trafics d’influence. Certains des pensionnaires en ont aussi pour leur argent, et tombent sous la plume piquante du narrateur qui souligne les mesquineries des uns, les bassesses des autres. Heureusement, le narrateur n’est pas seul dans cette Académie. Il s’y retrouve avec Matou (Eugène Savitzkaya) puis Matéovitch (Mathieu Lindon) et ensemble ils se livrent à de nombreuses facéties qui la transforment en théâtre burlesque et comique. [...]
[Ce livre est] comme une étape de transition vers ce qui sera le Guibert « nouvelle mouture » : sa trilogie du sida (À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie ; Le Protocole compassionnel ; L‘Homme au chapeau rouge).
Source : Site sur Hervé Guibert par Arnaud Genon
Cet ouvrage collectif comporte également un index des noms de personnages dans lequel plusieurs occurrences sont consacrées au personnage Matéovitch.
Nous ne pouvons que vous encourager à lire cet ouvrage (voir la notice du Sudoc).
Le roman "À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie" entre fiction et réalité
Dans ce roman, Bill, un ami du narrateur double de l'auteur, lui annonce que Melvil Mockney (Jonas Salk, le découvreur du vaccin contre la poliomyélite) vient de trouver un remède. Promesses, grands discours, empathie se muent, au fil du roman, en trahison, imposture et manipulation : Bill n'aidera jamais Hervé, pire, il le laissera tomber. C'est à lui qu'il dédie ce livre : cet ami qui ne lui a pas sauvé la vie. Le véritable ami dans ce récit n’est pas Bill (celui auquel le titre fait référence) mais Muzil (qui dans la vraie vie s’apparente à Michel Foucault) qui meurt du sida, préfigurant la mort à venir du narrateur.
On peut reconnaître des personnalités de l’époque, comme Isabelle Adjani, sous le nom de Marine - en référence à la chanson Pull marine interprétée par Isabelle Adjani - grande amie lunatique et colérique, sempiternellement cachée derrière ses lunettes noires. On trouve aussi Daniel Defert (compagnon de Foucault qui créera, à la mort du philosophe, l'association AIDES), sous le nom de Stéphane, Bruno Nuytten (père du premier enfant d'Adjani), sous le nom de Richard. Thierry Jouno [amant d'Hervé Guibert] et sa compagne Christine sont Jules et Berthe.
Source : Wikipédia
Sur les relations entre Hervé Guibert et le couple Thierry et Christine Jouno (devenue, à la mort de Thierry, la femme d'Hervé), voici un extrait de "Fous d'Hervé : correspondance autour d'Hervé Guibert" d'Arnaud Genon qui a dédié la majeure partie de son travail de chercheur à l’écrivain et qui dans cet ouvrage nous donne à lire ses échanges avec ceux qui l'aiment :
Ce projet ne pouvait commencer qu’à une seule condition. C’était très clair dans mon esprit. La première lettre, je l’adresserai à Christine Guibert. Et je lui demanderai de me parler de Thierry. Non pas d’Hervé, mais de Thierry, l’amant d’Hervé qui était son compagnon à elle et le père de ses enfants. Elle, qui était devenue sa femme quelques mois avant sa mort, Hervé voulant mettre cette famille de cœur à l’abri. Elle, à qui il reviendrait de faire respecter son testament littéraire. Je ne savais pas si elle me répondrait. Je l’espérais simplement. Et si réponse il y avait, alors je poursuivrais l’envoi d’autres lettres et ainsi de suite, en espérant que tout cela prendrait forme, que les lignes commenceraient à esquisser le portrait en creux d’Hervé Guibert. En creux. Il ne s’agissait pas de le retrouver lui, mais de le chercher en nous qui l’aimons. En ceux qu’il aimait et en ceux qui l’aimaient.
L'article de Fabio Libasci «De Michel à Muzil». De la personne au personnage (2024) évoque l'amitié entre Hervé Guibert et Michel Foucault baptisé Muzil en hommage sans doute à Georges Dumézil.
Michel Foucault fait la connaissance d’Hervé Guibert en 1977, à l’occasion de la parution de La "Mort propagande". Le philosophe est frappé par le génie de cet auteur de 21 ans et il parle de lui à Bernard-Henri Lévy lors d’un entretien publié dans Le Nouvel Observateur. [...] À partir de là une relation amicale se noue et, avec l’arrivée de Mathieu Lindon, un rapport qui ne va pas sans rappeler le maître et ses disciples à l’âge classique se construit. Cela a été déjà évoqué dans Ce qu’aimer veut dire de Mathieu Lindon.
La présence fantomatique de l'écrivain Thomas Bernhard habite également de manière diffuse ce livre :
Après Roland Barthes, Peter Handke ou Eugène Savitzkaya, c'est à Thomas Bernhard qu'incombe, dans "À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie", ce rôle de frère d'écriture. Guibert le compare aux poussées de fièvre que provoque la progression du virus dans son corps, et note, avec une certaine ironie : "Je fourbissais mes armes pour égaler le maître contemporain, moi pauvre petit Guibert, ex-maître du monde qui avait trouvé plus fort que lui et avec le sida et avec Thomas Bernhard."
Source : Encyclopædia Universalis. GUIBERT HERVÉ (1955-1991) [en ligne] par François Poirié
"À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie" est un roman à clefs. Mais, bien que "tout soit scrupuleusement exact", comme il le précise dans une interview, tous ceux qui sont évoqués dans le livre "ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont dans la réalité", et "même celui qui est Hervé Guibert dans le livre est un personnage". Le sida est le personnage principal du livre, tout comme l'amitié qui sous-tend sa composition.
[Le sida] oblige Guibert à opter pour cette chronologie particulière, chaotique, sorte de mémoire personnelle, affective et sélective, telle qu'on pourrait la rencontrer dans un journal intime. Quand Guibert commence ce livre, il se sait condamné par cette maladie inexorable qu'il définit plutôt comme « un état de faiblesse et d'abandon ». [...]
C'est avec une précision quasi clinique que Guibert détaille la manière dont le virus travaille son corps, sa conscience et son écriture. Sans se laisser déborder par l'émotion ou la détresse, comme s'il était l'observateur silencieux de lui-même, il raconte l'histoire de sa lente agonie, que traverse un fol espoir de guérison. [...]
L'amitié, autre thème qui court tout au long du livre et le charpente, c'est pour Guibert « être ensemble », être proches jusque dans la mort. Quant à ceux qui connaissent un autre sort, qui se rangent, en somme, du côté des vivants, ils sont vite considérés par l'auteur comme des traîtres. Ainsi de Bill, cet « ami » qui donne son titre au livre : responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique américain, il a eu la possibilité d'injecter un vaccin à Guibert, mais il ne l'a pas fait et s'est réfugié lâchement dans le silence, le mensonge.
Source : Encyclopædia Universalis. GUIBERT HERVÉ (1955-1991) [en ligne] par François Poirié
Hervé Guibert, à propos de "À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie" :
"Ce livre n’est pas un testament, mais c’est un livre qui donne des clés pour comprendre ce qu’il y avait dans tous les autres livres et que parfois je ne comprenais pas moi-même. Le sida m’a permis de radicaliser un peu plus encore certains systèmes de narration, de rapport à la vérité, de mise en jeu de moi-même au-delà même de ce que je pensais possible. Je parle de la vérité dans ce qu’elle peut avoir de déformé par le travail de l’écriture. C’est pour cela que je tiens au mot roman. Mes modèles existent, mais ce sont des personnages. Je tiens à la vérité dans la mesure où elle permet de greffer des particules de fiction comme des collages de pellicule, avec l’idée que ce soit le plus transparent possible. Mais il y a aussi des grands ressorts de mensonge dans ce livre."
"La vie sida", entretien avec Antoine de Gaudemar, Libération, 1er mars 1990.
Source : Site sur Hervé Guibert par Arnaug Genon
Cette trilogie dont fait partie "À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie" est présentée comme relevant du genre de l'autofiction par Arnaud Genon :
Si tous les textes de Guibert ne peuvent donc être considérés comme appartenant à l’autofiction ainsi définie, il semble pourtant que son œuvre entière tende vers ce genre qui constitue l’aboutissement de son travail, à travers la trilogie du sida, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990), Le Protocole compassionnel (1991) et L’Homme au chapeau rouge (1992), trilogie qui répond de manière précise à la définition du genre que nous venons de proposer. L’autofiction est le dispositif littéraire, la posture énonciative qu’a trouvée Guibert pour dire le sida et la crise identitaire, puis la fracture autobiographique dont il est la cause, pour dire la disparition du sujet et sa mort proche.
Source : Genon, Arnaud. « Hervé Guibert : fracture autobiographique et écriture du sida » dans Autofiction(s), édité par Claude Burgelin et al., Presses universitaires de Lyon, 2010
À noter : Hervé Guibert et Mathieu Lindon sont des personnages du roman de Bernard Carvalho.
Dans le roman "Les initiales" de Bernard Carvalho, le narrateur relate quelques jours passés dans le monastère d’une île, "E", en compagnie d’autres personnes dont un écrivain connu, "M", malade, écrivant compulsivement son journal et réalisant un film à l’aide d’un caméscope. Il arrive sur l’île en compagnie de "C", écrivain lui aussi, disposant par ailleurs "d’une rubrique régulière dans un journal important". Il y est accueilli sur le port par "G", amant de "M", mort six mois après lui et "H", sa compagne et mère de ses deux enfants, qui leur aura survécu. Tout lecteur de Guibert comprendra aisément que Les initiales relate un séjour du narrateur, en août 1990 sur l’île d’Elbe, en compagnie d’Hervé Guibert, Mathieu Lindon, Thierry et Christine Jouno.
Source : Site sur Hervé Guibert par Arnaud Genon
Pour conclure, l'étude de Mana Naito L’Univers d’intimité d’Hervé Guibert (L’Harmattan, coll. Critiques Littéraires, 2015) parle au sujet de l’œuvre guibertienne d'un "univers romanesque tramé de secrets" conçu selon elle comme "une lettre que le narrateur écrirait à ses différents amis" :
Protéiforme, l’œuvre d’Hervé Guibert acquiert son unité et sa cohérence par la présence de personnages récurrents qui constituent le cercle des proches de l’auteur. Autour du « moi » se trouvent donc des satellites qui viennent nourrir ses écrits en fonction de leur potentiel romanesque.
Source : Site sur Hervé Guibert par Arnaud Genon
Aller plus loin avec les analyses d'Arnaud Genon
Le site herveguibert.net, dirigé par Arnaud Genon (auteur d'une thèse, de plusieurs articles et ouvrages consacrés à Hervé Guibert) propose :
des repères biographiques, une bibliographie critique, une présentation de l’œuvre d'Henri Guibert et plus précisément du roman A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie (1990)
Hervé Guibert, 20 ans après par Arnaud Genon
Documents issus des collections de la BmL
Les documents au sujet d'Hervé Guibert dont Hervé Guibert, la mort propagande [En ligne] (film documentaire)
Hervé Guibert publia de nombreux romans, notamment La Mort propagande (1977, réédité en 2009), Des aveugles (1985), Mes parents (1986), Vous m'avez fait former des fantômes (1987), Mauve le vierge (1988), L'Incognito (1989). Atteint du sida, il écrivit À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie (1990), plaçant désormais la maladie au centre de son œuvre (Le Protocole compassionnel en 1991, ou Cytomégalo-virus, ouvrage posthume en 1992). Hervé Guibert travailla avec Patrice Chéreau au scénario d'un film, L'Homme blessé (1983), et avec Philippe Adrien à l'adaptation théâtrale de son roman, Il réalisa l'année de sa mort le film La Pudeur ou l'Impudeur (1991). Tenu de 1976 à 1991, son journal, Le Mausolée des amants, a été publié en 2001.
Les œuvres de Mathieu Lindon
L'un de ses derniers livres Une archive esquisse son portrait professionnel et familial à travers le bouillonnement littéraire, intellectuel et politique des années 1950 à nos jours, dont les Éditions de Minuit furent un acteur de premier plan. Il publie son premier roman "Nos plaisirs" en 1983 sous le pseudonyme de Pierre-Sébastien Heudaux, soit P.-S. Heudaux, prononcé Pseudo.
Bonne journée !



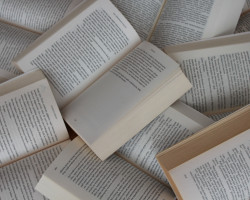
 Le jardinier et la mort
Le jardinier et la mort