Comment faisons-nous nos choix : que prendre et que rejeter ?
Question d'origine :
Est-ce que dans la vie en société chacun est exposé un peu à tout et chacun 'prend un peu ce qui lui plaît' et rejette un peu ce qui lui plaît pas, on prend ce que l'on veut prendre dans tout ce à quoi on est exposé dans la vie en société et on rejette, on ne prend pas ce qui nous parle pas, à tous les niveaux?
Réponse du Guichet
Nous construisons notre identité en tant que sujet, en interaction avec les autres et la société, de façon complexe. À l'origine de nos différences et préférences personnelles à choisir ceci et rejeter cela dans le monde où nous sommes "jetés" à la naissance, se pose la question philosophique toujours d'actualité de notre libre arbitre face au hasard et aux déterminismes biologiques et environnementaux (milieu physique, structures sociales, famille, éducation...).
Les énigmes autour de la personnalité humaine et de ses inclinaisons, qui sont questionnées par la philosophie (sous l'angle métaphysique, morale et politique), les neurosciences, la psychologie ou encore la sociologie nous permettent encore à ce jour de nous distinguer des Chatbots !
Bonjour,
Vous vous demandez comment l'individu se positionne et interagit avec la société dans laquelle il vit, où "nous sommes jetés à la naissance", comme disait Simone de Beauvoir.
Pourquoi sommes-nous plus enclin à nous intéresser à ceci plutôt qu'à cela ? Pourquoi choisissons-nous ceci et rejetons-nous cela ? Pourquoi certains individus sont plus enclins à s’enrichir au contact de ce qui est différent d’eux, et d’autres à rejeter tout ce qui n’est pas comme eux ? Comment faisons-nous nos choix et construisons-nous notre identité au sein des structures sociales et des relations intersubjectives qu'elles occasionnent ?
Votre question pose d'abord la question de la capacité du sujet humain à exprimer une volonté ("ce que l'on veut prendre", "on rejette") au sein de la société dans laquelle il vit. La volonté est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. Éclairée par la raison, la volonté est ce qui permet d’exprimer notre liberté.
Paul Ricœur, dans sa Philosophie de la volonté (1950), la définit comme "un acte proprement humain" qui, procédant "de haut en bas", permet de dominer les formes multiples de l’involontaire comme l’impulsion ou l’automatisme réflexe.
Source : Définition de la volonté (Philosophie magazine)
La capacité du sujet humain à vouloir librement selon des valeurs propres est battue en brèche par les "philosophes du soupçon", selon la terminologie de Ricœur, qui pensent que le sujet est déterminé par ce qui n’est pas lui (sa classe sociale, son corps, son inconscient) et par le courant structuraliste (représenté notamment par Barthes, Lacan, Levi-Strauss, Foucault ou Deleuze) qui considère que les structures priment sur les figures et que le sujet est avant tout un processus. En revanche, les philosophies du sujet (ou encore philosophies de la conscience), partent de l’intériorité de l’homme pour fonder les valeurs qui motivent son action. Les notions de sujet et de conscience sont définies par Philosophie magazine :
On considère que les philosophies de la conscience (dites aussi philosophies du sujet) naissent au XVIIe siècle avec Descartes et marquent le tournant moderne de l’histoire de la philosophie : le savoir sera désormais recentré sur l’homme, sur l’étude de ses facultés de penser, sur la quête de son identité, sur l’intentionnalité. Mais la conscience a aussi un sens moral : elle est la source du jugement pratique ou encore ce par quoi le sujet peut distinguer le Bien et le Mal.
Source : Définition de la conscience (Philosophie magazine)
Ce terme [sujet] est fortement polysémique. Le sujet désigne chez Aristote, d’un point de vue métaphysique, l’être auquel on rapporte les attributs et les accidents (il est alors synonyme de substance) et, d’un point de vue logique, ce dont on affirme ou nie quelque chose (par exemple : Socrate est mortel). Mais c’est surtout à partir de la Renaissance que le mot acquiert un sens nouveau : il désigne alors l’esprit connaissant, connu par introspection, et tendu vers les objets qu’il étudie. Il s’agit soit du sujet empirique (le moi individuel tel que le décrit, par exemple, Montaigne), soit du sujet universel (le cogito cartésien), soit du sujet transcendantal (dont Kant décrit le fonctionnement a priori), soit encore du sujet intentionnel (qui, selon la phénoménologie et l’existentialisme, donne sens au monde). On appelle "philosophies du sujet" (ou encore "philosophies de la conscience"), toutes ces doctrines qui partent de l’intériorité de l’homme pour fonder la connaissance et les valeurs qui motivent son action. S’y opposent, d’une part, ce que Ricœur appelle les "philosophes du soupçon" (comme Marx, Nietzsche ou Freud) qui "brisent" le sujet en estimant qu’il ne peut pas être transparent à lui-même parce qu’il est déterminé par ce qui n’est pas lui (sa classe sociale, son corps, son inconscient), d’autre part, le courant structuraliste (représenté notamment par Barthes, Lacan, Levi-Strauss et en un sens par Foucault ou Deleuze) qui considère que les structures priment sur les figures et que le sujet est avant tout un processus ou un nœud de relations.
Source : Définition du sujet (Philosophie magazine)
Parmi les philosophies du sujet, se trouve l’existentialisme athée anti-déterministe, représenté principalement par des philosophes issus de la phénoménologie comme Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir. Selon ces philosophes, le délaissement originel de Dieu, s’il est angoissant, révèle notre liberté puisque l’homme, privé de référence absolue, doit créer ses propres valeurs en interprétant le monde dans lequel il est "jeté" : l’être humain, fondamentalement libre, opère un ensemble de choix et d'actions, donnant ainsi un sens à sa vie.
L’existentialisme s’oppose donc à l’essentialisme. On distingue en général deux grands courants à l’intérieur de ce courant philosophique. D’une part l’existentialisme chrétien dont Pascal, Kierkegaard, Berdiaev, Jaspers, Gabriel Marcel et Tillich sont les figures principales, et d’autre part l’existentialisme athée, représenté principalement par des philosophes issus de la phénoménologie comme Heidegger, Sartre et Merleau-Ponty. On peut aussi admettre que Simone de Beauvoir appartient à ce courant lorsqu’elle affirme : "On ne naît pas femme : on le devient". Le premier courant, en particulier avec Pascal, soutient que l’homme est perdu dans l’univers et que son état misérable ne peut trouver sens qu’en Dieu [...] ; le second courant affirme au contraire que ce délaissement originel, s’il est angoissant, révèle aussi notre liberté puisque, l’homme ne pouvant s’arrimer à une référence absolue, c’est à lui de créer ses propres valeurs en interprétant le monde dans lequel il est "jeté". Ainsi, aujourd’hui, l’existentialisme est principalement compris dans cette dernière acception, qui revient à une sorte "d’athéisme anti-déterministe": c’est à dire postuler que l’être humain est fondamentalement (et implacablement) libre, et qu’il revient à lui – et à lui seul –, par l’ensemble de ses choix et de ses actions, de donner un sens à sa vie, qui n’en a aucun a priori. Mouvement très influent au milieu du XXe siècle, l’existentialisme, qui s’est aussi exprimé à travers le roman et le théâtre (de Sartre, de Gabriel Marcel, …), s’est vu contesté à partir des années 60 par le structuralisme.
Source : Définition de l'existentialisme (Philosophie magazine)
"L’homme est condamné à être libre" : cette déclaration de Sartre, qui est au coeur de son œuvre philosophique majeure, L’Être et le Néant et de son célèbre discours "L’existentialisme est un humanisme", concerne tous les aspects de l’existence humaine : le libre arbitre, les valeurs morales et l’intersubjectivité (rapport aux autres).
"Nous sommes seuls, sans excuses. C’est ce que je veux dire quand je dis l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même [...] et à partir du moment où il est jeté dans ce monde il est responsable de tout ce qu’il fait."
Source : Sartre, l'homme est condamné à être libre (La-Philo)
La liberté fait l'objet en philosophie d’une triple analyse : métaphysique, morale et politique. Métaphysique car il s'agit de savoir si l'homme possède un libre-arbitre. Morale car selon Kant, seul un être libre peut choisir entre le Bien et le Mal et réciproquement, seul un être moral peut être libre ; à contrario celui qui veut jouir sans contrainte est libertin selon Kant. Politique car la notion de citoyen libre est opposée à celle d'esclave chez les grecs.
C’est d’abord une notion métaphysique : il s’agit de savoir si l’homme est libre ou déterminé par des contraintes qu’il ne maîtrise pas. S’il est la cause première de ses choix, on dit qu’il possède un libre-arbitre.C’est ensuite une notion morale : pour Kant, la liberté, ne pouvant être démontrée, doit néanmoins être postulée afin que la morale soit possible. En effet, seul un être libre peut choisir entre le Bien et le Mal, car, pour devoir, il faut d’abord pouvoir. Réciproquement, selon Kant, seul un être moral peut être libre : la liberté est alors synonyme d’autonomie. A contrario, celui qui veut jouir sans contrainte morale est appelé libertin. C’est enfin une notion politique. On oppose ici le citoyen libre (appelé d’ailleurs en latin : liber, d’où vient le mot "liberté") à l’esclave. Lorsque l’État exerce peu de contraintes sur l’individu, on parle d’un État libéral. Si l’individu estime que les lois sont trop contraignantes et empêchent l’exercice de sa liberté (qu’elles sont liberticides), il lui arrive de contester l’État sous toutes ses formes. Un tel individu est dit alors libertaire ou anarchiste.
Source : Définition de la liberté (Philosophie magazine)
Notons que la notion de volonté est employée respectivement dans un cadre moral et politique chez Kant et Rousseau. Le respect de la loi morale est pour Kant une volonté "bonne". Rousseau fait reposer le contrat social sur la "volonté générale", seule source légitime de la souveraineté. Dans un régime démocratique, comme le nôtre actuellement, un sujet est appelé à respecter un certain nombre de lois érigés par un État de droit qui protège les droits et libertés individuelles.
Proposition de lecture : L’État de droit est une des conditions de notre démocratie et de notre vivre ensemble (Site du conseil d'État, 20 juin 2024)
Opposé au déterminisme, le libre-arbitre est interrogé aujourd’hui par les neurosciences. Jusqu’à quel point l’homme peut-il être maître et conscient des motivations qui déterminent ses choix ? Selon la philosophe américaine Adina Roskies, les neurosciences peuvent permettre de comprendre la prévisibilité de nos actes, mais ne tranchent pas le débat philosophie de l’interaction liberté/déterminisme.
En 2007, le Pr John-Dylan Haynes, neuroscientifique rattaché au centre Bernstein de neurosciences computationnelles (BCCN) de Berlin, a placé des volontaires dans un caisson d’IRM devant un écran où défilaient des lettres au hasard. Il leur a demandé d’appuyer sur un bouton soit avec l’index droit, soit avec le gauche quand ils en ressentaient le besoin et de retenir la lettre affichée au moment où ils ont décidé d’appuyer sur le bouton. L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle révélait leur activité cérébrale en temps réel. Les résultats ont été surprenants : les sujets prenaient la décision consciente d’appuyer sur le bouton environ une seconde avant de le faire, mais l’équipe de Haynes a découvert que leur activité cérébrale semblait anticiper cette décision avec sept secondes d’avance. Autrement dit, c’était comme si, bien avant que les sujets soient conscients de faire un choix, leur cerveau avait déjà pris une décision.
En tant qu’êtres humains, nous aimons à penser que nos décisions sont sous notre contrôle conscient, que nous avons un libre arbitre. Cette notion, dont les philosophes débattent depuis des siècles, est à nouveau remise en question par les travaux de Haynes et d’autres spécialistes des neurosciences. Selon eux, la conscience d’une décision n’est peut-être qu’un phénomène biochimique ultérieur sans aucune influence sur nos actes. En vertu de cette logique, disent-ils, le libre arbitre est une illusion. “Nous croyons faire des choix, mais ce n’est pas vrai”, résume Patrick Haggard, chercheur en neurosciences au University College de Londres. [...]
Aujourd’hui, la plupart des philosophes acceptent l’idée que l’on puisse prendre des décisions rationnelles dans un environnement déterministe. Ils débattent de l’interaction entre liberté et déterminisme (l’idée que tout est prédestiné soit par le destin, soit par les lois physiques). Or, estime Adina Roskies, la recherche neuroscientifique n’est pas encore en mesure de trancher cette question. Elle peut débattre de la prévisibilité de nos actes, mais pas du déterminisme.
Source : Êtes-vous vraiment libre de vos actes ? (Courrier international du 26 octobre 2011)
Bernard Feltz, dans sa publication Plasticité neuronale et libre arbitre défend que les neurosciences contemporaines, en particulier les recherches sur la plasticité neuronale, ouvrent à une interprétation du comportement humain en termes de libre arbitre effectif.
Les recherches sur la plasticité neuronale ouvrent à de nouvelles compréhensions du libre arbitre. Des chercheurs comme Mankel et Edelman prolongent leur investigation scientifique par des considérations philosophiques sur le libre arbitre. Cette position se heurte cependant aux interprétations récentes des expériences de Libet proposées par Wegner. Une présentation synthétique des thèses de ces divers auteurs ouvre à deux thématiques : la question du déterminisme et les relations entre plasticité neuronale et langage. Un historique de la question du déterminisme montre que l’interprétation wegnérienne ne s’impose en aucune manière et qu’un indéterminisme local est parfaitement compatible avec les théories scientifiques contemporaines. Une analyse de la fonction langagière qui met en dialogue les travaux de Habermas et Davidson avec les neurosciences contemporaines ouvre à une conception du libre arbitre où le comportement humain s’articule à une logique de significations qui échappe à une explication biologique. La compatibilité du libre arbitre avec les neurosciences contemporaines se voit ainsi établie.
Source : Plasticité neuronale et libre arbitre / Feltz, Bernard - Digital access to libraries (Université Catholique de Louvain)
Que nous dit la psychologie ?
La personnalité d'un individu s'affirme dans les choix et les préférences qu'il manifeste en société et qui lui donne une capacité d'agir sur son environnement. Mais en sens inverse, la personnalité se nourrit et se construit par l'influence de l'entourage, et ce dès la naissance.
L’étude des relations interpersonnelles constitue un thème central dans le domaine de la psychologie sociale, mais également dans le domaine de la psychologie du développement. C’est au sein des relations qu’il entretient avec sa mère que, pour la première fois, le moi de l’enfant affirme son entité propre. Les interactions avec l’entourage fournissent les stimulations indispensables à l’acquisition et au développement du langage. La maîtrise des pulsions, la régulation des émotions, l’intériorisation des normes de conduite, l’élaboration progressive des connaissances et des jugements, toute la vie psychique se construit au sein des relations établies avec l’entourage.
Source : 1. Les relations interpersonnelles et le développement à l’adolescence / Claes, Michel. L’univers social des adolescents, Presses de l’Université de Montréal, 2003
Un peu plus loin, l'article aborde la relation intersubjective, comme l'amitié, en termes de construction commune et de capacité d'influence réciproque sur les représentations, les croyances, les attitudes, etc.
La relation est une construction commune qui dépasse les individus et ne peut se réduire aux caractéristiques de l’une ou de l’autre de ces personnes. Cette construction résulte de l’action que chacune d’entre elles a sur l’autre ; chacun est à la fois l’architecte et le produit de la relation dans laquelle il est engagé. Les échanges affectent progressivement les représentations, les croyances, les attitudes et les émotions de chacun des protagonistes. La relation s’appuie sur le caractère mutuel des échanges : la réciprocité et l’interdépendance constituent les fondements de toute relation interpersonnelle.
La psychologie différentielle admet une interaction étroite entre le patrimoine génétique et les caractéristiques environnementales (milieu physique, social et familial, éducation, etc.) dans la détermination des différences individuelles.
Quand on s’interroge sur l’origine des différences individuelles, on invoque en général deux types de facteurs : les facteurs héréditaires et les facteurs environnementaux. La question du rôle joué par l’un et l’autre, et de la prédominance de l’un sur l’autre a animé de nombreux débats (cf. Enjeux des questions sur l’origine des différences individuelles dans la section Documents et méthodes). À l’heure actuelle, on admet en général que cette question n’a pas de sens : le patrimoine génétique et les caractéristiques environnementales (milieu physique, social et familial, éducation, etc.) interagissent étroitement dans la détermination des différences.
Source : L’origine des différences individuelles : le rôle de l’hérédité et du milieu. Psychologie différentielle ( p. 100 -117 ) / Eme, E. (2003), Armand Colin
Par ailleurs, la sociologie, en tant que science humaine, cherche à comprendre dans quelle mesure nos conduites sont socialement déterminées et si la société (cet "ensemble d'interactions formant système" selon Edgar Morin) permet à l’individu de s’accomplir ou, au contraire, si elle constitue un obstacle à son épanouissement.
Propositions de lecture à ce sujet :
Flipo, F. (2011). L'émancipation aujourd'hui. Revue du MAUSS, n° 38(2), 369-384.
Quiniou, Y. (2006). Pour une actualisation du concept d'aliénation. Actuel Marx,n° 39(1), 71-88.
Nous n'avons pas abordé le principe de hasard qui vient aussi s'interposer entre notre volonté libre et les déterminismes biologiques et environnementaux. Enfin, nous n'avons pas non plus abordé les philosophies orientales, comme le confucianisme ou le bouddhisme Zen, qui questionnent la liberté de nos choix en dehors du monothéisme de l’Occident et de la philosophie occidentale.
On le voit, nous construisons notre identité en tant que sujet et notre lien au monde et aux autres de façon complexe. À l'origine de nos différences et inclinaisons personnelles à choisir ceci et rejeter cela dans le monde où nous sommes "jetés" à la naissance, se pose la question philosophique toujours d'actualité de notre libre arbitre face au hasard et aux déterminismes biologiques et environnementaux (milieu physique, structures sociales, famille, éducation...).
Les énigmes de la personnalité humaine, qui sont questionnées par la philosophie (sous l'angle métaphysique, morale et politique), les neurosciences, la psychologie ou encore la sociologie, nous permettent encore à ce jour de nous distinguer des Chatbots !
Continuer la réflexion avec les livres issus des collections de la BmL
Le libre arbitre à l'épreuve de la science [Livre] / Alfred R. Mele, 2021
Donnez du sens à vos décisions [Livre] : 7 clés pour discerner et faire les bons choix / Sylvie-Nuria Noguer ; préface de Sébastien Henry, 2018
On ne naît pas engagé, on le devient [Livre] : nous avons tous le choix / Alice Barbe, 2021
Nos désirs font désordre [Livre] : comprendre que l'intime est politique et le libérer du patriarcat / Adélaïde Barat-Magan, 2023
Essai sur le libre arbitre [Livre] / Peter Van Inwagen ; traduction de Cyrille Michon, 2017
Enfin libres ? [Livre] / sous la direction de Jean Birnbaum, 2023
Du plaisir d'être soi [Livre] / Sophie Peters, 2015
... et sur le Web
La formation de la personnalité : un processus de socialisation. Introduction à la psychosociologie Concepts et études de cas. ( p. 137 -203 ) / Citeau, J. et Engelhardt-Bitrian, B. (2014). Chapitre 5.Armand Colin
La psychologie de la personnalité / Hansenne, M. (2019). Éditions Sciences Humaines
Comment vivre en société ? Individus et communautés dans l’espace public, Appel à contribution, Calenda, publié le vendredi 24 juin 2011
Vivre avec les autres. Quels enjeux psychiques ? / Fischer Gustave-Nicolas
Voici pourquoi nous avons tant besoin les uns des autres (The conversation, 4 juin 2020)
Comment prendre de bonnes décisions ? (Philosophie magazine, 07 août 2024)
L. A. Paul : “Se laisser pleinement transformer par le choix qu’on a fait” (Philosophie magazine, 11 janvier 2024)
Søren Kierkegaard. Le choix de soi (Philosophie magazine, 30 mai 2013)
Bonne journée,



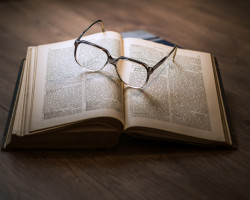
 Zones
Zones