Question d'origine :
Est-ce qu'il y a des mots pour tout? Quelquefois on pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire nos pensées philosophiques, politiques, des qualités etc mais des gens intelligents et éduqués arrivent toujours à trouver des mots pour tout décrire, tout exprimer....Est-ce qu'il y a des mots pour tout? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les mots pour tout exprimer ou du moins pour beaucoup de choses?
Réponse du Guichet
Après quelques références érudites sur la notion de langage, des articles plus accessibles en ligne indiquent quelles sont les limites du langage et donc l'impossibilité des mots à tout dire.
Bonjour,
La question que vous posez concerne le langage dont la fonction fondamentale consiste, pour certains, à permettre la représentation de la pensée ; pour d'autres, elle est d'abord et avant tout d'assurer la communication (Langage (fonction du), Encyclopédie Universalis, Catherine FUCHS).
Bien des philosophes, linguistes, psychologues ont étudié ces notions depuis longtemps. L'article Langage (notions de base) de Philippe GRANAROLO dans L'Encyclopédie Universalis, indique que, sur les mots et les choses,
dès la philosophie grecque, deux approches ont pu être théorisées. La première repose sur l’absence de dissociation entre les mots et les choses, la seconde sur une séparation radicale entre les uns et les autres.
La première approche prend racine dans une conception magique ou infantile du langage, ou encore dans ce qu’on a pu qualifier d’« obstacle épistémologique ».
[...]
Ces conceptions magiques, infantiles, ou préscientifiques, ont connu en Grèce une forme de théorisation avec les philosophes cyniques. Antisthène (env. 440-env.-370 av. J.-C.) a poussé à sa limite cette conception où langage et réalité se confondent.
[...]
À l’opposé, nous trouvons l’hypothèse d’une séparation radicale entre les mots et les choses. Elle suppose une réalité découpée en catégories d’objets distincts avant même que nous les nommions. Cette illusion est à la fois démentie par la philosophie – qui montre que la réalité est fonction du sujet percevant – et par la linguistique – qui montre comment les langues découpent chacune à leur façon la « réalité », mettant par exemple en évidence les diverses façons dont les langues de la planète ont divisé l’arc-en-ciel tantôt en deux, tantôt en trois, tantôt en sept couleurs, affectant à chacune un nom particulier.
Ces deux conceptions s’expliquent par la méconnaissance du processus de la signification, découvert par Platon (env. 428-env. 347 av. J.-C.). On peut lire dans le beau dialogue Cratyle, que le philosophe consacre au langage cette affirmation : « Il est possible de parler faux. » Platon rejette en effet la thèse des cyniques et celle des sophistes. Pour lui, le langage marque à la fois notre distance par rapport à l’être et notre proximité par rapport à lui. Il est un instrument, insuffisant certes, mais indispensable, qui ouvre sur une autre dimension que lui-même. Le langage « signifie » au double sens d’« être le signe de » et de « dire le sens de ». En tant que signe, il est insuffisant, puisqu’un même mot peut désigner une infinité de choses. Mais en tant qu’il vise le sens, il est riche, puisqu’il dit l’essence, l’unité des choses multiples. De fait, la véritable naissance de la philosophie est indissociable de ces réflexions sur la signification, qui seront reprises par Aristote, le disciple de Platon.
Au XXe siècle, ces deux dimensions (signe et sens) du langage, vont être étudiées par le linguiste Roman Jacobson (1896-1982) qui va ajouter une nouvelle complexité en mettant en évidence la pluralité des fonctions du langage, ou plus précisément de la communication. A la même époque, avec Ferdinand de Saussure (1857-1913), la linguistique interroge la notion de « langue ».
La parole, parce qu’elle est individuelle et largement insaisissable, ne doit pas préoccuper le linguiste, qui va concentrer son attention sur la « langue ». Qu’est-ce que la langue ? « C’est à la fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble de conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette faculté chez les individus », écrit Saussure dans son Cours de linguistique générale (publié après sa mort, en 1916). Il ajoute que la langue est « un trésor déposé par la pratique de la parole dans tous les sujets appartenant à une même communauté […] La langue n’est complète dans aucun, elle n’existe parfaitement que dans la masse ».
Source : Langage (notions de base), Philippe GRANAROLO, Encyclopédie Universalis
Par la suite, deux grands courants vont défendre la fonction communicative du langage : les théories de l'énonciation d'une part avec les travaux d'Émile Benveniste et d'Antoine Culioli, la théorie pragmatique des actes de langage d'autre part, avec John Austin, John Searle, Peter Strawson.
C'est avec le linguiste Gustave Guillaume ainsi que les approches cognitives du langage que la dimension représentationnelle du langage a trouvé ses défenseurs les plus ardents.
En linguistique, comme en philosophie et en psychologie, la question des liens entre le langage et la pensée a en effet resurgi à la faveur du développement des sciences cognitives. Pour les tenants du paradigme classique du cognitivisme, le langage a pour fonction de permettre l'expression de la pensée et, ce faisant, la transmission d'informations à propos du monde. Dans cette approche, le langage et la pensée sont conçus comme distincts et indépendants : la pensée, qui siégerait dans un système « central » de l'esprit-cerveau, serait communicable indépendamment du moyen de transmission – et donc du langage, qui lui-même constituerait un module « périphérique » de simple entrée et sortie d'informations, au même titre que les modules de perception, ou d'action motrice. Telle est la position de Noam Chomsky, qui s'inscrit dans le cadre de ce que l'on appelle le « paradigme computo-représentationnel » : la pensée et son expression par le langage fonctionneraient comme un calcul procédant sur des symboles dont la réalité serait à la fois physique (ils seraient « inscrits » dans le cerveau) et sémantique (ils « représenteraient » le monde objectif).
La thèse de l'indépendance de la pensée vis-à-vis de la langue a été radicalement contestée par les opposants à ce « modularisme » chomskien. S'il semble difficile de soutenir, comme le font les plus engagés des « interactionnistes », que le langage serait la condition nécessaire requise pour l'exercice de la pensée, il paraît en revanche justifié d'affirmer, comme le psycholinguiste Dan Slobin, qu'il existe une forme spécifiquement humaine de pensée construite à travers le langage.
Source : Langage (fonction du), Encyclopédie Universalis, Catherine FUCHS
Ces notions érudites au sujet du langage vous donneront quelques pistes à approfondir si vous le souhaitez. Mais revenons maintenant à votre question, y a-t-il des mots pour tout dire ? Comme nous l'avons vu plus haut, F. de Saussure a écrit que la langue n’existe parfaitement que dans la masse, c'est à dire qu'il la représente comme l’émanation d’une communauté linguistique (Noam Chomsky et l'autonomie du langage, Philosciences) .
Cela rejoint ce que note la fiche Peut-on tout dire par le langage ?, Digischool.fr en conclusion du paragraphe 2) Des mots généraux qui ne restituent pas la singularité des vécus : le langage n’a pas la capacité de tout dire, il se borne à exprimer des généralités. L'autre fiche de cours, Quelles sont les limites de la communication ?, publiée sur le même site rejoint ce point de vue. Elle nous apprend qu'il y a des limites intrinsèques du langage, des limites liées aux relations humaines [et que] certaines expériences échappent à toute communication.
Voici également ce qu'indique le blog Bac philo cool dissertations, Peut-on tout dire ? :
PREMIÈRE PARTIE : LE LANGAGE NOUS DONNE T-IL LA POSSIBILITÉ DE TOUT DIRE ?
A) Première sous-partie : le langage nous donne la possibilité de quasiment tout dire.
Premier argument : Le langage nous permet de pratiquement tout dire, car le langage, contrairement à la communication animale nous donne la possibilité d’exprimer des pensées précises et abstraites. Ainsi les abeilles communiquent entre elles, et se donnent des informations très précises sur les lieux précis où elles sont censées trouver du pollen. Mais les abeilles ne peuvent pas, par contre, exprimer autre chose. Leur communication est très restreinte, alors que le langage humain a une très grande plasticité puisqu’avec lui, on peut exprimer ses sentiments (amour, chagrin, joie…) mais aussi des raisonnements complexes comme des démonstrations mathématiques très abstraites. On n’a par contre jamais vu ni les abeilles, ni d’autres animaux être férus de science, de poésie, de philosophie… Bien sur, les animaux supérieurs comme les singes, les chiens, les dauphins peuvent exprimer leurs sentiments, mais par l’intermédiaire de gestuelles et de gémissements ; alors qu’un être humain peut composer une chanson pour exprimer ses sentiments (paroles et musiques). Les animaux supérieurs ont une intelligence émotionnelle comme les êtres humains ; mais étant dépourvus de langage, ils ne peuvent exprimer des pensées abstraites comme un raisonnement philosophique ou une démonstration mathématique. Avec le langage humain ; par contre, il semble qu’on puisse aborder une infinité de types de sujets des plus pratiques ( par exemple, » j’ai faim, j’ai froid » ) aux plus abstraits (résolution de problèmes mathématiques complexes, raisonnement philosophique comme dans la Critique de la Raison Pure où Kant montre et démontre que les cadres a priori de la perception sont l’espace et le temps).
Deuxième argument : Le langage nous permet quasiment de tout dire, car il nous offre la possibilité d ‘évoquer des choses inexistantes, disparues, qui ne sont plus (passé) ou qui ne sont pas encore (futur). Le langage nous permet donc d’aller dans toutes les dimensions du temps. Ainsi, en histoire, on peut évoquer les âges antérieurs de l’Humanité, et en science-fiction, on peut imaginer les scénarios de la société future. Les animaux qui n’ont pas de langage sont contraints de toujours vivre dans le présent ; ils sont rivés au présent. Par contre, nous, les êtres humains, nous sommes dans l’épaisseur du temps, la durée et pas dans l’instantanéité pure des animaux, ou que recherchent certains bouddhistes (ils cherchent à être dans la spontanéité de l’instant), et tout ceci grâce au langage.
Le langage nous permet aussi d’évoquer des choses imaginaires comme une sirène par exemple, où on mélange un corps de femme à un corps de poisson, ou encore un griffon où l’on associe le corps d’un aigle avec celui d’un lion. Avec le langage, on peut aussi parler d’une chose qui n’est pas là comme le montrait Abélard avec sa formule célèbre « Nulla rose est » ; il n’y a pas de rose. Abélard disait en substance : je peux évoquer ce qui fait l’essence de la rose, grâce au mot qui la signifie sans que pour autant il y ait présentement dans ma perception une rose réelle. Le langage a tellement le pouvoir de tout dire qu’il permet à l’homme d’inventer des mondes qui ne sont pas là comme dans les livres d’Héroïque Fantasy. Le langage nous permet de dépasser la réalité par la fiction.Troisième argument : Le langage permet de pratiquement tout dire, car il permet d’élaborer des raisonnements. Ainsi dans le langage, il y a des connecteurs logiques pour étayer une démonstration scientifique ou philosophique comme « mais, car, cependant, c’est pourquoi …. » Ainsi le langage nous permet de suivre les étapes d’un raisonnement.
Quatrième argument : Le langage nous donne la possibilité d’une grande souplesse pour évoquer le monde qui nous environne et nos sentiments par le biais de la poésie. Ainsi le poète retravaille la langue pour la faire chanter, et il peut même inventer des noms comme quand Rimbaud dans le poème les « Poètes de sept ans, » invente le verbe s’illuner pour évoquer la lumière de la lune, verbe composé à partir d’ autres verbes préexistants en français, le verbe ensoleiller et le verbe illuminer.
Le critique littéraire Roland Barthes disait d’ailleurs qu’en poésie, le mot « acquiert une dimension encyclopédique ». C’est à dire que l’auteur utilise le mot au sens propre et figuré en même temps : Par exemple, Éluard, dans un de ces poèmes dit que « La Terre est bleue comme une orange » ; il y a là un jeu de mots et d’images autour du mot « orange » qui désigne ici en même temps et le fruit, et la couleur. Prenons un autre exemple, avec le poète Jouve : « Dans la rivière, il y a une chanson qui coule »… Le verbe couler est aussi utilisé simultanément au sens propre et au sens figuré. Avec la poésie, le langage semble pouvoir tout dire, jusqu’à nos sentiments les plus intimes.
B) DEUXIÈME SOUS-PARTIE : MAIS LE LANGAGE NE NOUS DONNE QUAND MÊME PAS LA POSSIBILITÉ DE TOUT DIRE.
Premier argument : Le langage ne nous donne pas la possibilité de tout dire, car chaque individu ne parle qu’un nombre restreint de langues. Or, chaque langue véhicule une conception différente du monde. Pour pouvoir tout dire, il faudrait donc être capable de parler toutes les langues du monde. Or, il y en a plusieurs milliers, il est donc impossible de pouvoir tout dire, car chaque individu est limité à quelques systèmes linguistiques, c’est à dire à quelques visions possibles du monde, mais n’a pas la possibilité de toutes les connaître. Ainsi chaque langue ne se focalise pas sur les mêmes choses. En anglais, on fait passer les adjectifs avant les noms, en français sauf exceptions, c’est l’inverse. L’anglais dit par exemple : a grey cat, et le français dit : un chat gris. Aussi, l’anglais est une langue où on prête d’abord attention aux détails, alors qu’en français, la langue fait passer le nom général avant les adjectifs détaillant la réalité. Cet attachement aux détails fait que les systèmes scolaires de langue anglaise ont des programmes plus pratiques et empiriques que les systèmes scolaires de langue latine où l’enseignement est plus théorique que pratique. Cela est une répercussion de la langue. En plus, il y a des systèmes linguistiques, comme le hongrois et le wolof, où on ne distingue pas le pronom personnel à la troisième personne par la distinction genre masculin /féminin (comme en français où il y a: il ou elle) ; mais on distingue genre animé/inanimé ou encore genre humain/ non-humain. C’est une autre manière de découper la réalité qui se présente à nous dans ces langues. Selon les pays, on n’a pas le même vocabulaire, car les populations n’ont pas les mêmes besoins. Par exemple, dans une langue esquimaude on a comptabilisé jusqu’à 46 mots pour distinguer toutes les nuances de blanc. En français, on ne trouve pas une telle richesse de vocabulaire pour évoquer cet aspect de la réalité. Parler dans telle ou telle langue, ne permet pas de tout dire, mais de dire les choses dans un moule particulier, dans un « prêt à penser » linguistique.
Deuxième argument : L’homme n’a pas la possibilité de tout dire par le langage , car les mots sont généraux et les choses singulières. Ceci a notamment été démontré par Bergson dans son livre la Pensée et le Mouvant. Dans cet ouvrage, Bergson déclare : « le langage nous fait croire à l’invariabilité de nos sensations ». Ainsi pour chaque type de sensation, nous ne disposons que d’un nombre restreint d’expressions, et de ce fait, on finit par croire que chaque sensation quand elle se présente, est semblable à celle que nous avons connues précédemment. Par exemple, pour dire « j’ai soif » en français, on ne dispose que d’un nombre restreint de formules comme « j’ai soif », « À boire ! ». À force d’utiliser toujours les mêmes formules quand j’ai soif, je finis par croire que de même mes sensations de soif sont identiques, alors que d’une fois à l’autre, la sensation de la soif peut être assez variable. Comme les mots ne changent pas beaucoup à chaque fois que j’évoque la sensation de soif, je finis par croire aussi que la sensation elle-même est fixe d’une fois sur l’autre.
Troisième argument : L’homme n’a pas la possibilité de tout dire, car jamais on ne connaît de manière totale et parfaite même sa langue natale. Ainsi en français, un individu étant doté d’un niveau de langue moyen ne connaîtra qu’environ six mille à sept mille mots de vocabulaire ; les linguistes, par contre, ont constaté que les plus grands écrivains de la langue française comme Hugo, Balzac, Zola disposaient d’un vocabulaire d’environ 40 000 mots. Mais même un grand écrivain ne pourra pas tout connaître dans la mesure où il existe des répertoire de mots dans toute langue plutôt propres à tel ou tel métier, par exemple on a un vocabulaire spécialisé en médecine, chez les marins, etc… C’est pourquoi tout individu s’il parcourt un dictionnaire de sa langue natale découvrira des mots dont le sens lui est inconnu, voire des mots dont il n’a jamais entendu parler.
Bonne journée.



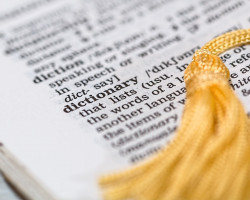
 French Theory
French Theory