Shakespeare a-t-il influencé le vocabulaire français ou bien s'en est-il inspiré ?
Question d'origine :
Shakespeare et le vocabulaire français
On constate que certains mots utilisés pour la première fois par Shakespeare, comme addiction dans Othello, présentent des ressemblances avec des termes français. Cette proximité fait naître une interrogation : ces mots similaires résultent-ils d’une influence directe de l’auteur anglais sur notre langue, ou bien Shakespeare s’est-il lui-même inspiré de vocabulaire déjà présent en français ? En d’autres termes, dans cette circulation lexicale entre les deux langues, qui a nourri qui, et dans quel sens l’influence s’est-elle réellement exercée ?
Un grand merci d’avance pour votre éclairage !
Réponse du Guichet
Avec l'arrivée de Guillaume le Conquérant, le français devient la langue officielle du Royaume d’Angleterre ainsi que la langue de tout écrit publié en Angleterre et ce jusqu'au début du XVe siècle. Vers 1400, c'est une langue profondément transformée par le français qui revient au pouvoir. De plus, la Renaissance constitue une deuxième phase d'importation des mots français dans la langue anglaise, illustrée par le corpus lexical de l'oeuvre de Shakespeare, qualifié par certain d'auteur multilingue.
L'oeuvre shakespearienne puise en effet sa richesse inouïe dans les dialectes provinciaux, le jargon des métiers mais aussi les locutions étrangères et notamment françaises. De nombreuses pièces historiques de Shakespeare évoquent les conflits franco-britanniques et comportent des scènes se déroulant en France avec des personnages français dialoguant entre eux.
Le français dans la pièce Henry V apparaît ainsi comme un hybride devant autant à la communauté huguenote londonnienne qu’à des restes du passé anglonormand. Cette hybridation est au coeur du projet politique d'Henri V (premier roi à encourager un nationalisme linguistique) tout autant que du projet linguistique de Shakespeare, entre conquête linguistique et accueil des mots de l'étranger, de l'altérité.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir si le lexique du corpus littéraire du dramaturge et poète anglais Shakespeare (1564-1616) est influencé par la langue française ou inversement.
Anthony Lacoudre, auteur de L’incroyable histoire des mots français en anglais, revient sur l’évolution de la langue de Shakespeare et la manière dont elle fut intimement transformée par le français. Lors d'une interview dans le journal du Figaro du 15 septembre 2019, Anthony Lacoudre expliquait l'histoire de l'influence française sur la langue anglaise. Avec l'arrivée de Guillaume le Conquérant, le français devient la langue officielle du Royaume d’Angleterre ainsi que la langue de tout écrit publié en Angleterre et ce jusqu'au début du XVe siècle. Lorsque progressivement l’anglais remplace le français comme langue du royaume d’Angleterre vers 1400, c'est une langue profondément transformée par le français qui revient au pouvoir. De plus, à la Renaissance, on constate une deuxième phase d'importation des mots français dans la langue anglaise, illustrée par le corpus lexical de l'oeuvre de Shakespeare intégrant une centaine de mots français :
Avant l’arrivée de Guillaume le Conquérant, il n’y avait pas un seul mot de français et très peu de mots latins dans ce qu’on appelle le «Old English». Guillaume le Conquérant imposa le français comme la langue de la Cour et du gouvernement. Après avoir massacré l’aristocratie anglaise, il confisqua toutes leurs propriétés pour les redistribuer à des barons normands. L’intégralité des terres anglaises passa entre les mains de personnes qui parlaient français. C’est alors qu’il devint la langue de l’élite, du commerce, de la communication, de l’école. Et la devise de la monarchie anglaise: «Dieu et mon droit». Richard Cœur de Lion, qui contrôle les deux tiers du territoire français, ne parlait pas un mot d’anglais alors qu’il était roi d’Angleterre ! Il est d’ailleurs enterré en France, à l’Abbaye Royale de Fontevraud, près de Chinon. Le français fut la langue officielle du Royaume d’Angleterre ainsi que la langue de tout écrit publié en Angleterre, privé ou public, et ce, jusqu’à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. [...]
Naturellement, pendant cette période où les «French kings» dirigèrent l’Angleterre, cette langue se transforma et absorba environ 10 000 mots français. En parallèle, ceux qui voulaient s’élever socialement apprenaient le français. Ainsi, lorsqu’il s’agissait de trouver un nouveau mot en vieil anglais, par exemple pour désigner un concept importé par les Normands, c’est tout naturellement vers le français que l’on se tournait. Parmi les tout premiers mots français importés par les Normands, on peut citer : «âge», «art», «cardinal», «cousin», «crime», «dialogue», «dragon», «fruit», «miracle», «prison», «silence»... Lorsque progressivement l’anglais remplace le français comme langue du royaume d’Angleterre vers 1400, ce n’est en fait plus la même langue qui revient au pouvoir. [...]
Au cours de la Renaissance, un contingent d’environ 12 000 mots français fut incorporé dans la langue anglaise et vint compléter les milliers de mots français intégrés au Moyen Âge. On peut citer par exemple des mots comme «architecture», «dessert», «fragile», «machine», «moustache», «police», «turbulence»... Mais le contexte était tout autre. À cette époque, la France était une référence, réputée pour son excellence dans de nombreux domaines. Le prestige et la prééminence de la France intellectuelle étaient tels que dans toutes les cours, on parlait français. Peu à peu, il remplaça le latin comme langue universelle.
C’est pendant cette période qu’un certain William Shakespeare fit entrer des centaines de mots français en anglais : «agile», «apostrophe», «cavalier», «frugal», «monumental», «obscene», «pedant»… Les Anglais s’écrient souvent : «Ah, Shakespeare! Il était si inventif et créatif» Et c’est vrai : il a inventé de nombreux mots comme «amazement», «eyeball» ou «lonely».
On retrouve ainsi dans la langue de Shakespeare l'influence de l''anglo-normand, ensemble de dialectes de l'ancien français parlés dans l'Angleterre médiévale au sein de la cour royale, de l'aristocratie anglo-normande et d'une partie de la classe moyenne :
Si l'anglo-normand a disparu, il a cependant fourni à l'anglais moderne un lexique important en se fondant dans le moyen anglais. Un recensement de ces termes en a donné plus de 5 000. Par exemple, to catch, un verbe qui semble autochtone, car doté d'un prétérit et d'un participe passé irrégulier (caught), remonte en fait au normand septentrional cachier (aujourd'hui cachî en normand du Cotentin et cacher en normand du Pays de Caux ; de même étymologie que le français chasser) [Note 2].
Même des termes germaniques occidentaux et d'ancien scandinave sont passés d'abord par l'anglo-normand avant de se fondre dans l'anglais.
Source : Wikipédia
À ce sujet nous vous invitons à écouter les émissions suivantes :
- Histoire des langues : depuis Guillaume le conquérant, le français et l'anglais ne font qu'un ! (France Inter, 24 octobre 2020) :
Si l'anglais est d'abord une langue germanique, il doit une bonne partie de son lexique et de sa syntaxe grammaticale au français, depuis que le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, est monté sur le trône d'Angleterre, en 1066, après sa victoire à Hastings, exportant avec lui des milliers de mots français.
Invité de l'émission "Grand bien vous fasse" aux côtés de la linguiste Julie Neveux et l'écrivain Jean-Loup Chiflet, le lexicologue Jean Pruvost revient sur l'histoire de la formation et de l'évolution de la langue anglaise puis française, soulignant au passage ce qui fait la grande perméabilité linguistique entre les deux langages. C'est le fruit d'une histoire assez longue qui aura établi un même socle linguistique sur lequel elles reposent toutes les deux même si elles répondent à deux aires de civilisations différentes :Jean Pruvost nous rappelle que les deux langues appartiennent toutes les deux aux langues indo-européennes et que si elles finissent par acquérir leur propre spécificité, elles se sont construites ensemble depuis les bases du langage celte. En France, l'ensemble des tribus celtes (dont descendent les gaulois) se sont retrouvées nez à nez avec la vague des peuples Germains dont font partie les Francs, important leur langue germanique. En France, la langue latine reste prédominante du fait de l'expansion romaine. Toutefois les langues romanes (latines) ont davantage marqué le français, plus que l'anglais. Durant l'Antiquité, l'envahisseur romain n'est pas parvenu à imposer le latin en Bretagne et les insulaires bretons n'accueillent pas très bien Rome. Les bretons insulaires finissent par être envahis par le peuple germanique des angles et des saxons. [...]
"Le célèbre duc de Normandie [Guillaume le Conquérant] contribue à embarquer, avec lui et ses nombreux hommes, énormément de mots français en Angleterre. Beaucoup de gens de l'Eglise, de savants, de clercs le suivront, en même temps que des artisans, des guerriers, toute une population franco-normande qui part avec lui et emporte avec elle son ancien français" [...]
Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la langue anglaise, on considère que sur 60 000 mots, 60 % sont d'origine française, et non des moindres comme "Sir", "Prince", "duke", des mots disparus aussi comme "Very", mais aussi "âge", "art", "dialogue", "miracle", "prison", "silence" pour ne citer qu'eux"… C'est quelque chose qui perdurera encore jusqu'après la Renaissance, des milliers de mots anglais et français continuent à s'épouser et ce jusqu'à aujourd'hui. La langue française est celle qui aura le plus touché la langue anglaise.
- Ce que la langue française doit à l'anglais (et inversement) (France Inter, 21 octobre 2020)
L'article de l'Encyclopédie universalis consacré à William Shakespeare met l'accent sur la richesse linguistique de la langue shakespearienne, puisant dans l'héritage de la prose latine, les dialectes provinciaux, le jargon des métiers mais aussi les locutions étrangères :
Cette langue, d'abord, est d'une richesse inouïe. Seul Victor Hugo chez nous pourrait rivaliser avec cette opulence. Shakespeare drague près de quinze mille mots dans ses filets. Il les puise dans tous les domaines linguistiques : fonds commun hérité de la prose latine et du parler populaire, dialectes ruraux et provinciaux, jargon des métiers, de l'art militaire, de la navigation, de la jurisprudence, des théologiens, préciosités des courtisans et des poètes, truculences de la pègre, vocabulaire des sciences exactes ou inexactes de son temps, astronomie, médecine, alchimie, botanique, que sais-je ? locutions étrangères – il y a même une scène entière en français ! Chaque personnage parle, suivant sa condition, un langage réaliste ou stylisé, et qui, même s'il est hautement formalisé, garde le ton, l'allure, le timbre du langage parlé, the spoken word. C'est là un des traits essentiels : le naturel de la communication.
De nombreuses pièces historiques de Shakespeare évoquent les conflits franco-britanniques et comportent des scènes se déroulant en France avec des personnages français dialoguant entre eux. La pièce Henri V est, à ce titre, unique par l'importance de ses dialogues en français, comme l'a étudié L. Sansonetti, dans son étude de 2020 : “an Pettie Tanes, Ie Parle Milleur”: Speaking Foreign Languages in Shakespeare’s Henry V :
Henry V provides examples of phonetic spelling for French and English spoken by French characters (but in sounds uttered by English actors). Looking at spelling for the multinational parts of the dialogue in the 1600 and 1623 texts will enable us to understand how language, and more specifically speech, defines national identities. In the 1600 version, in which French words are not italicised and their foreignness is therefore not apparent until they are read aloud, Katherine asks Alice to give her a lesson of English in the following terms:
"Allice venecia, vous aues cates en,
Vou parte fort bon Angloys englatara,
Coman sae palla vou la main en francoy."
(Shakespeare 1600, C3r)[...]
Grammatical approximations apart, the phonetic rendition of French makes it both more alien and more English, for it serves to reproduce as accurately as possible the original pronunciation for English readers while it visually nativises foreign words by giving them an English spelling.
[...]
The spelling of “Diable” in the 1600 quarto, “diabello,” looks part French, part Italian, part Spanish, broadly Continental, a feature which expands the play’s bilingualism into a larger multilingual European context.
[...]
Multilingualism in Henry V both exacerbates and blurs national identities relying on language commonality. By featuring words and speeches in French, notably in instances of code-switching, the play enhances the mixed nature of the English language, and the dependence of England on France to determine its identity. It both creates a stereotypical representation of France through the use of linguistic clichés (stock phrases that would have been familiar to an Elizabethan audience) and provides an external viewpoint on what makes Englishness. While the French lords present their English counterparts as effeminate dancers and “Normans, but bastard Normans, Norman bastards” (3.6.10), Henry comes out as a martial leader and a British king, as well as a skilled orator able to motivate troops and to woo a French lady.
Traduction Google :
Henri V fournit des exemples de transcription phonétique du français et de l'anglais parlés par des personnages français (mais prononcés par des acteurs anglais). L'étude de l'orthographe des passages multinationaux du dialogue dans les textes de 1600 et 1623 nous permettra de comprendre comment le langage, et plus précisément la parole, façonne les identités nationales.
"Allice venecia, vous aues cates en,
Vou parte fort bon Angloys englatara,
Coman sae palla vou la main en francoy."
(Shakespeare 1600, C3r)[...]
Au-delà des approximations grammaticales, la transcription phonétique du français le rend à la fois plus étranger et plus anglais, car elle vise à reproduire aussi fidèlement que possible la prononciation originale pour les lecteurs anglophones, tout en intégrant visuellement les mots étrangers à la langue française en leur attribuant une orthographe anglaise.
[...]
L'orthographe de « Diable » dans le quarto de 1600, « diabello », semble mêler le français, l'italien et l'espagnol, dans un sens continental, ce qui inscrit le bilinguisme de la pièce dans un contexte européen multilingue plus vaste.
[...]
Le multilinguisme dans Henri V exacerbe et brouille les identités nationales fondées sur une langue commune. En mettant en scène des mots et des discours en français, notamment par des alternances de codes, la pièce souligne la nature hybride de la langue anglaise et la dépendance de l'Angleterre vis-à-vis de la France pour définir son identité. Elle crée une représentation stéréotypée de la France à travers l'utilisation de clichés linguistiques (des expressions toutes faites familières au public élisabéthain) et offre un regard extérieur sur ce qui constitue l'identité anglaise. Tandis que les seigneurs français présentent leurs homologues anglais comme des danseurs efféminés et des « Normands, mais des Normands bâtards, des bâtards normands » (3.6.10), Henri apparaît comme un chef martial et un roi britannique, ainsi qu'un orateur talentueux capable de galvaniser les troupes et de séduire une dame française.
Vous pouvez également lire à ce sujet :
“French Speech as Dramatic Action in Shakespeare’s Henry V" / Walls, Alison. Language and Literature 22.2
Traduction Google :
Dans Henri V, l'usage du français par les personnages français remplit une fonction qui dépasse la simple caractérisation de leur identité française. Cet aspect n'a pas encore été pleinement reconnu par la critique. Cet article démontre d'abord la singularité des personnages non anglais s'exprimant dans une autre langue dans les pièces de Shakespeare, et la manière dont le texte attire l'attention sur ce phénomène. Trois scènes cruciales sont analysées : incapables de communiquer pleinement, les personnages francophones sont non seulement dépeints comme vulnérables face aux personnages anglophones, mais également face au public anglophone. Ces scènes illustrent comment la langue étrangère, sur le plan dramaturgique, privilégie la physicalité du langage, soulignant ainsi la réalité corporelle du personnage/acteur. Les implications sexuelles de ce phénomène dans deux de ces scènes, et leur écho à la conquête de la France par l'Angleterre, sont également abordées. Parce que c’est le fait de parler une langue largement incompréhensible qui attire l’attention sur cette vulnérabilité d’ordre physique, la pleine résonance des grands thèmes de la pièce liés à la mortalité, à la domination et à l’identité nationale ne peut donc être pleinement réalisée que sur scène.
Dans sa thèse Les mots étrangers dans le théâtre de Shakespeare (thèse dirigée par Mme le Professeur Christine BERTHIN-MURPHY et soutenue publiquement le 19 novembre 2016 à l'Université Paris Ouest), Mylène Lacroix interroge l'emploi de mots français dans l'oeuvre de Shakespeare, à une époque où la langue anglaise est en pleine quête identitaire. La présence de la langue française (hybride de français anglo-normand et de français de la communauté huguenote londonnienne), destabilise la langue anglaise, tout en entretenant avec elle une relation souvent ludique.
Dans ses œuvres dramatiques, Shakespeare fait la part belle aux mots étrange(r)s, qu’il s’agisse de mots isolés, de phrases ou encore de scènes entières en langue étrangère. L’hétérolinguisme (Rainier Grutman) shakespearien se manifeste également par la présence dans ses pièces de variétés sociales ou régionales de l’anglais. Son importance est cependant moins quantitative que qualitative. En effet, les mots étrangers de Shakespeare font presque toujours l’objet d’une mise en scène, à une époque où la langue anglaise était elle-même en pleine quête identitaire. Leur rôle n’est jamais purement ornemental : ils déstabilisent et inquiètent la langue qui les accueille tout en entretenant avec elle une relation souvent ludique, comme en témoignent les nombreux jeux de mots interlinguistiques inventés par Shakespeare. Par ailleurs, la cohabitation des langues dans certaines de ses pièces entraîne parfois des opérations de traduction plus ou moins hasardeuses, qui font elles aussi l’objet d’une véritable mise en scène. En nous donnant à entendre les fréquents « dérapages » de la traduction, Shakespeare nous fait voir l’envers de la langue, qui court toujours le risque de devenir à son tour étrangère. [...]
On parle un peu « français » dans The Merry Wives of Windsor, en particulier en I.IV, scène dans laquelle Caius, le médecin français, fait son apparition. On parle bien plus « français » (là encore avec des guillemets) dans Henry V, où figurent notamment trois scènes bilingues : la scène de la leçon d’anglais donnée à la princesse Catherine (III.IV), celle de demande de rançon (IV.IV), illustrant la capture d’un soldat français, ainsi que la scène de séduction et de conquête venant clore la pièce (V.II.98-278). Mais qu’est-ce que le « français de Shakespeare » ? Où le dramaturge aurait-il appris cette langue et quel en était son degré de maîtrise ? Les mots et phrases français du théâtre de Shakespeare ont-ils une quelconque authenticité historique ? Ou s’agit-il au contraire d’un sabir éminemment artificiel ? Et dans quelle mesure le français que l’on peut lire dans le Folio ainsi que dans les Quartos de The Merry Wives of Windsor et de Henry V est-il d’ailleurs véritablement de Shakespeare ? J’aimerais dans les pages qui suivent revenir un peu plus en détail sur ces questions sommairement abordées dans la première partie.
Comme le rappelle Anny Crunelle 1, Shakespeare a pris pension chez les Mountjoy 2 , une famille de réfugiés huguenots originaires de France, dans les années 1602-1604. Si l’on peut imaginer que le dramaturge a pu y perfectionner son français, ce n’est en tout cas pas à cette occasion qu’il l’aurait appris, la rédaction de The Merry Wives of Windsor et de Henry V étant en effet antérieure à ce séjour 3. En revanche, « cela laisse imaginer qu’il n’est pas étranger à la chose française 4 ». Selon John Doherty, l’influence de Richard Field sur le français de Shakespeare paraît bien plus probable 5. Originaire de Stratford et probable camarade d’école du jeune William, Field était apprenti, à partir de 1579, chez le Français Thomas Vautrollier, un imprimeur huguenot dont il épousera la veuve Jacqueline Vautrollier, elle-même française, à la fin des années quatre-vingt. « Vautrollier s’est spécialisé dans les ouvrages liés à la France », explique Anny Crunelle. [...]
Il est tout à fait vraisemblable, par ailleurs, que le « français de Shakespeare » provienne également de sources livresques. Anny Crunelle rappelle en effet que Richard Field imprimait notamment des manuels de français tels que The Frenche Littleton (1591) de Claude de Sainliens ou Ortho-epia Gallica (1593) de John Eliot. Or « la leçon d’anglais d’Henry V reproduit les méthodes et le contenu [de tels] manuels de langue 9 », de la même façon que certains énoncés de Caius, truffés de « synonymes interlinguaux 10 » (par exemple « I ha married oon Garsoon, a boy; oon pesant »), pastichent les dictionnaires bilingues de l’époque. Parmi ces sources plausibles, Shakespeare se serait par exemple probablement servi de l’Ortho-epia Gallica d’Eliot pour apprendre le français en autodidacte, d’après Stuart Gillespie 11. [...]
Cependant, ces contacts possibles avec le français ne nous permettent certainement pas d’affirmer que Shakespeare avait de cette langue une connaissance approfondie, ni même qu’il était capable de la parler. Pour Stuart Gillespie, le niveau de français de Shakespeare, comme celui de nombreux Anglais (et en particulier de Londoniens) de l’époque, était seulement « passable 13 ». [...]Il est bien connu, par exemple, que le genre grammatical des substantifs français constitue une difficulté majeure pour les anglophones 19. Shakespeare (ou son typographe) n’échappe pas à cette règle lorsqu’il fait de « bras », de « menton » et de « col » (c’est-à-dire « cou ») des mots féminins et de « robe » et « main » des mots masculins (ce dernier, notamment, est toujours féminin chez Eliot). [...]
D’après Anny Crunelle, si ces irrégularités sémantiques et syntaxiques sont « étrangère[s] au français continental, elle ne [le sont] pas au « français d’Angleterre », encore appelé anglo-normand ou anglo-français 24 », variété de français parlée et écrite en Angleterre du XIIe au XIVe siècle inclus. « C’est dans ce corpus, ajoute Anny Crunelle, que s’alimente le français de Catherine 25. » Dans un intéressant article intitulé « ‘Fause Frenche Enough’: Kate’s French in Shakespeare’s Henry V 26 », Anny Crunelle démontre en effet qu’un certain nombre des prétendues fautes de français de Catherine constituent des tournures attestées et recevables en « français insulaire ». D’un point de vue morphosyntaxique, l’anglo-normand tardif se distingue notamment par un certain relâchement en ce qui concerne le marquage du genre grammatical 27. Ce serait peut-être là que la confusion, dans Henry V, entre « la main » et « le main » trouverait par exemple sa source. [...]
Anny Crunelle a raison de soutenir que « le français dans Henry V est un hybride qui doit autant à Claude de Sainliens et à la communauté huguenote qu’à des restes du passé anglonormand de la langue 40 ». Nous verrons plus loin dans quelle mesure cette hybridation joue un rôle clé dans le projet politique de Henry V, dans le projet linguistique de Shakespeare, mais aussi dans la viabilité scénique et comique des scènes bilingues de la pièce. [...]
Premier roi anglais à encourager une forme de nationalisme linguistique en promouvant l’anglais en tant que langue officielle 8, le roi Henry V historique tenta en quelque sorte de renverser ce rapport de force séculaire en jouant un rôle clé dans le déclin du français dans l’Angleterre médiévale. Shakespeare rejoue d’une certaine façon ce rapport de force dans son épopée à la gloire de l’Angleterre, notamment lorsqu’il fait dire à la princesse française Catherine : « Il faut que j’apprenne à parler 9 » (sous-entendu : l’anglais 10). Cette scène est d’autant plus comique, du point de vue anglais (et « tragique », du point de vue français), qu’elle est improbable. Ce « il faut » semble suggérer que Catherine agit par devoir plutôt que de son propre chef 11. Cette scène est fréquemment interprétée comme une capitulation anticipée : une capitulation sexuelle, politique, mais également (et peut-être même avant tout) linguistique. [...]
Si la « leçon d’anglais » met en scène la conquête linguistique, militaire mais aussi sexuelle de Catherine, qui personnifie à la fois la France et la langue française 164, elle laisse également entrevoir le potentiel de déstabilisation de la langue du conquérant par la langue des conquis. Les jeux de mots involontaires de Catherine ont beau nous faire rire, la scène de la leçon de langue, profondément idéologique, n’en contient pas moins des sous-entendus foncièrement sinistres – pour Katherine Eggert, la principale fonction de cette scène consiste à préfigurer le « viol militaire 165 » que Henry s’apprête à faire subir à la France. Pour autant, nous avons vu que la langue en apparence dominée menace régulièrement d’ébranler l’hégémonie de l’anglais à laquelle aspire son porte-parole Henry 166
Et l'autrice de conclure sa thèse sur le sens de ces collisions linguistiques :
Comme nous avons pu le voir, l’étranger habite à tel point la langue de Shakespeare que certains vont jusqu’à le qualifier d’auteur multilingue. Son théâtre accueille les mots de l’étranger et, bien souvent, se les approprie. Leur présence diffuse, tout comme la présence de scènes entières rédigées en langue étrangère, semble en elle-même constituer une forme de résistance au monolinguisme (supposé) de l’anglais. À la lecture des pièces de Shakespeare, on ressent véritablement le plaisir qu’a pu prendre le dramaturge à recevoir chez lui, dans « sa » langue, la parole de l’étranger. Les jeux de mots interlinguistiques sont un témoin privilégié de ce « plaisir de recevoir », du bonheur ludique de l’entrelacement des langues. [...]
S’il accueille volontiers les mots de l’étranger, le théâtre de Shakespeare se fait aussi l’écho des maux de l’étranger 366. Il met en effet en scène plusieurs formes de souffrance linguistique. Celle de la « langue d’accueil », tout d’abord, qui ne sort jamais tout à fait indemne de sa collision avec la langue de l’autre. Les scènes bilingues d’Henry V associent presque systématiquement la promiscuité des langues à une certaine violence : la scène des quatre nations menace de tourner au pugilat ; la leçon d’anglais procède au démembrement symbolique du corps de la princesse Catherine, qui fait elle-même violence aux mots appris en en détournant le sens ; l’incompétence linguistique de Pistol et du soldat français exacerbe la pugnacité de l’un et accélère la soumission de l’autre ; la scène de séduction, enfin, nous donne à voir une jeune femme certes « obligé[e] de se plier aux contraintes d’une langue et d’une culture qui ne sont pas les siennes et qui l[a] maintiennent dans une position de domination367 », mais qui fait à son tour subir une certaine violence à la langue de l’ennemi, qu’elle « massacre » allégrement (« [she] hack[s] our English », dirait l’hôte de la Jarretière). [...]
S’il est vrai que les pièces de Shakespeare nous incitent à nous interroger sur les conséquences de toute forme d’oppression linguistique, il me semble par ailleurs qu’elles prennent globalement position en faveur d’une certaine bienveillance et tolérance envers les exilés linguistiques, d’une part, et les mots de l’étranger, de l’autre. Le message de tolérance et d’hospitalité véhiculé dans un certain nombre des pièces de Shakespeare nous invite également à partager (et à compatir avec) les maux de l’étranger, pris pour cible par les personnages « xénophobes » de Shakespeare.
Le plurilinguisme dans l'oeuvre de Shakespeare a aussi été étudié par Amina Askar dans Le plurilinguisme dans l’œuvre de Shakespeare : l’affrontement entre les langues régionales et dialectales et le discours dominant de l’anglais du roi pendant la Renaissance anglaise. Littératures classiques, 87(2), 49-62 (2015) :
En conclusion, nous pouvons donc affirmer que l’œuvre de Shakespeare se nourrit essentiellement de son plurilinguisme. Plurilinguisme de son époque d’abord, qui s’attelait à créer un idiome homogène, capable de donner une identité consolidée à la nation anglaise, mais qui restait néanmoins fasciné par la richesse des langues mineures, perçues comme des figurations de l’altérité. Plurilinguisme des personnages dramatiques qui parlent de mille et une voix et donnent aux pièces leur force polyphonique. Plurilinguisme enfin d’une profonde ambivalence politique qui aspire à l’homogénéisation du royaume, mais qui ne peut (et ne veut) pas empêcher que subsistent ces langues mineures qui disent la violence de tout système de pouvoir.
Pour aller plus loin, voici des documents à retrouver dans nos collections :
Shakespeare [Livre] : la biographie / Peter Ackroyd ; traduit de l'anglais par Bernard Turle, 2015
3 minutes pour comprendre la vie et l'oeuvre de William Shakespeare [Livre] / rédactrice Ros Barber, 2015
Shakespeare's langage [Livre] : an introduction / Norman Francis Blake, 1983
Théâtre complet [Livre] : tragédies, comédies, pièces historiques, dernières pièces / William Shakespeare ; traduit de l'anglais par François Guizot, 2016
Histoire de la langue anglaise [Livre] / Sylvie Hancil, 2013
La langue des rois au Moyen Age [Livre] : le français en France et en Angleterre / Serge Lusignan
Bien à vous



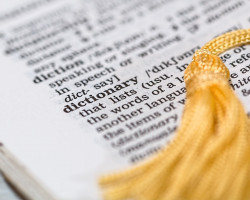
 Combats de fille
Combats de fille