Question d'origine :
Les livres de littérature érotique sont appelés des "curiosa".
Peut-on situer à quelle époque et par qui fut généralisé cette appellation ?
Réponse du Guichet
Le 17/07/2007 à 13h02
CURIOSA : nom féminin pluriel (XIXème; empr. au latin curiosus au féminin pluriel=curieux).
Voici l'article de Gilles Firmin, extrait du Dictionnaire culturel en langue française, d'Alain Rey, relatif à "curiosa" :
Formé à partir d’un pluriel neutre latin, le terme curiosa est, avec judaica, varia et ana, une rubrique latine que l’on trouve encore dans les catalogues de libraire. Les mots français curieux et curiosités ont vu leur champ s’élargir considérablement au XIX ème siècle, comme en témoignent des titres comme les Curiosités esthétiques de Baudelaire (1868), les Causeries d’un curieux de Conches (1864-1867) ou la création de l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux (1864). L’adjectif curieux y prit même parfois le sens de voyeur : le curiosus latin pouvait déjà signifier « indiscret » et des titres associant la sexualité et la curiosité, comme les Mémoires curieux sur la prostitution du bibliophile Jacob (1854), expliquent sans doute comment curiosa en est venu à désigner ce qui relève, au sens propre, des erotica.
Cependant, il s’agit d’une restriction fâcheuse du sens de curiosa qui , à l’origine, ne portait pas sur la seule curiosité supposée « malsaine » : ainsi, dans son Curiosa. Essais critiques de littérature ancienne, ignorée ou mal connue(1887), le polygraphe Alcide Bonneau ne traite pas seulement de littérature légère ; y figurent, certes, ses notices sur La nuit et le hasard et Le hasard au coin du feu de Crébillon, ou sur le fort savant Manuel d’érotologie classique de Forberg ; mais on y évoque aussi l’ Advis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudé, les Deux dialogues du langage François italianisé d’Henri Etienne et le Traité de la Donation de Constantin de Laurent Valla, textes on ne peut plus sérieux. Sur les quarante-quatre notices de l’ensemble, les sujets scabreux sont les plus représentés, mais le point commun de ces « curiosités littéraires », ce « dessert de l’esprit, après le repas substantiel des maîtres »(selon la définition que Bonneau reprend à Paul de Saint-Victor), est plutôt de présenter une littérature que, d’Erasme à Restif de la Bretonne, on pourrait définir comme « contestataire ».
Illustration sur vignettehaute.com
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



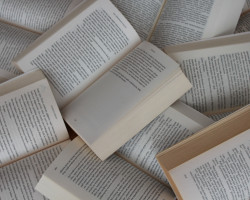
 Une simple intervention
Une simple intervention