Question d'origine :
bonjour,
une question que je me suis toujours posé...
un aimant naturel crée un champs magnétique tout autour de lui.
Mais alors pour le créer lui faut il de l'énergie pour çà et d'où la tire t il?
le cas échéant dans le cas d'aimant naturel de quelques millions d'années, en a t il toujours?
bien à vous.
Réponse du Guichet
Le 30/10/2013 à 10h11
Eh oui, il faut de l' « énergie » pour réorienter les « domaines » dans le même sens. Dans le cas d'aimants artificiels, cette « énergie » est apportée en utilisant des champs magnétiques créés dans des spires.
Un aimant permanent se fabrique en plaçant un matériau magnétique, dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands, dans un champ magnétique puissant. On obtient alors l'aimantation d'un aimant. Ce procédé permet de produire des aimants permanents.
Les atomes qui forment les matériaux facilement magnétisables comme le fer, l'acier, le nickel et le cobalt sont disposés en petites unités appelées domaines. Chaque domaine, même de dimension microscopique, contient des millions de milliards d'atomes et chaque domaine agit comme un petit aimant.
Les composés qui entreront dans la composition de l'aimant sont d'abord extraits de minerais. Ensuite, ils sont dosés, mélangés et calcinés pour finalement donner le matériau recherché. Ce matériau brut est ensuite concassé, puis broyé en une fine poudre. Cette poudre est ensuite pressée en présence d'un champ magnétique, dont elle s'imprégnera. La prochaine étape est le frittage, qui consiste à agglomérer la poudre en la chauffant, mais sans la faire fondre. Il ne reste qu'à le refroidir à l'aide de jets d'air : c'est la trempe. Il peut ensuite être enduit d'une couche protectrice de zinc, de nickel ou de résine d'époxy. L'aimant est prêt à être utilisé.
source : Les aimants de Saint-Pierre : une usine en Pays d'Allevard, sous la direction d'Evelyne Bosch-Camilleri.
Les pages 42-44 donnent de plus amples renseignements sur la fabrication des différentes familles d'aimants.
Par aimantation rémanente nous entendons cette aimantation «fossile» qui persiste après la disparition du champ magnétique qui l'a fait naître, et qui se distingue donc de l'aimantation induite, celle-ci ne pouvant exister qu'en présence d'un champ magnétisant. L'aimantation rémanente des roches se décompose en deux catégories :
1) Aimantation primaire,
2) Aimantation secondaire.
une roche contenant des minéraux magnétiques acquiert, lors de sa mise en place, une aimantation rémanente (dite «aimantation primaire») dirigée parallèlement au champ magnétique terrestre de l'époque en question. Cette aimantation primaire s'impose, soit pendant le refroidissement d'une roche ignée au-dessous du point curie de ses minéraux magnétiques (alors que nous parlons d'aimantation thermorémanente), soit pendant la croissance des minéraux magnétiques dans une roche en cours de diagenèse ou métamorphisme
Cette aimantation secondaire est dirigée tantôt selon le champ magnétique actuel, tantôt arbitrairement; ayant été acquise à des températures modérées et sans remaniement important de la roche, elle est en général moins stable que la composante primaire, et se laisse le plus souvent enlever par une technique de désaimantation.
source : Paléomagnétisme du Permine d'Amasra (Anatolie du Nord)
L'aimantation des aimants naturels dépend de leur composition chimique, de l'organisation des molécules les composant, ainsi que de la forme de l'aimant confectionné. Ces différents paramètres expliquent que nous n'avons pas trouvé de sources fiables donnant une durée de vie pour les aimants naturels.
Dans un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique, la température de Curie, ou point de Curie, est la température à laquelle le matériau perd son aimantation spontanée. Au-dessus de cette température, le matériau est dans un état désordonné dit paramagnétique. Cette transition de phase est réversible ; le matériau retrouve ses propriétés ferromagnétiques quand sa température redescend en dessous de la température de Curie. En revanche il a perdu son aimantation, même s'il peut être à nouveau magnétisé.
Cette température caractéristique tire son nom de Pierre Curie, le physicien français qui l'a découverte en 1895.
Par analogie, on parle également de température de Curie dans les matériaux ferroélectriques pour désigner la température de transition entre les phases paraélectrique et ferroélectrique. Cette température est habituellement marquée par un maximum de la constante diélectrique.
source : Wikipédia
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



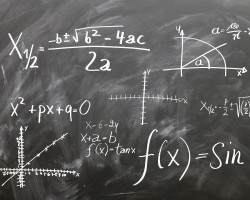
 Oh les belles collections !
Oh les belles collections !