Lettres Qui le premier a écrit « la forme, c’est le fond » ?
LANGUES ET LITTÉRATURES
+ DE 2 ANS
Le 15/01/2013 à 12h22
1222 vues
Question d'origine :
Question littérature :
Quel est, le premier, l’auteur de la maxime : « la forme, c’est le fond » ?
Parfois attribuée à Goethe, mais sont aussi fréquemment pressentis Victor Hugo, Paul Valéry (on ne prête qu’aux riches… !), la référence fait défaut.
La lecture récente de la correspondance de Gustave Flaubert m’a permis de trouver parmi ses lettres à Louise Colet notamment celles écrites entre 1846 et 1853, des éléments qui me sont apparus nettement probants. Bien que je ne sois pas à même d’affirmer leur caractère originel, ces éléments permettent tout à la fois d’exclure Paul Valéry qui est né en 1871, ainsi que l’extrait tiré des « Proses Philosophiques – 1860/1865 » [« Le Goût »] de Victor Hugo, même s’ils laissent encore en lice des œuvres antérieures de ce dernier et de Goethe qui avaient déjà beaucoup écrit l’un et l’autre, mais que je n’ai pas (re-)lu intégralement.
Sur le fond (sic !), bien que la formulation diffère, Nicolas Boileau est aussi un candidat, lui qui, dès 1674, dans « l’Art poétique », délivrait en vers ces judicieux conseils didactiques :
- « Quelque sujet qu’on traite, ou plaisant, ou sublime,/Que toujours le bon sens s’accorde avec la rime:/L’un l’autre vainement ils semblent se haïr ;/La rime est une esclave, et ne doit qu’obéir./Lorsqu'à la bien chercher d'abord on s'évertue,/L'esprit à la trouver aisément s'habitue ;/Au joug de la raison sans peine elle fléchit,/Et, loin de la gêner, la sert et l'enrichit./Mais, lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle,/Et, pour la rattraper, le sens court après elle./Aimez donc la raison : que toujours vos écrits/Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix. » (Chant I, lignes 27-38) ;
- « Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile,/Et ne vous chargez point d'un détail inutile./Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant ;/L'esprit rassasié le rejette à l'instant./Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. » (Chant I, lignes 59-63) ;
- « Avant donc que d'écrire, apprenez à penser./Selon que notre idée est plus ou moins obscure,/L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure./Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,/Et les mots pour le dire arrivent aisément. » (Chant I, lignes 150-154) ;
- « Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,/Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage:/Polissez-le sans cesse et le repolissez ;/Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » (Chant I, lignes 171-174).
Peut-être convient-il de ne pas écarter Horace qui, une vingtaine d’années avant Jésus-Christ, déclamait en hexamètres dans son « Épître aux Pisons » : « La raison, voilà le principe et la source de l’art d’écrire : tu trouveras les idées dans la philosophie de Socrate. Quant tu la posséderas bien, les mots n’auront pas de peine à suivre » (vers 310-311).
Aussi, je vous livre les fruits recueillis de cette enquête qui reste à parfaire.
Gustave Flaubert (1821-1880),
- A Louise Colet. 18 septembre 1846
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1980 p. 350 Lettre 143
- A Louise Colet. 16 janvier 1852
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980 p. 30 Lettre 304
- A Louise Colet. 16 janvier 1852
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980 p. 31 Lette 304
- A Louise Colet. 8-9 mai 1852
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980 Lettre 320
- A Louise Colet. 15-16 mai 1852
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980 p. 91 Lettre 321
- A Louise Colet. 29 mai 1852
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980, p. 96 Lettre 323
- A Louise Colet. 27 mars 1853
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980 Lettre 378
- A Louise Colet. 26 août 1853
In « Correspondance », éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980 p. 421
Victor Hugo (1802-1885)
Œuvres complètes. Critique, Robert Laffont, éd. Jean-Pierre Reynaud, coll. Bouquins, 2002
In « les Proses philosophiques – 1860/1865 », [« Le Goût »], p. 575
Réponse du Guichet
Le 18/01/2013 à 13h47
Votre question est complexe car, à la première recherche sur internet, nous trouvons que la phrase originale serait :
La forme, c’est le fond qui remonte à la surface
Voir : Louis Volont.
La citation n'est pas de Goethe car ce qui se rapproche le plus est :
La dignité de l’art apparaît peut-être à son plus haut degré dans la musique, parce qu’elle n’a point de matériaux dont on soit obligé de tenir compte. Elle est tout entière forme et fond. D’ailleurs, elle élève et anoblit tout ce qu’elle exprime.
(Maximes et réflexions (Première partie), trad. Sigismond Sklower, p.10, Brockhaus et Avenarius, 1842)
Cependant une recherche plus approfondie a permis de trouver sur le site consacré aux citations de Victor Hugo, où il est indiqué : Ce recueil de citations présente les contributions des internautes qui étaient invités à envoyer, tout au long de l’année 2002, leurs citations préférées. Ces citations ont toutes été vérifiées par l’équipe de la coordination avec le concours d’universitaires spécialistes de Hugo avant leur mise en ligne.
que la citation est celle-ci :
Victor Hugo : Extrait de "Utilité du beau" - Proses philosophiques de 1860-65.
La lecture de ce texte (Utilité du beau) montre qu'au 11° paragraphe on a les termes inversés, ... et quelques paragraphes plus loin, on a bien l'autre formulation !
Mais, parce que la pensée d'Hugo est riche, il est intéressant de lire, toujours dans les Proses philosophiques, le texte sur le goût... : les concepts s'entremêlent.
Nous vous le joignons et vous en souhaitons bonne lecture.
Pièces jointes
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



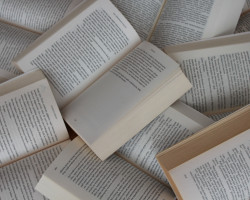
 Clones et prophètes
Clones et prophètes