Question d'origine :
Bonjour GdS,
- Adj. "hébreu" au féminin : Peut/Doit-on dire/écrire "la langue hébreu", "hébreue", ou "hébreuse" (merci de distinguer le possible admis de la règle correcte) - et dito au féminin pluriel ? ;
- Subst. "hiéroglyphe" : La liaison/élision est-elle possible, ou le h (ou l'h ? merci de répondre aussi à cette question) est-il aspiré ? Est-ce l'hiéroglyphe (cas 1) ou le hiéroglyphe (cas 2) ? Est-ce le même cas au pluriel ? Sont-ce (avec liaison) leurs [z] hiéroglyphes (cas 1) ou (sans liaison) leurs hiéroglyphes ? Serait-il logique de répondre différemment dans chacun des deux cas ? Ou bien, est-ce illogique ?
- Etym. "Laye" : vous paraît-il que puissent être rapprochés le terme technique utilisé par les facteurs d'orgue pour désigner le conduit par lequel le vent entre dans le sommier avant d'en sortir par la gravure, du terme que l'on rencontre dans le nom de villes telles Laye-en-Champsaur (05) ou saint Germain-en-Laye (78) qui désignerait alors une trouée dans les bois, un passage dans la forêt (au sens d'une laie que l'on retrouve dans le verbe layer) ? Quel rapport, s'il y en est un, avec le sanglier femelle (elle laboure des tranchées ?)
Merci, par avance, pour vos réponses à chacune de mes questions.
JL
Réponse du Guichet
Le 14/05/2014 à 15h22
Votre questionnement est multiple…
1 Première interrogation : féminin de hébreu
Le Trésor de la Langue Française nous dit :
Adj. Qui concerne la langue des Hébreux, qui lui appartient.
En partic. Qui est écrit en hébreu.
Rem. Selon les dict., hébreu ne prend pas la marque du fém. Cf. cependant les formes hébreue et hébreuse dans les ex. suiv. Le procès, qui a eu à débattre de l'existence ou non d'une « mafia » hébreue (...) a longtemps agité l'opinion (L'Arche, no 269, août 1979, p. 12). [L'ancien soldat] : cette écriture-là n'est ni hébreuse, ni (...) c'est tout bêtement de l'arabe (RICHEPIN, Miarka, 1883, p. 172). Déchirons nos vêtements! crient les hébreuses épouvantées (VILLIERS DE L'I.-A., Contes cruels, 1883, p. 391).
Wikitionnaire précise :
Selon la Grammaire supérieure formant le résumé et le complément de toutes les études de Pierre Larousse, le féminin ne s’utilise que pour les personnes ; selon d’autres grammairiens, la forme féminine est entièrement proscrite. On utilisera alors, selon le contexte, juive, hébraïque ou israélite.
Notons cependant l’existence et l’usage (rare) de hébreue (« la mafia hébreue ») ou hébreuse (« une écriture hébreuse »).
Confirmé par Littré
Cet adjectif est inusité au féminin ; en ce cas on le remplace par hébraïque : la langue hébraïque, une bible hébraïque.
Hébreue et hébreuse sont donc possibles, mais inusitées. Valable bien évidemment pour le pluriel…
J’ajouterai (et cela n’engage que moi) que c’est fort laid à l’oreille, comme dans un autre domaine une cheffe (sic) de cabinet et toutes ces féminisations à la prononciation appuyée cheffe, auteure, ingénieure…
2 Le problème du h aspiré ou muet
Vaste sujet…
H MUET
Comme son nom l’indique, le h muet est… muet. Il ne correspond à aucun son, ni à aucun mouvement d’air. Celui qui est souvent considéré comme un vestige étymologique a la particularité de n’empêcher ni l’élision de la voyelle qui le précède ni la liaison entre deux mots.
En d’autres termes, il faut considérer les mots commençant par un h muet comme des mots commençant par une voyelle.
Ex. : l’homophone, l’humour, l’hiver, l’honnêteté, l’hélicoptère.
Au pluriel : les hivers = avec liaison
H ASPIRÉ
Le h aspiré correspond à un léger bruit de souffle qui empêche l’élision et, par le fait même, la liaison entre les mots.
Moins courant que le h muet, le h aspiré est une trace des origines germaniques ou anglo-saxonnes de certains mots.
Ex. : la hache, le hall, la hauteur, le héron, le hoquet, le huitième.
Au pluriel : les hauteurs = sans liaison
Sur le site de l'Office québécois de la langue française, nous avons les précisions suivantes :
H aspiré
On distingue en français deux h, c'est-à-dire deux prononciations différentes associées à la lettre h. Pourtant, paradoxalement, la lettre h ne représente aucun son, et ce, quel que soit le contexte dans lequel elle apparaît. Pourquoi alors parler de h muet et de h aspiré? La raison est en fait essentiellement étymologique. Certains mots commençant par h sont d'origine latine, alors que d'autres viennent de langues germaniques (francique, anglais, allemand, etc.).
On appelle h aspiré le h initial des mots qui ont une origine germanique, bien qu'il n'y ait, en fait, aucune aspiration en français. Il s'agit plutôt d'une disjonction entre ces mots et ce qui précède. C'est pourquoi le h dit aspiré interdit la liaison; on prononcera ces hamacs (sé-a-mak) et non (sé-za-mak); vous hurlez (vou-ur-lé) et non (vou-zur-lé). De même, on ne peut faire d'élision devant un mot commençant par un h aspiré; on aura par exemple: la honte (la-on-t) et non l'honte (lon-t); la hernie (la-èr-ni) et non l’hernie (lèr-ni); je hoche (je-och) et non j'hoche (joch). On ne peut, non plus, employer la forme masculine du déterminant possessif devant les mots féminins commençant par un h aspiré; on aura donc ma hanche et non mon hanche.
De plus, le h aspiré favorise la prononciation du e final du mot qui précède, ce e étant habituellement considéré comme muet. Ainsi, on dira: une grande haie (unn-gran-d(e)-è). Enfin, le h aspiré s'observe également dans des emprunts à l'arabe et dans certaines interjections (ha!, hop!, hola!) où il est dans ces rares cas le signe d'une réelle aspiration.
Le dictionnaire Robert présente plus de quatre cents mots commençant par un h aspiré; on le représente par une apostrophe, par exemple hameau est transcrit en API ['amo]. Voici une liste des principaux, dont plusieurs comportent des dérivés.
halte
hamac
hamburger
hameau
hamster
hanche
haricot
harnais
hernie
hibou
hic
hideur
hiérarchie
hiéroglyphe
honte
hoquet
horde
hotte
Avons-nous la réponse ? Hiéroglyphe avec un h aspiré ?
Mais non, ce serait trop simple...
Nous avons trouvé des commentaires intéressants sur un blog :
« Le Petit Larousse Illustré a changé son fusil d'épaule entre 1989, où le h de hiéroglyphe est encore muet, et 2005. L'Académie, dans la dernière édition de son dictionnaire, a conservé le "h" muet :
XVIe siècle. Dérivé régressif d'hiéroglyphique. ARCHÉOL. Caractère à valeur figurative, symbolique ou phonétique, utilisé dans l'ancienne Égypte pour les inscriptions monumentales. Les écritures hiératique et démotique sont issues des hiéroglyphes. L'obélisque de Louksor est couvert d'hiéroglyphes.
• Par ext. Se dit des signes de diverses écritures qui usaient de figures ou d'idéogrammes. Les hiéroglyphes hittites. Les hiéroglyphes des Mayas.
• Au pluriel. Fig. et fam. Écriture illisible, malaisément déchiffrable. Je n'ai pu lire vos hiéroglyphes.
Nous sommes au cœur d'un conflit entre deux tendances ; d'une part le fait que d'une façon générale mais avec des exceptions, le h étymologique grec n'est pas aspiré, d'autre part le fait que le "hie" forme une articulation de semi-consonne qui a tendance à demander la disjonction.
À cause de la première tendance, le "h" n'est en principe pas aspiré dans "hiératisme" : l'hiératisme. Mais à cause de la seconde tendance, il l'est dans la hiérarchie. Hiéroglyphe, avec le même préfixe sacré, résistait d'abord assez bien dans la première catégorie, mais est en train de basculer dans la seconde. Et nous vivons en direct ce grand événement. Elle est pas belle, la vie ? »
Vous pouvez trouver un complément d'informations dans notre "bible" : Le Bon usage, de Grévisse, que je n'ajoute pas ici pour ne pas alourdir ma réponse, à l'article "disjonction"...
3 Laye
Laie, nous dit le Dictionnaire historique de la langue française, dans le sens de femelle du sanglier, est issu du francique lêha, et le mot est attesté sous la forme latine leha vers l’an 800.
L’ancien français laie (dont le diminutif a donné layette) signifie boîte, coffret, encore utilisé avec des sens spécialisés, notamment en musique, pour désigner la partie inférieure du sommier de l’orgue. Il est emprunté au moyen néerlandais laeye, qui signifie petite caisse.
Nous avons donc déjà deux mots différents d’origine différente.
Quant à Saint-Germain-en-Laye ou Laye-en-Champsaur, on trouve l’origine du mot laye dans plusieurs documents :
- Histoire de la ville et du château de St. Germain-en-Laye, par Abel Goujon,Charles Odiot, 1829 :
On s'est fort attaché à chercher l'origine du nom que la forêt de Laye porte depuis plus de mille ans. En général les recherches de ce genre sont rarement utiles, et presque toujours ont pour résultat une incertitude plus grande encore qu'auparavant. Il ne faut, pour s'en convaincre, que rappeler les diverses conjectures étymologiques imaginées sur le mot Laye. Les uns prétendent qu'il dérive de celui de Laya, qui, en celtique, signifie forêt. Mais est-on bien sûr que Laya, avec sa physionomie toute latine, soit un mot celtique ? est-on bien sûr qu'il ait, chez les Celtes, signifié forêt} et ensuite, que dès son origine la forêt de Laye ait été ainsi désignée ? Jacques Godefroi, dans son Commentaire sur le Code Théodosien, fait dériver cette appellation des Lètes, vétérans à qui il aurait été distribué des terres dans ces cantons ; mais Ducange le reprend avec raison. Ne serait-il pas plus simple et plus vraisemblable de dire avec cet auteur, qu'en effet Laye vient de Laya, mais que Laya signifie souvent un chemin tracé dans une forêt, et quelquefois une forêt limitée par divers chemins. Cette étymologie s'il en faut une, nous paraît préférable à celle qu'on prétend tirer de la grande quantité de sangliers et laies qui infestaient anciennement ces contrées. Au surplus, il est certain que sous le règne de Charlemagne, la forêt de Laye se nommait Lida. Irminon, abbé de Saint – Germain-des-Prés, dit que son abbaye y possède un canton de trois lieues de tour : Habet in Lida de silva in gyro tres leucas.
- Leçon d'histoire de France: Saint-Germain-en-Laye, par François Boulet, 2006 :
La forêt est alors défrichée : la « laye » signifiant une « trouée ou ouverture dans la forêt » ou un sentier.
- Glossaire de botanique ou Dictionnaire étymologique de tous les noms et termes relatifs à cette science, par Alexandre de Théis, 1810 :
LÂYER. Layeur, laye, termes forestiers. De laia, employé dans les plus anciens manuscrits pour signifier bois, taillis. De la Saint-Germain en laye. Ïayet, forêt, en vieux françois; laye, femelle du sanglier, qui habile les bois. Layette, coffre de bois, en vieux irançois (1), layctier, ouvrier en bois, etc
- Dictionnaire étymologique de la langue françoise, où les mots sont classés ..., par Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort-Flaméricourt, 1829, p. 21 :
ALLÉE, passage pour entrer dans une maison; lieu propre à se promener, sentier d’un jardin. Dans la première acception, l’allée d‘une maison a pris certainement son nom du verbe aller, parce qu’elle sert de passage pour aller aux différens étages I’escalier se trouvant au bout. Dans la seconde acception, Ducange fait dériver allée de deux mots la Iée, qui, en vieux frangois, a signifié une route coupée dans une forêt; mais laye signifiait bois, forêt, du lat. ligmum, en basse lat. laza, et je n’ai jamais rencontré ce mot dans l’acception de route coupée dans une forêt. On dit Saint-Germain-en-Laye pour Saint-Germain la forêt ou dans a forêt. Espace en longueur, bordé par d’autres parallèles, dans un jardin ou dans les champs.
Dans le Champsaur :
Le nom de Laye, hameau de Champoléon et aussi commune du bas-Champsaur, indique que ces lieux étaient autrefois situé près d'un lieu boisé, de l'occitan aia = haie, issu du francique HAGJA = haie.
Laye est signalé dès 1150 sous la graphie de 'Laïa'. Ce toponyme, une contraction de 'La Aïa', signifie 'sylve, forêt, massif forestier'. Frédérique Mistral y apporte une précision en désignant ce massif forestier comme une sylve primaire. Provenant du francisque 'Hadja' - 'die Hecke' en allemand - Aïa a donné 'la haie' française.
Mots régionaux laix, lay, laye, lex, « bois taillis, forêt ». De l´ancien français laie, laye, « réserve dans une forêt, partie de bois, quelquefois le bois lui-même », laie, laiee, layee, « route en forêt », verbe laier, layer, leyer, « faire dans les bois taillis de petits chemins droits », bas latin legia, lagia, laia, lia, « sentier rectiligne en forêt », du germanique *laidô, « chemin, chemin [dans la forêt] », puis « forêt » par synecdoque.
Comme vous le voyez, il n’y a pas de rapport entre Laye et la femelle du sanglier, et l’origine des noms propres Laye est elle-aussi différente.
En espérant avoir répondu à vos interrogations plus que multiples !
Et merci de bien vouloir nous poser une question à la fois…
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



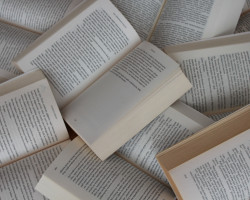
 Voyage voyage
Voyage voyage