Question d'origine :
Bonjour,
Peut-on considérer "malaisant" comme un mot de la langue française, ou bien n'est-il qu'une sorte d'abus de langage?
Réponse du Guichet
Le 14/12/2017 à 13h25
Bonjour,
Le mot malaisant est effectivement un terme remis au goût du jour, mais on lui reproche d’être un adjectif formé à partir du participe présent d’un verbe qui n’existe pas : malaiser.
Pour répondre à votre interrogation, le terme malaisant peut effectivement être considéré comme un mot de la langue française. Ce mot était utilisé au XVIe siècle. Vous en trouverez une définition dans le
Dans le dictionnaire
Dans le TLFi (Trésor de la Langue Française Informatisée) à l'entrée
"
Par ailleurs il semblerait que le terme malaisant aurait été remis au goût du jour par les Québécois. Je vous invite à consulter l’article très complet de Ludmila Bovet,
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



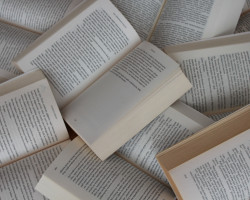
 En mai, fais de l’upcyclé
En mai, fais de l’upcyclé