Question d'origine :
Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous au sujet des Sonnets de Louise Labé, j'espère ne pas trop vous ennuyer... Je ne peux consulter les ouvrages de la bibliothèque de Lyon, n'y habitant pas ; je me base exclusivement sur CNRTL et ATLIF en ligne, et sur mon intuition, mais elle me joue parfois des tours.
1) Sonnet X : vers 12-13-14
"Et, ajoutant à ta vertu louable
Ce nom encor de m’être pitoyable
De mon amour doucement t’enflammer ?"
> Ce "nom", est-ce bien celui de l'amant (d'où sa réputation) ? Mais est-ce le nom qui est "pitoyable" ou bien la poétesse ?
> Voici ce que je comprends, mais j'hésite :
"Et ce nom augmentant encore ta grandeur admirable,
Quoiqu’il soit pour moi source de pitié OU encore qu’il me rende d’autant plus pitoyable,
Ne pourrait-il pas t’enflammer, doucement, de mon amour ?
(te faire ressentir, peu à peu, autant d'amour que moi?)
2) Sonnet XXIV : là encore, vers 12-13
"En ayant moins que moi d’occasion,
Et plus d’étrange et forte passion"
> Je ne comprends pas bien ces vers, à cause de la polysémie de "occasion" (lieu, cause), "passion" (amour/souffrance), "étrange" (extraordinaire/aliénante).
> Voici ce que je crois comprendre, mais l'ensemble est étrange, donc je ne suis pas convaincue :
V.11-13 :
Amour pourra, s’il veut, vous rendre davantage (plus longtemps?) amoureuses,
En ayant moins que moi d’occasion (d’être amoureuses) ou de circonstances favorables (à l’amour),
Et (en ayant) plus (que moi), une passion mystérieuse et forte.
MERCI BEAUCOUP !!
Très cordialement,
Charlotte
Réponse du Guichet
Le 22/10/2020 à 09h39
Bonjour,
Le traitement de votre nouvelle question nous demandera un peu plus de temps que d'habitude. Nous en sommes désolés.
Nous reviendrons vers vous dans le courant de la semaine prochaine.
Avec nos meilleures salutations,
Le traitement de votre nouvelle question nous demandera un peu plus de temps que d'habitude. Nous en sommes désolés.
Nous reviendrons vers vous dans le courant de la semaine prochaine.
Avec nos meilleures salutations,
Réponse du Guichet
Le 28/10/2020 à 09h09
Bonjour,
Nous reprenons pour vous répondre les dictionnaires cités dans les précédentes questions que je liste en fin de réponse (pour mémoire pour d’autres lecteurs de votre question sur le guichet du savoir). Ils sont probablement disponibles dans d’autres bibliothèques publiques ou universitaires et pourront être très utile à tout travail de traduction depuis le moyen français. Une recherche sur le SUDOC ou le CCFr peut être utile pour retrouver des exemplaires en dehors de la bibliothèque de Lyon. Nous avons aussi utilisé l’édition de François Rigolot de 2004 des Œuvres complètes de Louise Labé, car elle est abondamment annotée, notamment sur les difficultés de compréhension que ne manque pas de susciter le moyen français. Nous complétons d’ailleurs une réponse précédente sur le sens de « recevoit bien pareille pour pareille ».
Réponse à vos questions :
1) Sonnet X : tercet final
Je me permets ici de reprendre le sonnet afin de mettre en contexte le dernier tercet :
1ère strophe : louange de la capacité poétique de l’amant par la poétesse
2e strophe : mention des louanges d’autres et déclaration d’amour
3e strophe : « Tant de vertus qui te font estre aymé, / Qui de chacun te font estre estimé / Ne te pourroient aussi bien faire aymer ? »
4e strophe : « Et ajoutant à ta vertu louable / Ce nom encor de m’estre pitoyable, / De mon amour doucement t’enflamer ? »
François Rigolot ne donne ici aucune note, nous nous en remettons donc aux dictionnaires.
« Nom » a deux sens bien établi au XVIe siècle. Celui habituel, qui sert à désigner une personne ou une chose, et le sens plus particulier de « réputation », qu'on retrouve dans l'expression "se faire un nom". C’est probablement dans ce second sens qu’il faut comprendre le mot « nom » ici. Ce sens est d’autant plus à préférer que le premier que le sonnet fait part des nombreuses louanges que l’amant reçoit du fait de ses vertus. Il a donc la réputation d’être vertueux.
« Pitoyable » signifie bien au premier sens du mot, et au sens le plus répandu au XVIe siècle : sensible et prompt à la pitié, charitable.
La phrase se comprend enfin en revenant au tercet précédent : la poétesse demande à son amant si les vertus dont on le loue peuvent aussi faire en sorte qu’il aime d’autres femmes. Le dernier tercet précise qu’elle parle d’elle. Ainsi en reprenant le tercet précédent, une traduction littérale de la fin du poème pourrait être : « Tes vertus qui font que tout le monde t’aime […] / ne te pourraient-elles pas te faire aussi aimer ? / Et, ajoutant à ta vertu / la réputation (« le nom ») supplémentaire (« encor ») d’être charitable « être pitoyable ») à mon encontre (« m’ »), / t’enflammer doucement de mon amour ? »
2) Sonnet XXIV : vers 12 et 13
Ici encore, je me permets de citer le sonnet plus en détail. Il s’agit du dernier des 24 sonnets de Louise Labé. La poétesse s’adresse à ses lectrices et vise à se défendre d’éventuelles attaques. Le sens général du sonnet est de dire qu’il ne faut pas la blâmer d’avoir perdu son temps à soupirer d’amour et avoir failli à son devoir, car Amour pourrait aussi les (les lectrices) rendre amoureuses, et plus encore qu’elle. Ainsi faut-il reprendre la phrase qui court sur tout le sonnet :
« [Dames…] estimez qu’Amour […] pourra […] plus vous rendre amoureuses : / En ayant moins que moy d’ocasion, / Et plus d’estrange et forte passion ».
« Occasion » : le sens le plus répandu et qu’à mon avis il faut entendre ici est celui de « raison, cause ». Il faut donc entendre qu’Amour peut rendre les « Dames » amoureuses alors qu’elles auraient moins de raison de l’être que la poétesse qui vient dans tout le recueil de se plaindre des malheurs qu’Amour lui a fait subir. Rappelons qu’Amour avec une majuscule désigne le dieu romain qui suscite la passion amoureuse avec ses flèches.
« Estrange » : au sens littéral, « estrange » signifie qui est étranger. En parlant d’un sentiment ou d’une émotion, on pourrait peut-être traduire par « inhabituel » ou « inconnu », mais cela affaiblit en grande partie le sens beaucoup plus fort que peut revêtir ce mot ici. François Rigolot propose une piste très intéressante. Il indique dans sa note : « estrange . passion : passion aliénante. Cf. à propos de cette notion d’estrangeté (aliénation) l’Elégie I, vers 89. ». Le vers en question est celui-ci : « Ainsi Amour de toy t’a estrangée ». Littéralement ce vers de l’Elégie I signifie qu’Amour t’a rendu étranger à toi-même. Une passion estrange est donc une passion qui rend étranger à soi-même, qui fait qu’on ne se reconnaît pas.
« passion » : littéralement, la passion est ce que l’on subit, ce que l’on ressent, ce qui n’est donc pas lié à la volonté. De là, l’idée d’émotion ou de sentiment est déjà bien établi au XVIe siècle, sans pour autant avoir acquis le sens d’émotion « forte » ou de sentiment « fort » que le terme revêt aujourd’hui.
Une traduction littérale et sans visée esthétique possible serait (en inversant les vers 12 et 13 pour rendre la phrase plus facilement compréhensible de nos jours) : « Amour […] pourra […] vous rendre plus amoureuses [sous-entendu « que moi »] avec une émotion si forte qu’elle vous rend étrangère à vous-même alors que vous aurez (« en ayant ») moins que moi de raisons de l’être ».
-
Pour mémoire et information, voici les ouvrages utilisés :
- collectif, Dictionnaire du moyen-français en ligne;
- A.J. Greimas et T.M. Keane, Dictionnaire du moyen français, Paris : Larousse, éditions 1992 et 2001;
- G. Di Stefano, Dictionnaire des locutions en moyen français, Montreal : Ceres, 1991;
- A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Le Robert, 1992;
- E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, Paris : Didier, 1925-1967.
- F. Rigolot, Oeuvres complètes de Louise Labé, Paris : GF Flammarion, 2004.
Pour information, consulter aussi les deux questions suivantes :
- Sur des vers de l’Elégie I
- Sur des vers des Elégies I et II
En espérant vous avoir été utile,
Le Fonds ancien de la bibliothèque municipale de Lyon
Nous reprenons pour vous répondre les dictionnaires cités dans les précédentes questions que je liste en fin de réponse (pour mémoire pour d’autres lecteurs de votre question sur le guichet du savoir). Ils sont probablement disponibles dans d’autres bibliothèques publiques ou universitaires et pourront être très utile à tout travail de traduction depuis le moyen français. Une recherche sur le SUDOC ou le CCFr peut être utile pour retrouver des exemplaires en dehors de la bibliothèque de Lyon. Nous avons aussi utilisé l’édition de François Rigolot de 2004 des Œuvres complètes de Louise Labé, car elle est abondamment annotée, notamment sur les difficultés de compréhension que ne manque pas de susciter le moyen français. Nous complétons d’ailleurs une réponse précédente sur le sens de « recevoit bien pareille pour pareille ».
Réponse à vos questions :
1) Sonnet X : tercet final
Je me permets ici de reprendre le sonnet afin de mettre en contexte le dernier tercet :
1ère strophe : louange de la capacité poétique de l’amant par la poétesse
2e strophe : mention des louanges d’autres et déclaration d’amour
3e strophe : « Tant de vertus qui te font estre aymé, / Qui de chacun te font estre estimé / Ne te pourroient aussi bien faire aymer ? »
4e strophe : « Et ajoutant à ta vertu louable / Ce nom encor de m’estre pitoyable, / De mon amour doucement t’enflamer ? »
François Rigolot ne donne ici aucune note, nous nous en remettons donc aux dictionnaires.
« Nom » a deux sens bien établi au XVIe siècle. Celui habituel, qui sert à désigner une personne ou une chose, et le sens plus particulier de « réputation », qu'on retrouve dans l'expression "se faire un nom". C’est probablement dans ce second sens qu’il faut comprendre le mot « nom » ici. Ce sens est d’autant plus à préférer que le premier que le sonnet fait part des nombreuses louanges que l’amant reçoit du fait de ses vertus. Il a donc la réputation d’être vertueux.
« Pitoyable » signifie bien au premier sens du mot, et au sens le plus répandu au XVIe siècle : sensible et prompt à la pitié, charitable.
La phrase se comprend enfin en revenant au tercet précédent : la poétesse demande à son amant si les vertus dont on le loue peuvent aussi faire en sorte qu’il aime d’autres femmes. Le dernier tercet précise qu’elle parle d’elle. Ainsi en reprenant le tercet précédent, une traduction littérale de la fin du poème pourrait être : « Tes vertus qui font que tout le monde t’aime […] / ne te pourraient-elles pas te faire aussi aimer ? / Et, ajoutant à ta vertu / la réputation (« le nom ») supplémentaire (« encor ») d’être charitable « être pitoyable ») à mon encontre (« m’ »), / t’enflammer doucement de mon amour ? »
2) Sonnet XXIV : vers 12 et 13
Ici encore, je me permets de citer le sonnet plus en détail. Il s’agit du dernier des 24 sonnets de Louise Labé. La poétesse s’adresse à ses lectrices et vise à se défendre d’éventuelles attaques. Le sens général du sonnet est de dire qu’il ne faut pas la blâmer d’avoir perdu son temps à soupirer d’amour et avoir failli à son devoir, car Amour pourrait aussi les (les lectrices) rendre amoureuses, et plus encore qu’elle. Ainsi faut-il reprendre la phrase qui court sur tout le sonnet :
« [Dames…] estimez qu’Amour […] pourra […] plus vous rendre amoureuses : / En ayant moins que moy d’ocasion, / Et plus d’estrange et forte passion ».
« Occasion » : le sens le plus répandu et qu’à mon avis il faut entendre ici est celui de « raison, cause ». Il faut donc entendre qu’Amour peut rendre les « Dames » amoureuses alors qu’elles auraient moins de raison de l’être que la poétesse qui vient dans tout le recueil de se plaindre des malheurs qu’Amour lui a fait subir. Rappelons qu’Amour avec une majuscule désigne le dieu romain qui suscite la passion amoureuse avec ses flèches.
« Estrange » : au sens littéral, « estrange » signifie qui est étranger. En parlant d’un sentiment ou d’une émotion, on pourrait peut-être traduire par « inhabituel » ou « inconnu », mais cela affaiblit en grande partie le sens beaucoup plus fort que peut revêtir ce mot ici. François Rigolot propose une piste très intéressante. Il indique dans sa note : « estrange . passion : passion aliénante. Cf. à propos de cette notion d’estrangeté (aliénation) l’Elégie I, vers 89. ». Le vers en question est celui-ci : « Ainsi Amour de toy t’a estrangée ». Littéralement ce vers de l’Elégie I signifie qu’Amour t’a rendu étranger à toi-même. Une passion estrange est donc une passion qui rend étranger à soi-même, qui fait qu’on ne se reconnaît pas.
« passion » : littéralement, la passion est ce que l’on subit, ce que l’on ressent, ce qui n’est donc pas lié à la volonté. De là, l’idée d’émotion ou de sentiment est déjà bien établi au XVIe siècle, sans pour autant avoir acquis le sens d’émotion « forte » ou de sentiment « fort » que le terme revêt aujourd’hui.
Une traduction littérale et sans visée esthétique possible serait (en inversant les vers 12 et 13 pour rendre la phrase plus facilement compréhensible de nos jours) : « Amour […] pourra […] vous rendre plus amoureuses [sous-entendu « que moi »] avec une émotion si forte qu’elle vous rend étrangère à vous-même alors que vous aurez (« en ayant ») moins que moi de raisons de l’être ».
-
Pour mémoire et information, voici les ouvrages utilisés :
- collectif, Dictionnaire du moyen-français en ligne;
- A.J. Greimas et T.M. Keane, Dictionnaire du moyen français, Paris : Larousse, éditions 1992 et 2001;
- G. Di Stefano, Dictionnaire des locutions en moyen français, Montreal : Ceres, 1991;
- A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Le Robert, 1992;
- E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, Paris : Didier, 1925-1967.
- F. Rigolot, Oeuvres complètes de Louise Labé, Paris : GF Flammarion, 2004.
Pour information, consulter aussi les deux questions suivantes :
- Sur des vers de l’Elégie I
- Sur des vers des Elégies I et II
En espérant vous avoir été utile,
Le Fonds ancien de la bibliothèque municipale de Lyon
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



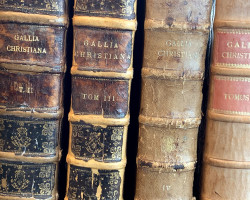
 Le journal de chasse
Le journal de chasse