Question d'origine :
Bonjour, Comme vous m'avez aidée pour des poèmes de Louise Labé et un de Pontus de Tyard, je me permets de vous questionner sur un autre vers de ce poète qui résiste à ma compréhension. Dans le sonnet "Lorsque je vis ces cheveux d’or dorer" des Erreurs amoureuses, Premier livre, 1549, (recopié ci-dessous) je ne suis pas sûre de bien comprendre les tercets (à cause de la structure SI+), que j'aurais expliqué ainsi : Si le Soleil fait que tout sue de chaleur et fume d'ardeur, (De même) ma dame me consume en pleurs. (?) Si partout sa grande Sphère ronde (= le Soleil) luit, Son nom à elle s'étend (de même/aussi) dans le monde entier. Mais, (le soleil) (s') éclipsant, sa clarté cessera, (Alors que) jamais son nom à elle disparaîtra. [Donc la comparaison n'est qu'imparfaite //v.8]. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup ! Charlotte LE TEXTE : Lorsque je vis ces cheveux d'or dorer Tant gentement cette vermeille glace, Et de ces yeux les traits de bonne grâce, Puis çà, puis là gaiement s'égarer : Lorsque je vis un souris colorer Et de douceur et de pitié sa face , Qui en leur beau toutes beautés efface , Je la cuidais au Soleil comparer. S'il fait que tout de chaleur sue, et fume, D'ardeur, et pleurs ma dame me consume . Si partout luit sa grande Sphère ronde, D'elle le nom s'étend par tout le Monde. Mais, éclipsant, sa clarté cessera, Jamais le nom d'elle n'éclipsera .
Réponse du Guichet
avant de vous répondre, je précise qu'il s'agit du sonnet VIII du premier livre des Erreurs amoureuses de Ponthus de Tyard (ainsi numéroté dans l'édition de 1555). Le texte que vous proposez connaît par ailleurs une variante au vers 7 selon l'édition : "Qui en leur beau toutes beautés efface" est le texte de l'édition de 1555. Le texte de la première édition de 1549 est "Laquelle en tout toutes beautés efface". Lapp retient le texte de 1555, quand McClelland et Sauza retiennent le texte de 1549. Je n'ai pas malheureusement pas pu consulter la version de référence de Eva Kushner (voir ci-dessous pour les références).
Concernant votre interprétation, elle me paraît tout à fait juste. Elle mérite peut-être simplement quelques éclaircissements sur le sens de "comparer" afin de vous paraître moins étrange.
Les premiers quatrains décrivent comment la chevelure blonde et le sourire (le "souriz" ici) rendent si belle la figure (face) de la femme dont il est question, là encore sans la citer. De ce fait, le poète "cuide" "comparer" ladite femme, avec le soleil. Cuider a ici le sens de "se mettre en tête de; essayer, s'efforcer de" ou "avoir la présomption de". Bref, la beauté de la femme aimée pousse le poète à la comparer au soleil. Mais "comparer" a un sens plus proche de "confronter" que de comparer de façon neutre, Huguet (voir référence ci-dessous) dit "mettre aux prises avec". Ici, il s'agit donc de "mettre aux prises", de "confronter" la femme et le soleil afin de savoir qui des deux est meilleur.
La comparaison s'étend ainsi sur les deux tercets finaux. Le "il" de "S'il" se rapporte bien au soleil, comme le précise d'ailleurs en note Guillaume de Sauza dans son édition. De façon générale, la comparaison fonctionne par doublets à la même rime, l'un donnant la qualité du soleil, l'autre de la femme aimée. Ainsi, les versets 9, 11 et 13 se rapportent au soleil, quand les versets 10, 12 et 14 se rapportent à la femme aimée.
La comparaison porte d'abord sur la chaleur : le soleil fait suer et fumer. "Fumer" signifie ici exciter. La femme fait se consumer l'amant de pleurs et d'ardeurs. "Ardeurs" s'entendant ici comme désirs violent, on dirait un désir "ardent" : le poète se consume de désir et de lamentations.
Puis sur la lumière : le soleil est visible dans le monde entier, le nom de la dame "s'étend", c'est à dire est connu, par tout le monde.
Pour ces deux qualités (chaleur et lumière), le soleil et la femme aimée pourraient sembler faire jeu égal. Les deux derniers vers vont permettre de départager le soleil de la femme aimée à la faveur de cette dernière, en montrant ce qui se passe quand ils disparaissent ("éclipsant", c'est à dire "disparaissant") : pour le soleil, sa disparition signifie la fin de sa clarté, alors que pour la femme aimée, sa disparition (que ce soit celle du soleil ou d'elle-même) ne fera pas disparaître son nom. Dans la "comparaison", la femme aimée ressort "gagnante" en quelque sorte.
Pour vous aider dans vos recherches, ont été utilisés :
Les éditions suivantes du texte de Ponthus de Tyard :
- P. de Tyard et John C. Lapp (éd.), Oeuvres poétiques complètes, 1966;
- P. de Tyard et Mc Clelland (éd.), Erreurs amoureuses, 1967);
- P. de Tyard et G. de Sauza (éd.), Erreurs amoureuses, livre 1, 2009
Pour information, l’édition de référence est : P. de Tyard et Eva Kushner (éd.), Oeuvre complète, à partir de 2004, non disponible à la bibliothèque municipale de Lyon.
Ont aussi été utilisés les dictionnaires suivants :
- collectif, Dictionnaire du moyen-français en ligne;
- A.J. Greimas et T.M. Keane, Dictionnaire du moyen français, Paris : Larousse, éditions 1992 et 2001;
- G. Di Stefano, Dictionnaire des locutions en moyen français, Montreal : Ceres, 1991;
- A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Le Robert, 1992;
- E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, Paris : Didier, 1925-1967.
En espérant vous avoir été utile,
Le Fonds ancien de la bibliothèque municipale de Lyon



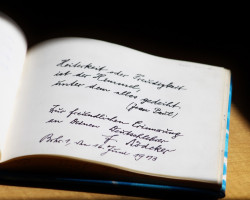
 Emily Brontë, mystérieuse ou subversive ?
Emily Brontë, mystérieuse ou subversive ?