Réponse du département Sciences et Techniques
Le suicide existe-t-il chez les animaux ?"
Certains comportements, comme l’homosexualité, le jeu ou l’adultère, se retrouvent chez d’autres espèces animales. Par contre, selon les spécialistes du comportement animal, le suicide n’en fait pas partie. On a longtemps cru, par exemple, que les
lemmings commettaient parfois des suicides collectifs en se jetant à la mer par centaines. En fait, il s’agit d’une erreur d’interprétation de notre part - et surtout de la part des lemmings. Lorsqu’il y a surpopulation, des groupes se forment pour aller peupler de nouveaux territoires. Lorsqu’ils rencontrent une rivière ou un lac, les lemmings franchissent habituellement l’obstacle à la nage. Lorsqu’ils atteignent la mer, ils croient instinctivement qu’il s’agit d’une rivière ou d’un lac et ils tentent alors la traversée. Malheureusement, ils nagent jusqu’à l’épuisement et finissent par se noyer. (Lire
le suicide des lemmings élucidé article de Dorothée BRUNET-LECOMTE / Libération).
Il y a également le cas du scorpion qui, dit-on, se suicide lorsqu’il est entouré de flammes. Recroquevillé sur lui-même, il donne alors l'impression de se piquer lui-même. En fait, les scorpions sont immunisés contre leur propre venin et on a pu en ranimer en les plongeant dans l'eau salée. Encore une fois, il s'agit d'une erreur d'interprétation de notre part.
On cite souvent des histoires de chiens qui se laissent mourir sur la tombe de leur maître. Selon les spécialistes de la psychologie animale, ils ne meurent pas vraiment par tristesse. Comme le chien est «programmé» pour vivre en groupe, la disparition de son chef de meute le prive de tout repère. L'animal se retrouve alors dans une situation qui n'est pas prévue par ses instincts. Il cesse d'avoir un comportement normal et finit par mourir.
D'une manière générale, les spécialistes du comportement animal préfèrent considérer que les «suicides» d'animaux s'expliquent par des contraintes environnementales, et non par un désir véritable de se donner la mort. Il faut donc se méfier de l'anthropomorphisme, c’est-à-dire attribuer des comportements humains aux autres espèces animales.
Cela dit, on peut tout de même trouver une certaine ressemblance entre le comportement suicidaire chez l’être humain et celui de certains animaux, mais il faut discerner une nuance. Selon la stricte définition du dictionnaire (Nouveau Petit Robert), le suicide est: «le fait de se tuer, de se donner la mort (ou de le tenter), pour échapper à une situation psychologique intolérable, lorsque cet acte, dans l'esprit de la personne qui le commet, doit entraîner à coup sûr la mort». Or la plupart des spécialistes doutent qu’un chien ou tout autre animal puisse délibérément chercher à se tuer, ou qu'il soit conscient qu'il va mourir s'il continue à se comporter d’une manière néfaste. Pour parler crûment, si un animal cherchait à s'empoisonner ou se jetait délibérément par la fenêtre ou devant un train, il serait plus facile alors de parler de suicide. Autrement, on peut considérer qu’il s’agit d’un «suicide passif», mais on s'éloigne peut-être alors de la définition habituelle. Jusqu’à présent, il semble donc que l’humain détienne le privilège peu enviable d’être la seule espèce animale dont les membres se donnent intentionnellement la mort..."Source :
cyberscience.com, Philippe Chartier.
Nathalie Angier dans
Eloge de la bête parle de "
sacrifice" (
chapitre : la face cachée du suicide) :
"
Dans la nature, il est souvent difficile de savoir si la mort est voulue ou accidentelle. Des comportementalistes animaliers ont étudié les circonstances qui poussent un membre d'une couvée à se laisser tuer par ses frères et sœurs afin de transmettre son héritage génétique. Chez le
pingouin à crête, par exemple, la mère pond toujours deux œufs : un petit et un gros. Etant donné la rigueur de l'environnement arctique, elle ne peut élever qu'un poussin, habituellement celui de l'œuf le plus volumineux. La présence du second n'est qu'une sorte d'assurance, au cas où le premier aurait un accident. Si les deux éclosent, en théorie, l'oisillon le plus frêle a intérêt à mourir sans faire d'histoires, en se jetant, en quelque sorte, sur l'épée de son frère. Après tout, les deux ne pouvant survivre, pourquoi priver le plus robuste d 'une précieuse subsistance ?
L'observation sur le terrain tend à étayer cette théorie :lorsque deux poussins naissent, le plus petit meurt sans déranger personne. Néanmoins, selon les adversaires de cette hypothèse, il ne s'en va pas gentiment, sans faire de bruit. Ils donnent cet exemple : si Monsieur Tout-le-monde se retrouvait dans un canot de sauvetage en compagnie d'un champion de boxe, avec une quantité très limité de nourriture, il serait stupide de sa part de provoquer le boxeur. Au lieu de quoi, il se tiendrait tranquille, dans l'espoir de trouver une bonne occasion pour le faire passer par-dessus bord, ou se mettrait simplement à prier pour que la foudre s'abatte sur lui.
D'une manière générale, les scientifiques parlent de suicide seulement si, du point de vue de la reproduction, l'animal à davantage à gagner en disparaissant. Un exemple en est un
papillon aux couleurs énigmatiques, qui se dissimule en se fondant dans le paysage. Après la reproduction , sa présence représente un danger pour ses rejetons, car si un oiseau le découvre, il devient capable de repérer ses couleurs et de les distinguer de l'environnement, menaçant ainsi les futurs adultes. Pour l'éviter, ces papillons se jettent à terre et se mettent à battre si frénétiquement des ailes qu'ils en meurent d'épuisement : ils s'autodétruisent pour préserver leur secret.
Les exemples de sacrifice de soi sont légions. Chez
certains moucherons, la mère offre son corps à manger à ses petits : ils la dévorent tout entière, jusqu'au dernier morceau. Les
taupes aveugles et dépourvues de poils, vivent en colonies un peu comme les abeilles. Lorsqu'un individu est infesté par les parasites, son devoir est de se retirer dans la partie du terrier servant de toilettes publiques et d'y demeurer jusqu'à la fin. Une fois cette décision prise, il ne bouge plus et ne peut être nourri de force, même en laboratoire : il fait ainsi de son mieux pour éviter de contaminer ses congénères."
Voici quelques titres d'ouvrages qui vous permettront de découvrir d'autres mystérieux comportements animaliers :
-
Ces chiens qui attendent leur maître-
Eléments d'éthologie cognitive-
Ethologie : approche systématique du comportement



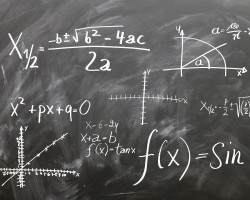
 Méditerranée
Méditerranée