Question d'origine :
Bonjour
On apprend, à l'école et à la télé, que l'oeil humain perçoit les images grâce à des cônes et des cylindres disposés sur la rétine, captant soit la couleur, soit la luminosité. Ce qu'on perçoit est transmis par des signaux électriques via le nerf optique jusqu'à une zone spécifique du cerveau.
Cela rappelle le fonctionnement d'une caméra ou d'un appareil photo numérique, l'oeil serait l'objectif, la rétine serait le capteur CCD, les cônes et les cylindres seraient les pixels qui y sont disposés (sauf que les pixels captent uniquement la couleur) et le nerf optique serait un câble USB qui amène ces images jusqu'à un centre de traitement (cerveau <=> ordinateur)
Je sais bien que ceci n'est qu'une carricature et que le fonctionnement biologique d'un oeil est bien plus subtil et complexe.
J'ai toutefois, à propos de ces éléments, trois questions à vous poser:
1) Prenons un seul oeil humain (en passant outre la vue binoculaire): on se rend compte que lorsque des objets sont très éloignés, on ne peut pas en distinguer les détails sans se rapprocher. La vue a donc cette limite. Aussi, connaît-on la "résolution" d'un oeil , la précision de la vue? combien de "points" peut-on voir dans un centimètre carré, par exemple ? ou plus simplement, combien de cônes et cylindres compte la rétine? (je sais que l'on ne voit que très nettement qu'au centre de notre champ de vision car c'est à cet endroit qu'il y a le plus de ces molécules au fond de l'oeil. Mais j'aimerais un ordre d'idée, je présume qu'on ne peut pas avoir un nombre de MégaPixels que contient l'oeil, lol)
2) Voit-on à un nombre précis d'images par seconde? (si oui, le connaît-on/quel est ce nombre?) y a t'il un intervalle de temps minimal entre deux images que l'on voit? (ce temps allié a la persistance rétinienne nous fait apprécier la notion d'animation d'une vidéo, et il est difficile de distinguer un changement d'image à 24 images/seconde, est ce que cela veut dire que la limite de "vitesse de rafraîchissement" de l'oeil est proche de 24 images/seconde? )
3) A-t'-on réussi a "capter" le signal électrique qui transite par le nerf optique? Connaissez vous la nature et les résultats d'expériences menées pour tenter de décoder ce signal, ou de reconstituer l'image que l'oeil perçoit? (j'ai entend parler de projets permettant de redonner la vue à des personnes qui l'ont perdue après une rupture du nerf optique à l'aide d'une caméra, et il y a aussi les expériences permettant de savoir en quelles couleurs, et comment voient les animaux. est-ce déterminé à partir de ce signal ou de l'étude de leurs globes occulaires?)
Voila, merci. Désolé pour toutes ces sous-questions dans les qustions, mais c'est par souci de précision. Merci, aussi, de répondre à ces questions avec la meilleure précision possible  A bientot ! (eh oui j'aurai d'autres questions à vous soumettre)
A bientot ! (eh oui j'aurai d'autres questions à vous soumettre)
Réponse du Guichet
Le 28/10/2005 à 13h09

source : L'oeil
1 –
« Il y a environ 7 millions de cônes sur la rétine, environ 125 millions de bâtonnets et seulement 1 million de fibres nerveuses. Les cônes de la fovéa ont un diamètre entre 1 et 1,5 μm (1 μm = 1 x 10-6 m = 0,001 mm) et sont espacés d'environ 2 à 2,5 μm. Les bâtonnets ont un diamètre d'environ 2 μm. Dans les portions externes de la rétine, les cellules photosensibles sont plus espacées et sont plusieurs sur une même fibre nerveuse (plusieurs centaines pour une seule fibre), rendant ainsi la vision moins distincte dans cette région de la rétine. À la fovéa, cependant, il y a un cône par fibre nerveuse. »
Source : L'œil humain
2-
« Le premier problème a été résolu en doublant (pour les films actuels tournés en 24 images par seconde) ou en triplant (pour les films anciens tournés à 16 images par seconde) le nombre d’images qui s’affichent successivement sur l’écran. On obtient ainsi près de
La fréquence à laquelle le scintillement causé par une succession d’images devient imperceptible pour notre système visuel est appelé le seuil de fusion d'une lumière scintillante. Ce seuil n’est pas absolu mais dépend du niveau d’illumination de l’image, étant plus élevé pour des images plus claires. Il dépend également de la région de la rétine où se projette l’image : les bâtonnets ont une réponse plus rapide que les cônes, de sorte que le scintillement peut parfois être vu dans notre champ de vision périphérique alors que notre vision centrale, assurée par la fovéa composée de cônes, en est dépourvue. »
Source : la vision
« La restitution du mouvement demande une
source : Perception visuelle humaine
3 –
« Le même principe que l'implant cochléaire pourrait pallier la cécité : l'oeil artificiel, auquel Léonard de Vinci, déjà, avait pensé, sort des limbes. Repassons-nous le film de la structure de l'oeil : une chambre globulaire, remplie d'une substance gélatineuse transparente, ouverte sur l'extérieur par un mince puits, la pupille. La lumière s'y engouffre et traverse une lentille fibreuse, le cristallin, qui la réfracte sur le tissu tapissant la plus grande partie de la chambre oculaire, la rétine. Celle-ci transforme l'énergie lumineuse en une information électrique transmise au cortex visuel, à l'arrière du crâne, par l'intermédiaire du nerf optique qui s'abouche au fond du globe oculaire. Cette transformation est opérée dans la rétine par deux couches de cellules, les photorécepteurs et les cellules ganglionnaires. Les photorécepteurs contiennent des molécules sensibles à la lumière qui, frappées par celles-ci, se dégradent, provoquant un changement de polarité de leur membrane. De ce fait, la quantité de neurotransmetteurs libérés par les photorécepteurs diminue, entraînant une réaction des cellules ganglionnaires dont les axones forment, ensemble, le nerf optique.
A vrai dire, on ne sait pas parfaitement comme le système visuel "voit", aussi bien au niveau de la rétine que dans le cerveau. Mais on en sait assez pour pouvoir envisager des implants bioniques restituant une vision minimale à des aveugles. Deux démarches sont actuellement suivies. La première vise à stimuler les cellules ganglionnaires : celles-ci restent en effet fonctionnelles dans la dégénérescence maculaire, une cécité acquise et provoquée par la dégradation des photorécepteurs. Dans le projet d'implant développé par John Wyatt et Joseph Rizzo, des chercheurs américains, le système comprend trois éléments : l'implant lui-même, posé contre la rétine, un capteur visuel porté sur une paire de lunettes, une batterie alimentant le capteur. Celui-ci se compose d'une caméra CCD et d'un processeur. La caméra CCD (charged coupled device) est un procédé bien connu pour numériser l'image, c'est-à-dire la transformer en bits, O et 1. Le processeur traduit ces bits en un signal adapté à l'implant qui, accroché à la rétine, le reçoit par rayon laser. Dans l'implant, des photodiodes récupèrent le signal et le transmettent à un processeur qui le traduit en impulsions électriques appliquées par vingt électrodes aux cellules ganglionnaires.
Le dispositif a été testé sur des lapins : il a produit une activité mesurable dans leur cortex visuel. Les problèmes à résoudre concernent, comme dans toute application bionique, la biocompatibilité de l'implant, le mode de codage du signal, la sélectivité des cibles stimulées, etc. La fragilité de la rétine constitue une difficulté cruciale : ce tissu d'un quart de millimètre d'épaisseur est à peu près aussi résistant qu'une feuille mouillée de mouchoir en papier. La plaque d'électrodes mise au point par l'équipe de Wyatt et Rizzo, épaisse de quatre millièmes de millimètre, ne devrait pas l'abîmer. On reste cependant loin d'un implant rétinien adaptable à un humain, même si plusieurs équipes sont déjà en piste, comme celle coordonnée par Rolf Eckmiller, à l'université de Bonn, et soutenue par le ministère allemand de la recherche. Eckmiller pense que le capteur visuel pourrait être placé non pas sur la lunette, mais dans une lentille de contact.
D'autres chercheurs critiquent la démarche de l'implant rétinien : certes, disent-ils, il est placé en amont du thalamus que traverse l'influx nerveux visuel en allant vers le cortex, il bénéficierait donc de ses capacités de traitement du signal visuel. Mais ce serait son seul avantage ; pour le reste, la technique chirurgicale est compliquée, on risque de stimuler d'autres axones que ceux des cellules visées, les mouvements de l'oeil pourraient fragiliser le dispositif. Bref, mieux vaudrait se placer en aval, sur le cortex visuel lui-même. »
Source : Le cerveau électique
Il s’agit d’un extrait de l’ouvrage La révolution biolithique : humains artificiels et machines animées, publié en 1998
Cette réponse du Guichet du Savoir complètera sans doute vos connaissances sur la vision des hommes et des animaux. Elle précise notamment que « Comme il est difficile de voir par les yeux des animaux, ce que l'on connaît de leur perception des couleurs reste très subjectif. Par l'étude des différents cônes visuels présents chez les animaux, on arrive toutefois à deviner ce qu'ils peuvent voir. »
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



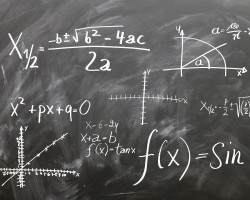
 De chair et de fer
De chair et de fer