Question d'origine :
Bonjours,
je voudrais comprendre comment sont maintenus les ponts, et connaître leurs différentes structures: les ponts modernes, à arches, à poutres, à consoles, les ponts suspendus, combinés ou encore les ponts à caisson cantiléver...
Merci par avance et bon courage.
Réponse du Guichet
Le 07/04/2006 à 09h05
En introduction :
- La base de données Structurae qui recence les ouvrages d'art par type de construction.
- Pont (ouvrage d'art), Wikipédia.
- Différents types de ponts, Académie de Bordeaux.
- Ponts : types de structures, Association @Lyon
- Les structures des ponts, Musée des sciences et de la technologie du Canada.
- Encyclopédie Encarta, cité par le site Sciences Ecole de l'Académie de La Réunion.
« L’équilibre des ponts
Toute structure est soit tendue, soit comprimée. C’est en expliquant le rôle de la traction et de la compression que l’on peut comprendre comment les ponts sont en équilibre. Par exemple, lorsque l’on tire sur une corde ou un fil, on effectue un mise en « traction » de la corde ou du fil. Par contre, lorsque l’on appuie sur un poteau en bois ou que l’on enfonce un clou, on effectue une mise en « compression » du poteau ou du clou. En « traction », on étire la structure et on essaie de l’allonger ; en « compression », cherche à la raccourcir. L’allongement ou le raccourcissement ne sont pas visibles à l’oeuil nu.
Quand un pont se déforme sous le poids de la charge qu’il supporte, certaines parties de sa structure subissent une traction et d’autres une compression. Par exemple, une arche est, toute entière, mise en compression, alors qu’un câble de suspension s’étire et est mis en traction. En revanche, une poutre simple ou en treillis seront à l a fois tendus et comprimés. Par conséquence, les matériaux de construction des ponts que l’on peut utiliser en compression sont la pierre, la brique et le béton ordinaire ; soumis à une traction ou une flexion, ils sont fragiles et se fissurent. Une corde, un bambou ou un câble sont en revanche adaptés à la traction s’ils peuvent être tendus. Actuellement, les matériaux de haute technologie comme l’acier ou le béton armé conviennent aussi bien au travail en traction qu’en compression.
Les ponts à arches
- les premiers ponts voûtés : les ponts voûtés sont des structures en compression pure qui existaient déjà à l’époque romaine. Comme les matériaux alors disponibles, tels que la pierre et la brique, étaient fragiles, les bâtisseurs avaient recours à une construction voûtée pour s’assurer que les forces exercées sur ces matériaux le seraient toujours en compression. Les Romains construisaient leurs voûtes en forme de demi-cercle, forme simple facilitant la mise en place du cintre qui soutenait les pierres taillées en forme de coin, appelées voussoirs. Une voûte se compose de deux moitiés qui s’appuient l’une contre l’autre au niveau de la clef de voûte. Le poids du pont suit la ligne courbe des voussoirs et est reporté vers l’extérieur.
Ces voutes avaient une portée assez limitée et les piles qui servaient d’appui devaient être larges et massives. En effet, plus la courbe de la voûte est faible, plus la poussée exercée vers l’extérieur sur la culée est forte, et plus la voûte devient instable au moment de la construction.
- l’arc en plein cintre segmentaire : son profil est plus plat que dans le cas d’une voûte en demi-cercle, donc sa portée est plus grande. L’arche n’exerce pas seulement sur le sol une force verticale, mais aussi une poussée horizontale. La poussée horizontale est d’autant plus forte que l’arche est surbaissé, d’où la nécessité de construire des culées à chaque extrémité du pont. Il est possible de construire plusieurs arches, dont les poussées s’équilibrent sur les piles médianes à condition que les culées reprennent les poussées aux extrémités.
- l’arche à dalle raidies : système conçu au début du XXe siècle par robert Maillart, qui sut tirer parti des qualités du béton armé pour construire des ponts à trois articulations, d’une grande finesse et d’allure remarquablement moderne. A chaque culée, l’arche prend la forme d’une paire de béquilles qui s’élargissent avant de se fondre au quart de la portée. En ce point central, l’arc se rattache au tablier ou à la dalle routière et forme avec eux un caisson rigide. L’arche à dalle raidie se caractérisant par un tablier lourd et renforcé repose sur une fine dalle en arche par l’intermédiaire de murs verticaux très minces. La rigidité du tablier restreint les mouvements latéraux du pont et répartit uniformément la charge sur la totalité du pont.
- Les ponts en arc modernes : ils utilisent principalement le béton armé et l’acier comme matériaux. Le béton de l’arc est coulé dans des coffrages métalliques ou en bois portés par un cintre, une fois que le ferraillage est en place. Les coffrages sont retirés après le séchage et le durcissement complet du béton. En général, un pont en arc en béton se compose d’au moins deux arcs parallèles, sur lesquels s’appuient des poteaux de différentes longueurs soutenant le tablier. Les arcs parallèles sont reliés par un entrecroisement de bracons qui permet une résistance d’ensemble aux pressions latérales du vent.
Les ponts à poutres
- poutres-treillis : le treillis triangulaire est l’une des formes de base les plus simples utilisées dans la construction des ponts. Une poutre triangulée se compose de deux membrures de compression inclinées et d’une barre de tension horizontale qui empêche les membrures inclinées de s’écarter sous un chargement. La poutre-treillis est autoportante : elle est soutenue à chaque extrémité afin de porter la charge imposée ainsi que son propre poids. L’absence de poussée horizontale permet de se passer de culées. Gustave Effel, notamment, a beaucoup utilisé les poutres-treillis, à la fois légères et rigides, mais aussi solides et économiques.
- Ponts à poutres-caissons et à caissons trapézoïdaux : les poutres en acier ou en béton armé ou précontraint conviennent aux ponts routiers et ferroviaires de portée assez courte, mais nécessitent de nombreuses piles d’appui en cas de franchissement d’un large cours d’eau ou d’un échangeur routier. En évidant une section afin de la rendre creuse, il est possible de gagner en portée et d’obtenir une poutre à la fois solide et économique. Cette solution de poutres-caissons a été conçue à l’origine pour obtenir des tabliers rigides nécessaires pour les ponts suspendus et à haubans.
Un pont cantilever est un pont soutenu par des poutres en son centre.
Les ponts suspendus
Depuis des millénaires, des fibres naturelles comme le chanvre ou le bambou servent à fabriquer des cordes solides destinées à retenir des ponts rudimentaires. De nos jours, on fabrique des câbles métalliques par l’enroulement en hélice de fils d’acier. On obtient ainsi des torons dont le diamètre va de quelques centimètres à plus d’un mètre. Le câble métallique est ensuite entouré d’une gaine en nylon qui le protège de la corrosion. Ces câbles, capable de supporter des charges très élevées, de plusieurs milliers de tonnes, sont utilisés pour les ponts les plus longs au monde : les ponts suspendus.
Les éléments de base d’un pont suspendu sont : le câble en tension et les suspentes ; les pylônes et les fondations ou les caissons, qui réagissent en compression ; la chaussée formée par une poutre-treillis ou une poutre-caisson rigide, qui permet de s’opposer à la pression latérale du vent ; et enfin les ancrages aux extrémités, qui empêchent la flexion des pylônes et résistent à la tension exercée sur le câble. Les ponts suspendus ont généralement des fondations en caissons sur lesquelles les pylônes sont bâtis.
Les ponts à haubans
Ce type de pont est récent. Il a été développé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est plus efficace, pour des portées plus courtes, que le pont suspendu et nécessite moins de câbles pour soutenir le tablier. Ce dernier est accroché grâce à une série de câbles distincts, disposés en éventail ou en harpe. Dans la configuration en éventail, les câbles se rejoignent au sommet du pylône au niveau d’une selle, tandis que dans une configuration en harpe, ils sont rattachés au tablier et au pylône à intervalles réguliers, parallèlement leus uns aux autres.
La solidité d’un pont à haubans dépend de la résistance de ces derniers, qui doivent apporter au tablier la plus grande rigidité possible. »
Source : Les ponts
Voici deux larges extraits de Encyclopaedia Universalis
"La classification des ponts
Il est extrêmement difficile de classer les ponts en différentes catégories, car il existe de très nombreux critères de classement : le matériau dont est construit le tablier (aujourd'hui essentiellement l'acier et le béton, armé ou précontraint) ; la nature des réactions que le pont produit sur ses appuis ; le mode de fonctionnement de la structure en flexion longitudinale ; le schéma statique transversal de l'ouvrage, et enfin son mode de construction.
Traditionnellement, on distingue trois grandes familles en fonction de la nature des réactions produites par l'ouvrage sur ses appuis : les ponts qui travaillent en poutre, qui n'exercent que des réactions verticales ou quasi verticales si l'on excepte les efforts horizontaux créés par le freinage des convois ou les effets du vent ; ils doivent être construits avec des matériaux résistants en flexion comme le bois, le béton armé ou précontraint et l'acier ; les ponts en arc, qui exercent sur leurs culées des réactions de poussée tendant à les écarter ; ce sont des structures funiculaires de compression qui peuvent donc être construites avec des matériaux qui ne résistent pas à la traction, comme la pierre ou la fonte ; les ponts suspendus dans lesquels les grands câbles porteurs exercent des efforts de traction sur les massifs d'ancrage.
Le simplisme de cette classification ne suffit pas à représenter l'immense diversité des schémas statiques longitudinaux :
- Les ponts à câbles regroupent aussi bien les ouvrages suspendus classiques que ceux qui sont autoancrés, dans lesquels les grands câbles porteurs sont fixés sur le tablier, et les ponts à haubans, dans lesquels chacun des haubans vient directement s'accrocher sur le tablier. La compression de ce dernier équilibre l'effort de traction des câbles ou des haubans.
- Les ponts en arc modernes peuvent être à tablier supérieur, intermédiaire ou inférieur, en fonction de la position de celui-ci par rapport à l'arc. Ce dernier, qui peut être encastré sur ses culées aux naissances, peut aussi comporter de une à trois articulations : le plus souvent deux, une à chacune des naissances comme pour le viaduc de Garabit, ou trois, la troisième étant située à la clef. Dans certains cas, le tablier - lorsqu'il est à un niveau très bas, et particulièrement lorsque le sol n'est pas capable d'équilibrer les réactions de poussée d'un arc classique - peut équilibrer par sa traction la poussée de l'arc qui devient un effort interne : c'est ce qu'on appelle un pont en bow-string, qui peut aussi être considéré comme un pont en treillis à poutres latérales de hauteur variable. La suspension du tablier est assurée soit par des tirants en acier, voire en béton armé ou précontraint, soit par des câbles, verticaux ou inclinés, qui sont disposés en V ou en X. Dans le cas le plus courant des arcs à tablier supérieur, le nombre des pilettes supportant le tablier peut être réduit - grâce à une augmentation de sa résistance à la flexion - jusqu'à faire dégénérer la forme de l'ouvrage en pont à béquilles ; c'est le cas du pont principal du viaduc de Martigues, à Caronte, ou de celui du Bonhomme sur le Blavet. L'inclinaison des béquilles peut être variable. Elles peuvent même devenir verticales, donnant alors à l'ouvrage la forme d'un portique, comme le pont sous la ligne du métro à la station de Bir-Hakeim à Paris ou la passerelle entre l'île Saint-Louis et l'île de la Cité.
- Les ponts en poutre présentent les formes les plus diverses. L'ouvrage peut tout d'abord être une poutre continue sur des appuis multiples, ou au contraire divisé en une succession de travées indépendantes. De multiples schémas intermédiaires permettent de faire varier le degré d'hyperstaticité de la structure. Les poutres constituant la partie porteuse de l'ouvrage peuvent être placées sous la chaussée ou de part et d'autre de celle-ci ; on parle alors respectivement de ponts à poutres sous chaussée ou de ponts à poutres latérales. Sur les ouvrages modernes, elles sont en acier ou en béton, à âmes pleines ou en treillis de formes très diverses.
Les ponts modernes
Aujourd'hui, dans leur grande majorité, les ponts sont des poutres en acier, en ossature mixte acier-béton ou en béton précontraint (fig. 4). Les grandes portées restent le domaine réservé des ponts à câbles, et les très petites portées, au-dessous de 10 à 12 mètres, celui du béton armé.
Les ponts en poutre
Les poutres en treillis métallique ont été pratiquement abandonnées en Europe au profit des poutres à âmes pleines sous chaussée. C'est une conséquence de l'évolution historique des coûts relatifs de la main-d'œuvre et de la matière. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le coût de la main-d'œuvre était assez faible tandis que le prix des matériaux - et tout particulièrement de l'acier - était très élevé. Il était donc intéressant de construire des treillis permettant de sensibles économies de matière, au prix d'assemblages complexes. Mais, avec l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et la chute du prix des matériaux, la tendance s'est inversée. D'autant que l'amélioration des caractéristiques mécaniques de l'acier a limité la quantité de matière que permet d'économiser la complication de la structure. Dans leur grande majorité, les ponts métalliques sont donc construits avec des poutres à âmes pleines sous chaussée. Il arrive encore, cependant, qu'on construise des ponts à poutres latérales en treillis - du type Warren ou Warren à montants - lorsqu'on ne dispose que d'un très faible espace entre l'obstacle à franchir et le niveau de la chaussée. On réalise aussi des ouvrages en treillis pour de très grandes portées, notamment au Japon, lorsque l'importance des efforts est telle que le treillis permet encore des économies sensibles de matière.
Les ponts à poutres à âmes pleines sous chaussée ont pratiquement la même structure, qu'il s'agisse d'ouvrages en acier à dalle orthotrope ou qu'il s'agisse de ponts en ossature mixte avec une dalle participante en béton. La dalle - orthotrope ou en béton - constitue la membrure supérieure de l'ossature, complétée par des poutres en I ou un caisson (ou plusieurs caissons). Les ouvrages en ossature mixte étaient souvent constitués de nombreuses poutres reliées par des entretoises ; la tendance est aujourd'hui de construire des ponts à deux poutres, dits bipoutres. Lorsque le tablier est étroit, ces poutres sont reliées par de simples entretoises et la dalle ne porte transversalement que de poutre à poutre. Lorsque le pont s'élargit, les efforts transversaux augmentent dans la dalle qui est alors précontrainte dans le sens transversal, comme pour le viaduc de la Somme sur l'autoroute A26. Mais on peut aussi, pour les ouvrages larges et très larges, multiplier les poutres principales, ou relier les deux poutres principales par des pièces de pont qui portent le hourdis supérieur en béton avec un entre-axe limité, de l'ordre de 3 à 4 m ; la dalle en béton travaille alors surtout dans le sens longitudinal. Les choix sont beaucoup plus limités dans le cas des ponts en acier : les deux poutres principales doivent obligatoirement être reliées par les pièces de pont qui supportent les augets, comme pour le viaduc d'Autreville. Pour des portées très importantes, ou lorsqu'on a besoin d'une grande rigidité de torsion dans les ponts courbes ou très en biais, voire pour des raisons esthétiques, on remplace les poutres en I par des caissons. Mais l'importance des contraintes de compression dans la membrure inférieure, et dans le bas des âmes au voisinage des appuis, impose un fort raidissage des tôles, qui leur donne le même aspect qu'une dalle orthotrope. La sous-estimation des risques de voilement de la membrure inférieure de ces caissons a conduit à de graves accidents au début des années 1970 (effondrements, en cours de construction, du pont de Vienne sur le Danube en 1969, de celui de Milford Haven en 1970, de Melbourne en 1970 et de Coblence en 1971). On peut citer de nombreux ouvrages français à dalle orthotrope à un ou plusieurs caissons : pont de Chaumont sur la Loire (121,6 m ; fig. 5) ; pont de l'Alma à Paris (110 m, 1970) ; pont de Cornouailles à Bénodet (200 m, 1973). Mais aussi des ouvrages en ossature mixte : pont de Belleville (84 m, 1970) ; viaduc de la Chiers à Longwy (110 m, 1985).
Ces ouvrages sont le plus souvent construits par lancement, ou poussage, tant que leur portée reste modérée, moins de 100 m environ. Lorsqu'il s'agit d'un pont à dalle orthotrope, il est évidemment lancé avec sa dalle ; mais, lorsque l'ouvrage est en ossature mixte, l'ossature métallique doit être lancée seule, ce qui détermine les dimensions des membrures supérieures des poutres ou des caissons. La dalle en béton armé est ensuite coulée en place, ou constituée au moyen d'éléments préfabriqués. Plus récemment, les ingénieurs suisses ont imaginé de lancer une dalle préfabriquée sur la charpente métallique déjà en place.
Les formes des ponts en béton précontraint sont plus diverses, mais elles sont, elles aussi, guidées par les évolutions économiques. Entre les deux guerres, les tabliers des ouvrages en béton armé étaient le plus souvent constitués de poutres longitudinales nombreuses et peu espacées, reliées par des entretoises formant pièces de pont. Avec l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, particulièrement important dans le prix des coffrages et avec la diminution du coût des matériaux, il est préférable de construire des ouvrages un peu plus lourds mais de formes plus simples. Ce qui explique le succès des ponts en dalle précontrainte. Pour les faibles portées, jusqu'à 15 ou 20 m, on construit des dalles rectangulaires. Lorsque la portée augmente, il faut accroître leur épaisseur et, pour que les efforts de poids propre ne deviennent pas excessifs, il faut les alléger. On crée alors des dalles à larges encorbellements, qui deviennent progressivement nervurées, lorsqu'on concentre la matière en une ou plusieurs nervures, pour des portées d'environ 20 à 35 m. Les nervures deviennent plus hautes et s'amincissent, devenant de véritables poutres rectangulaires lorsque la portée atteint 40 m. Mais le rendement géométrique - qui traduit l'efficacité mécanique de la section par rapport à son poids - n'augmente que lentement, passant de 0,33 pour une dalle rectangulaire à environ 0,42 pour un pont à nervures. Pour construire des ouvrages de portée supérieure à 50 m, il faut concentrer la matière sur les fibres extrêmes, au prix d'une complication du coffrage. Cela conduit aux sections en caisson, beaucoup plus efficaces, mais dont la fabrication est nettement plus difficile et plus coûteuse. Leur rendement géométrique est de l'ordre de 0,55 à 0,65. Il apparaît ainsi, sous la pression de l'économie, une correspondance à peu près parfaite entre les portées du pont et les formes de la section transversale. La méthode de construction intervient cependant comme correctif dans le choix de la section transversale. Si l'ouvrage est bétonné sur cintre ou sur cintre autolanceur, la distribution des moments fléchissants de poids propre est proche de l'optimum ; on peut alors concevoir des ponts à nervures pour des portées nettement supérieures à 50 m. Si l'ouvrage est construit par encorbellements successifs, il apparaît d'importants moments négatifs de poids propre sur piles, juste avant la fin de la construction des fléaux ; une section en caisson, beaucoup plus efficace, s'impose alors de façon quasi systématique. Enfin, si l'ouvrage est mis en place par poussage, il apparaît des moments fléchissants importants en cours de lancement, alternativement positifs et négatifs ; il faut alors concevoir des sections assez hautes, nettement plus que pour les autres méthodes de construction, qui peuvent être à nervures jusque vers 40 m, mais qui doivent être en caisson au-delà.
Le développement de la préfabrication a légèrement modifié cet équilibre : le coût de la main-d'œuvre est plus faible en usine que sur le chantier, et les rendements sont plus élevés ; en outre, il est nécessaire de diminuer le poids des pièces pour réduire le coût des engins de manutention, de transport et de mise en place. Les ponts construits au moyen d'éléments préfabriqués - qu'il s'agisse de poutres sous chaussée ou de voussoirs destinés à reconstituer une poutre en caisson (voire à nervures) - ont donc des formes plus découpées et plus complexes, dans le but d'alléger les pièces. L'entreprise Bouygues a même imaginé des poutres en treillis spatial en béton précontraint (pont de Bubiyan au Koweït, en 1983 ; viaducs de Sylans et des Glacières sur l'autoroute A40, en 1988), mais l'économie de matière ne compense pas le prix trop élevé de la main-d'œuvre.
La largeur du pont intervient aussi dans la conception de la section transversale, particulièrement dans le cas des ouvrages en caisson dont la portée est supérieure à 50 m en général. À la fin des années 1960, la solution classique consistait à concevoir un caisson unique à deux âmes pour des ponts d'une dizaine de mètres de largeur, un caisson unique à trois âmes pour une largeur de 12 à 16 m (pont de Oissel sur la Seine, 1978), et à constituer le tablier au moyen de deux caissons parallèles à deux âmes (viaduc de Calix à Caen, 1974), ou même de trois caissons parallèles pour les ponts très larges (pont Saint-Jean à Bordeaux, 1968). Les ouvrages d'autoroute étaient alors fréquemment constitués de deux ponts parallèles et indépendants, chacun portant une chaussée autoroutière (pont d'Ottmarsheim, 1979). Au cours des années 1970, la tendance a été d'élargir le domaine d'emploi des caissons à deux âmes jusque vers 14 ou 15 m, et à trois âmes jusque vers 20 m, afin d'alléger la structure en réduisant le nombre des âmes, dans un but d'économie. Et les ingénieurs ont cherché à généraliser l'emploi des caissons à deux âmes quelle que soit leur largeur, en aménageant leur conception pour assurer leur résistance en flexion transversale : on construit aujourd'hui des caissons larges à deux âmes à hourdis supérieur épais, précontraint transversalement (viaduc de Poncin, 1986) ; des caissons larges à deux âmes avec un hourdis supérieur nervuré transversalement (pont de Saint-André-de-Cubzac, 1978 ; viaduc de Ponts-de-Cé ; pont de Saumur ; viaduc de l'Arrêt Darré ; pont à béquilles d'Auray, 1988 ; pont de Cheviré) ; et des caissons à deux âmes dont les larges encorbellements sont soutenus par des voiles minces inclinés, continus ou discontinus, qui prennent l'apparence d'âmes supplémentaires (viaducs et pont de la ligne de Marne-la-Vallée du R.E.R., 1977 ; ouvrage no 36 de l'autoroute du Littoral à Marseille, 1986) ; ou soutenus par des bracons rectangulaires distants de trois ou quatre mètres (Erschachtalbrücke et Kochertalbrücke, en Allemagne). Grâce à cette évolution technique, on préfère aujourd'hui porter les autoroutes par des ponts à tablier unique de grande largeur, non seulement pour des raisons économiques, mais surtout pour améliorer l'esthétique des ouvrages et leur inscription dans le site.
La technique de la précontrainte évolue, elle aussi. Plusieurs ponts avaient été construits, aux débuts de la précontrainte, avec des câbles extérieurs au béton (les ponts allemands déjà cités ; les ponts de Villeneuve-Saint-Georges, de Vaux-sur-Seine, de Port-à-Binson et de Can Bia en France, vers 1950 ; les ponts de Magnel en Belgique...), mais la technologie des câbles intérieurs, mise au point par Freyssinet, s'était largement imposée. La précontrainte extérieure a été remise à l'honneur vers 1980, par Jean Muller aux États-Unis (ponts des Keys de Floride : Long Key, Channel Five, Niles Channel et Seven Mile ; viaducs et pont du Sunshine Skyway à Tampa) et par l'administration du ministère de l'Équipement en France (le S.E.T.R.A.). Les câbles de précontrainte extérieurs sont généralement ancrés sur les entretoises qui raidissent le caisson au-dessus des piles, et déviés dans les travées par des bossages en béton, ou des entretoises, pour leur donner un tracé optimal. Mais il ne peuvent être mis en place ainsi qu'après l'achèvement de la construction de la travée. Les ponts peuvent alors être édifiés travée par travée à l'avancement, à l'aide d'un échafaudage au sol (viaducs du métro de Lille), de multiples palées provisoires (viaduc de Saint-Agnant), d'une poutre de pose lançable (viaducs du Mass Transit System d'Atlanta) ou autolanceuse (la poutre de pose du pont de Bubiyan, qui agit comme une véritable grue portant toute la nouvelle travée), ou d'un haubanage provisoire (viaducs du Vallon des Fleurs et de la Banquière ; viaduc de Frébuje). Ils peuvent être construits par encorbellements successifs à condition de mettre en œuvre, à mesure de la construction des fléaux, une précontrainte intérieure qui équilibre les moments négatifs de poids propre (pont de Chinon sur la Vienne) ; cette méthode permet aussi de mettre en place par rotation des fléaux, construits sur échafaudages au sol parallèlement à la rivière (pont sur le Loir à La Flèche), ou de mettre en place par poussage les deux moitiés d'un ouvrage, réalisées au sol sur chaque berge (pont de Cergy-Pontoise). Les ouvrages sont aussi mis en place par poussage, à condition de concevoir un schéma de précontrainte centré pendant le poussage, associant des câbles extérieurs définitifs et d'autres câbles provisoires, intérieurs ou extérieurs (viaduc sur la Somme à Amiens ; viaduc de Charix).
Une autre évolution importante vient des progrès dans la fabrication des bétons eux-mêmes. Au cours des années 1970, de nombreuses tentatives avaient été faites pour développer l'emploi des bétons légers, mais l'importance de la quantité d'énergie nécessaire à l'obtention des granulats légers fit perdre beaucoup de son intérêt économique à cette solution. Plus récemment, sous l'influence des progrès réalisés dans ce domaine aux États-Unis et dans les pays scandinaves, se développe l'emploi des bétons à hautes performances, et notamment l'utilisation de bétons dans lesquels une partie du ciment est remplacée par de la fumée de silice. Leur résistance varie de 60 à 80 MPa et peut atteindre 100 MPa dans certaines conditions ; leur utilisation est récente en France, mais la construction du pont de l'île de Ré, terminé en 1988, a clairement mis en évidence leur grand intérêt.
Les ponts à câbles, à haubans ou suspendus
Enfin, les ponts à câbles modernes, ponts à haubans et ponts suspendus, constituent les seules solutions adaptées aux très grandes portées. Les ouvrages à haubans commencent à devenir plus économiques que ceux en poutre à partir de 200 m environ. Mais il arrive qu'on construise des ponts à haubans ou même des ponts suspendus de portée beaucoup plus modeste pour des raisons esthétiques, ou du fait de contraintes particulières. Les passerelles pour les piétons et les cyclistes constituent un domaine d'emploi particulièrement intéressant des ponts à haubans : celle du bassin du Commerce au Havre, avec un tablier en ossature mixte ; les passerelles en béton précontraint de Meylan sur l'Isère, près de Grenoble (1978), et de l'Illhof sur l'Ill, près de Strasbourg (1979), qui ont été bétonnées sur un échafaudage au sol, parallèlement à la rivière, et mises en place par rotation autour de leurs piles. Jorg Schlaich a même construit à Stuttgart deux passerelles suspendues, dont l'une sur le Neckar, avec un tablier en dalle mince de béton armé.
Beaucoup de ponts à haubans construits ces dernières années en béton précontraint ont été fortement inspirés du pont de Brotonne, avec une nappe de haubanage axiale et une section transversale en caisson, complétée par un système de bracons permettant de transférer au bas des âmes l'effort de tension des haubans : le pont de Coatzacoalcos au Mexique (1984) et celui du Sunshine Skyway à Tampa, en Floride (1986), tous les deux construits par encorbellements successifs ; les pont de Ben Ahin, mis en place par rotation autour de son pylône en s'inspirant des passerelles de Meylan et de l'Illhof (1987) ; celui de Wandre, sur la Meuse en Belgique, installé par poussage sur des appuis provisoires, en 1987. Mais la mise en place de multiples haubans répartis permet de concevoir des tabliers de beaucoup plus faible inertie ; et le remplacement de la nappe de haubanage axiale par des nappes latérales, capables d'équilibrer directement les efforts de torsion, autorise la conception de tabliers qui n'ont, en outre, qu'une faible rigidité de torsion. Le pont de Pascoe Kennewick, en 1979, est la première application de ces idées : la section transversale est constituée de deux petits caissons triangulaires, réunis par un hourdis entretoisé. Cette solution a logiquement évolué vers la construction de tabliers à deux nervures latérales, reliées par un hourdis mince et des entretoises formant pièce de pont : ouvrage de Quincy, avec des entretoises métalliques, et de Dames Point, à Jacksonville en Floride, à travée centrale de 400 m (1988). René Walther et Jorg Schlaich sont allés au bout de l'idée en concevant des dalles haubanées : le pont de Dieppoldsau en Suisse, en 1986, l'Akkar Bridge dans le Sikkim, en 1988, et l'ouvrage d'Evripos en Grèce, en 1990, avec une travée centrale de 215 m. Le record du monde est actuellement détenu par le pont de Barrios de Luna (1986), sur l'Èbre en Espagne, avec une portée de 440 m.
Les ponts à haubans métalliques les plus anciens comportent un platelage orthotrope : celui de Saint-Nazaire a détenu, pendant longtemps, le record du monde de portée (404 m, 1975) avec son caisson orthotrope de forme quasi rectangulaire ; l'ouvrage du Faro, au Danemark, a une section nettement plus profilée, mais de conception voisine. Le Düsseldorf Kniebrücke, en 1969, et le Düsseldorf Flehe, en 1979, ne comportent qu'un seul pylône ; avec leurs portées de 320 et 368 m, ils constituent les plus grands fléaux haubanés du monde, les plus longs câbles dépassant 300 m. Depuis une dizaine d'années, les tabliers en caisson orthotrope - ou à poutres réunies par un platelage orthotrope et des entretoises - sont remplacés par des tabliers en ossature mixte. Le record du monde actuel est détenu par le pont d'Anacis, au Canada, avec une portée de 465 m (1986) ; le tablier est constitué de deux poutres latérales de faible hauteur, réunies par des pièces de ponts, également métalliques, et par une dalle en béton armé réalisée à partir d'éléments préfabriqués. En France, le pont de Seyssel (1987) est encore le seul exemple de ce type.
Quelques rares ouvrages associent le béton précontraint et la construction métallique. C'est le cas du pont de Tampico au Mexique, dans lequel les travées d'accès de chaque côté sont en béton précontraint, ainsi que les amorces de la grande travée, dont la partie centrale est constituée par un caisson orthotrope. C'est aussi le cas du pont de Normandie sur la Seine, entre Le Havre et Honfleur, dont la construction a démarré en 1989 et s'est achevée en 1995 ; il constitue un nouveau record du monde avec sa travée centrale métallique de 856 m de portée, en caisson orthotrope profilé. La hauteur des pylônes est de 215 m.
De nombreux experts considèrent qu'il est possible de construire des ouvrages à haubans jusqu'à 1 500 m de portée. Mais, pour l'instant, les très grandes portées - à partir de 800 m - restent l'apanage des ponts suspendus. Deux grandes écoles s'affrontent aujourd'hui. D'un côté, l'école américaine, avec des ouvrages dont le tablier est un treillis métallique de grandes dimensions, et bien souvent à deux étages de circulation : le pont de Mackinac, construit en 1957 par D. B. Steinman, sur le détroit qui sépare le lac Michigan du lac Huron, est le premier grand ouvrage édifié après l'écroulement du pont de Tacoma, avec une portée centrale de 1 158 m ; il précède de peu le pont du Verrazzano à New York (1 298 m, 1964 ; ). Cette école américaine a largement inspiré la construction en Europe : le pont de Tancarville, réalisé en 1959 sous la direction de Marcel Huet, a détenu quelques années le record d'Europe avec 608 m ; ce fut ensuite l'ouvrage du Firth of Forth (1 006 m, 1964), puis le pont sur le Tage à Lisbonne (1 013 m, 1966). Les grands ouvrages suspendus japonais sont construits suivant les mêmes principes : le Kammon Bridge (712 m) n'a été que le prototype d'une impressionnante série, puisque une douzaine de ponts dépassent ou dépasseront cette portée ; la liaison centrale entre l'île principale, Honshu, et l'île de Shikoku en comporte trois, celui de Shimotsui Seto (940 m) et les ponts nord et sud de Bisan-Seto (respectivement 990 m et 1 100 m), tous achevés en 1988 ; la liaison est de Honshu à Shikoku comportera un ouvrage bien plus exceptionnel, sur le détroit d'Akashi Kaikyo, dont la portée devrait approcher les 2 000 m et dont la construction a commencé en 1989.
L'autre école est anglaise, fortement inspirée par des travaux de Fritz Leonhardt qu'il n'a jamais pu concrétiser. Deux idées majeures dominent la conception. La première consiste à remplacer le tablier en treillis des ponts suspendus classiques par un caisson orthotrope très mince, dont le profilage permet de réduire les efforts produits par le vent et d'assurer la stabilité aéroélastique. La seconde est d'utiliser des suspentes inclinées à la place de suspentes verticales ce qui constitue, avec les câbles porteurs et le tablier, une poutre en treillis de hauteur variable, qui permet un bon étalement des charges routières. La première application a été la construction en 1966 du pont sur la Severn en Angleterre (988 m), suivie par celle du premier ouvrage sur le Bosphore à Istanbul en 1973 (1 074 m), puis par celle du pont sur la Humber (1 410 m) en 1981, qui détient actuellement le record du monde de portée. Tous ont été projetés par le bureau Freeman, Fox & Partners. Le deuxième ouvrage sur le Bosphore est achevé, mais avec des suspentes verticales, pour tenir compte de certaines critiques et des désordres qui ont été constatés sur les suspentes du pont de la Severn, qu'il a fallu remplacer.
De nombreuses solutions sont aujourd'hui imaginées pour construire des ponts de 2 000 m de portée ou plus. Le franchissement des grands détroits est une occasion de développer ces idées : les projets d'ouvrages pour le franchissement du détroit de Messine, de la Manche, du détroit de Gibraltar et du détroit de Patras sont autant de prototypes des grands ouvrages du XXIe siècle.
Les ponts spéciaux
Certains ponts sont tout à fait particuliers, du fait de leurs fonctions ou de leurs conditions de fonctionnement.
Les ponts-canaux sont rares aujourd'hui, car les voies de navigation modernes sont de plus en plus limitées aux basses vallées des grands fleuves : le pont-canal de Toulouse est, en France, le seul exemple récent.
Les ouvrages mobiles sont plus nombreux. Il en existe plusieurs types. Les ponts levants sont constitués d'un tablier aussi léger que possible, en treillis métallique, et de deux tours qui permettent de loger les contrepoids qui équilibrent la masse du tablier. La descente des contrepoids permet un levage rapide du tablier pour laisser le passage aux navires. Les plus grands ponts-levants français sont le pont de Recouvrance sur le Penfeld, à Brest (88 m, 1954), et celui du Martrou sur la Charente (92 m, 1966). Les ponts basculants sont constitués d'un ou de deux fléaux équilibrés, avec une console aussi légère que possible pour franchir la brèche, équilibrée par un contrepoids arrière qui pénètre dans une culasse en béton armé. Le basculement du fléau, autour de son axe d'appui, permet le passage des navires. Le pont de Martigues, à l'entrée de l'étang de Berre, comporte deux fléaux de 27,50 m (1962) ; celui de l'écluse François Ier, au Havre, comporte un seul fléau de 74 m ; enfin, le pont de Bizerte en est une copie fidèle. Il existe aussi des ouvrages tournants : un fléau équilibré tourne autour d'un axe vertical à terre, sur une rive pour les petits ouvrages, ou sur chacune des deux rives pour des portées plus importantes, ce qui dégage un chenal navigable. On peut aussi faire tourner un fléau unique et symétrique autour d'une pile séparant le chenal en deux bras. On construit également des ponts roulants : le fléau, toujours équilibré par un contrepoids, est retiré vers l'arrière en descendant légèrement pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une culasse en béton armé.
Auteur : Michel VIRLOGEUX"
Quelques ouvrages à consulter :
- Ponts, l'esthétique des ponts
- Ponts haubanés
- Les ponts : histoire et techniques de David Bennet (indisponible maintenant dans les bibliothèques de Lyon).
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



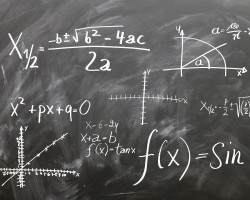
 Sous la colline
Sous la colline