Question d'origine :
Bonjour,
Je cherche des renseignements sur l'itinéraire d'Antonin (Itinerarum Antonini), en particulier la date ou la période de la rédaction de cet ouvrage.
Merci.
Réponse du Guichet
Le 19/05/2006 à 13h00
Il est aujourd’hui reconnu que les itinéraires comportant des distances mesurées sont d’une importance fondamentale dans la construction et le développement des cartes. Il faut cependant faire une distinction entre les itinéraires écrits et les cartes-itinéraires. A l’époque romaine, les premiers étaient les plus communs, car ils étaient utilisés à la fois par les militaires et par les civils. Les itinéraires étaient des listes indiquant les étapes et les distances sur les routes romaines ainsi que des indications utiles pour les voyageurs. Ils étaient assez courants. Les plus anciens itinéraires romains survivants sont les Gobelets Vicarello qui donnent une liste des stations de Cadix à Rome via la vallée du Pô avec les distances entre les étapes successives. Les exemples les mieux conservés sont
Toutefois l’existence dans l’Itinéraire d’Antonin de noms de lieux postérieurs à l’époque de Caracalla, tels que Diocletianopolis pour Pella et Heraclea pour Perinthus suggère que ces itinéraires furent réutilisés avec ou sans corrections pendant une longue période. Un bon exemple d’ajout manifeste se situe en Sicile où entre Catana (Catane) et Agrigentum (Agrigente) deux routes sont données, la seconde incluant la phrase : mansionibus nunc institutis (par les étapes maintenant établies). Il faut donc situer la date de la version finale de l’Itinéraire sans doute entre 280 et 290.
L’organisation qui nécessitait de tels voyages était le cursus publicus établi par Auguste pour le transport des dignitaires et leurs familles et pour la poste officielle. Le cursus publicus avait ses propres listes et dans certains cas des parcours peuvent avoir été copiés directement de ces listes. Mais l’itinéraire d’Antonin n’est pas qu'une version de ces listes, car il comporte de nombreuses omissions, doubles, et détours de routes. Ainsi le Péloponnèse, la Crète et Chypre ne sont pas représentées et des parties considérables de la Gaule, des Balkans et de l’Asie mineure sont représentées d’une manière assez mince. Un bon exemple d’une route à détours est le second voyage en Bretagne (iter II) qui atteint Richborough de Birrens via Carlisle, York, Chester et Londres. Une telle route doit avoir été mise au point pour un voyage particulier, s’arrêtant aux forteresses de York et de Chester entre autres.
La méthode de l’Itinéraire d’Antonin était de lister les points de départ et d’arrivée de chaque voyage et la distance en milles romains (en lieues en Gaule), puis de lister les étapes avec la distance pour chacune d’elle. L’Itinéraire d’Antonin commence à Tanger et couvre la plupart des provinces de l’Empire mais d’une manière non systématique. Il recense et décrit 372 voies sur 85000 kilomètres dans tout l'Empire.
La section de la Bretagne consiste en quinze voyages, certains coïncidant dans la même direction ou au contraire s’opposant. Excepté dans certains cas où elle est clairement altérée, la mesure des distances est tout à fait fiable. Il a été démontré que les distances à partir d’une ville commencent soit du centre, soit de la périphérie. Comme Colchester est appelé à un endroit Camulodunum, dans un autre Colonia, on peut également penser que les parcours n’étaient pas forcément contemporains les uns des autres.
L’interprétation des routes de l’Itinéraire d’Antonin en Gaule du Nord rencontre deux difficultés. L’une est que les distances en Gaule sont données parfois en milles romains, parfois en lieues, parfois dans les deux. L’autre est qu’il y a des différences considérables de mesures entre deux lieux selon le voyage qui est suivi. Il faudrait davantage de recherches non seulement pour étudier ces distances sur une carte moderne mais aussi pour prendre en compte les découvertes archéologiques et épigraphiques.
Si l’itinéraire d’Antonin est le plus célèbre et reste une des principale références cartographiques de l’Antiquité romaine, l ’itinéraire de Bordeaux ou de Jérusalem qui date du IVe siècle constitue un guide de la route pour le pèlerin qui voulait se rendre en Terre-Sainte. La Table de Peuntinger est une reproduction cartographique de tous les « itinéraires » de l’Empire sur une bande de 30cm de large et de 6 m de long.
Traduit d’après J.B. Harley et D. Woodward. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean. University of Chicago Press, 1987 BML. [FA géo 02A]
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



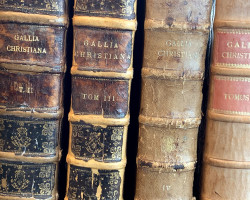
 Je pense que j’en aurai pas
Je pense que j’en aurai pas