Question d'origine :
Quel est le métal, ou l'alliage de métal reconnu comme étant le plus sonore ?
Les Anciens dans l'antiquité disaient que c'était l'airain. L'airain si je ne trompe pas un bronze, mais de quel alliage est-il composé, et quelle est la teneur de ses différents composants ?
Et aujourd'hui quel est le métal ou l'alliage ayant la résonnance la plus importante que l'on puisse se procurer ?
Je suppose que le travail du métal joue aussi sur ses capacités de résonnance (on martèle le métal de certains instruments à vent pour cela), mais ce sont les propriétés sonores due à la nature du métal qui m'intéressent.
Merci par avance.
Réponse du Guichet
Le 16/06/2006 à 13h03
Il nous paraît difficile de répondre précisement à votre question sur les propriétés sonores des métaux, mais nous vous livrons quelques pistes de réflexion...
Le caractère sonore ou pas de matériaux dépend de leur structure. L’élasticité des métaux (déformation, puis retour progressif à l’état initial) est telle que leur déformation est faible ce qui produit un son assez haut. Le module d’Young est la grandeur associée. La durée du son émis est liée à la perte d’énergie ; pour un métal ou un cristal cette perte est faible (on peut définir un facteur de qualité Q qui sera alors très fort). Enfin, il existe des matériaux non métalliques également sonores, par exemple certains bois secs qui servent dans les instruments de percussion (xylophone).
(extrait de Musique et physique de Chérif Zananiri)
Les matériaux dont sont faits les instruments traditionnels sont généralement justifiés pour des raisons variées, acoustiques ou pratiques.
On choisit l'ébène pour la clarinette parce que la grandes masse volumique empêche les parois de vibrer, mais aussi parce qu'il est possible de tourner ce bois, d'y planter des "boules" soutenant efficacement dans le temps les axes de mécanismes, etc.
On choisit l'étain pour les tuyaux d'orgue, parce qu'on peut facilement le souder et le déformer lors de l'harmonisation,etc.
On choisit l'argent ou le maillechort pour la flûte traversière, parce que ces métaux se polissent bien et que la soudure à l'argent y tient.
La fabrication des instruments impose d'innombrables impératifs techniques de ce genre ; chaque fois qu'on a voulu remplacer un matériau traditionnel par un autre, on s'est heurté à des difficultés sans nombre.
(extrait de Acoustique et musique d'E. Leipp)
Pour les sonnailles, la tôle d'acier joue un rôle dans la sonorité surtout par son épaisseur. Selon que la tôle est trop fine ou trop épaisse, la sonnaille rendra un son trop « aigu » ou trop « grave ». Si les tôles ont une influence sur la sonorité, elles ne peuvent, aux épaisseurs où elles sont employées ici, donner une résonance suffisante aux sonnailles qui ne produisent après leur mise en forme qu'un son mat. L'encuivrage seul leur permet de résonner, la noblesse du métal doré, peu corruptible, se trouvant ainsi associée à celle du son élaboré.
Dans le cas des grelots et clochettes, la qualité des matériaux utilisés est encore plus constitutive de la sonorité. Ainsi pour les grelots, le simple fait d'être en métal fondu distingue déjà la production Granier d'autres types de grelots, en tôle emboutie par exemple. La composition de l'alliage intervient ensuite : les bronzes sont ainsi meilleurs que les laitons. Le bronze est le matériau sonore par excellence, dont la qualité et le prix dépendent de la proportion d'étain qu'il contient. Celle-ci reste pour les clochettes et grelots à la discrétion du fondeur.
En revanche, pour les grosses cloches, elle est fixée à 22 % d'étain pour 78 % de cuivre pur, point d'équilibre idéal entre la qualité du son et la solidité de l'alliage. La présence d'autres métaux n'est tolérée que dans des proportions très faibles. En particulier la présence de plomb, qui rend le son de la cloche terne, est tout à fait bannie. Dans ce domaine, le plomb étant bien meilleur marché que l'étain, les tricheries de certains fondeurs peu consciencieux ont défrayé la chronique jusqu'à une époque très récente. Les jours de coulée, moment fort de la représentation des techniques, les lingots d'étain, dont on n'oublie pas de vous rappeler le prix élevé, sont généralement stockés bien en vue du public, en attendant d'être enfournés peu avant la coulée. Autre expression de cette association entre la richesse du métal et la supériorité du son de la cloche, la légende maintes fois rapportée des cloches dont le métal contiendrait une proportion d'or ou d'argent, mêlée au métal en fusion dans le but de leur donner un timbre spécialement argentin. L'anecdote nous a également été rapportée une fois pour les sonnailles. Ainsi des sonnailles aux grosses cloches, se retrouve cette même noblesse du métal de prix, médiateur de la qualité sonore, fixant le timbre de la cloche lors de son passage au feu, fusion ou brasage.
Pour les clochettes et surtout pour les grosses cloches, la température de coulée détermine également la qualité du métal, du point de vue de la sonorité et de la solidité. On constate ainsi que des cloches issues de la même coulée forment un ensemble de sonneries au timbre plus homogène et mieux accordé.
(extrait de Cloches, grelots et sonnailles)
Vous pouvez également consulter la réponse que nous avons élaborée sur :
Quels sont les différents métaux utilisés pour la fabrication des instruments à vent
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



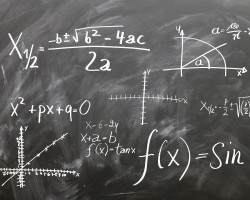
 Le Charlisme : raconté à ceux qui ont jadis aimé Charlie
Le Charlisme : raconté à ceux qui ont jadis aimé Charlie