Combien y a-t-il eu de prototypes de machines à calculer inventées par Blaise Pascal ?
Question d'origine :
Cher guichet,
Les machines à calculer inventées par Blaise Pascal ont-elles été d'une cinquantaine de protoypes fabriqués en 10 ans ? Il n'en restarit que huit ou neuf (Wikipedia) . J'ai entendu dire qu'il y a quelques années des descendants en auraient retrouvé dans leur grenier ?
Qu'en penser ?
Réponse du Guichet
Même si une "horloge à calcul" (rechenuhr) a été décrite par Wilhelm Schickard c'est à Blaise Pascal que nous devons la machine à calculer nommée pascaline. Il en fit 50 prototypes et 3 de ces machines sont conservées à l’hôtel de Fonfreyde. Mais nulle part nous ne trouvons mention de pascalines retrouvées dans les greniers des descendants du savant et philosophe.
Bonjour,
L'article Arithmétique (machine) de L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert numérisée, pp. 136 à 142 sur Google Livres ou pp. 680 à 684 sur Gallica attribue l'invention de la machine à calculer à Blaise Pascal. Nommée aussi pascaline, elle a été conçue et mise au point entre 1642 et 1645.
Les articles Qui a inventé la calculatrice ? du magazine ça m'intéresse et Cabinet de curiosités : la pascaline, première calculatrice de l'Histoire de Futura Sciences, confirment qu'il y en a eu 50 prototypes et que 8 de ces machines existent encore de nos jours.
"C’est en 1645, après trois ans de recherche et cinquante prototypes, que Blaise Pascal présente sa première machine. Il construit ensuite une vingtaine de Pascalines dans la décennie suivante et les perfectionne à chaque fois",
source : Qui a inventé la calculatrice ?, ça m'intéresse.
"En 1645, ce bijou de technologie représente trois ans de travail, 50 prototypes et se solde par un échec commercial retentissant. Comme beaucoup de machines présentées dans leurs premières années de création, la Pascaline est trop chère pour le grand public ou même pour un public aisé, avec un prix allant de 100 à 400 livres (soit entre 3.500 et 14.000 euros environ). Pascal ne se laisse pas abattre pour autant et continue de perfectionner sa machine durant des années afin d'en réduire le coût. Malheureusement, un traumatisme crânien causé par un accident de carrosse l'amène à se retirer du monde scientifique en 1654".
source : Cabinet de curiosités : la pascaline, première calculatrice de l'Histoire, Futura Sciences.
Mais pour être plus exact, nous nous en remettons à l'ouvrage de Jean Marguin paru en 1994, Histoire des instruments et machines à calculer: trois siècles de mécanique pensante : 1642-1942 grâce auquel nous apprenons qu'une machine arithmétique avait été décrite dans des échanges épistolaires de 1623 entre Wilhelm Schickard et l'astronome Kepler. Schickard la nommait "horloge à calcul" (rechenuhr).
D'ailleurs ce que tu as réalisé sur le plan algébrique, je l'ai dernièrement tenté sous une forme mécanique : j'ai conçu une machine composée de onze roues complètes et de six roues mutilées ; elle calcule à partir de nombres donnés d'une manière instantanée et automatique, car elle ajoute, retranche, multiplie et divise. Cela te divertirait fort de voir par toi-même comment cette machine accumule et transporte spontanément vers les rangs de gauche une dizaine ou une centaine, et comment, au contraire, elle retranche la retenue à propos d'une soustraction.
Cette correspondance datée du 20 septembre 1623 et découverte en 1957 par le Dr Franz Hammer, bouscule l'idée préconçue qu'on avait de l'inventeur de la machine à calculer. Une mise au point fut faite par René Taton en 1963 :
Aussi, dans l'état actuel de la question, nous paraît-il légitime de considérer Schickard comme le principal précurseur du calcul mécanique, mais non comme l'inventeur de la machine à calculer. Une invention ne peut en effet être authentifiée que si elle a été présentée à des témoins dignes de foi, puis diffusée et mise en service. Tel n'est pas le cas de la machine de Schickard qu'aucun contemporain ne signale avoir vue et dont seule mention se trouve dans deux lettres de Kepler, dont la plus importante n'a été que récemment retrouvée. Tel est le cas, par contre, de l'additionneuse de Pascal...
Et les écrits de Pascal attestent bien que démonstration de sa machine fut faite devant des savants et des prélats :
Ami lecteur, cet avertissement servira pour te faire savoir que j'expose au public une petite machine de mon invention, par le moyen de laquelle seul tu pourras, sans peine quelconque, faire toutes les opérations de l'arithmétique, et te soulager du travail qui t'a souvent fatigué l'esprit, lorsque tu as opéré par le jeton ou par la plume : je puis, sans présomption, espérer qu'elle ne te déplaira pas, après que Monseigneur le Chancelier l'a honorée de son estime, et que, dans Paris, ceux qui sont les mieux versés aux mathématiques ne l'ont pas jugée indigne de leur approbation.
Plus loin, il ajoute :
C'est celle de laquelle, comme j'ai déjà dit, je me suis servi plusieurs fois, au vu et su d'une infinité de personnes, et qui est encore en état de servir autant que jamais.
Pascal précise dans ce même extrait, qu'il a réalisé trois modèles avant d'obtenir une machine satisfaisante et d'en fabriquer 50.
Source : Œuvres complètes de Blaise Pascal : Physique ; Mathematiques, 1880, numérisé sur Google Livres.
Dans son livre, Jean Marguin note que si cette machine a vu le jour à ce moment là, c'est aussi parce que toutes les conditions techniques du machinisme alliées à celles des théories et pratiques de la numération, étaient réunies. Nous ne développerons pas davantage ce sujet car cela nous entraînerait vers un historique de la machine à calculer passionnant mais éloigné de votre question. Soulignons tout de même que
Dans l'histoire du machinisme, la machine arithmétique est le premier exemple de machine à traiter l'information. En termes modernes, c'est un processeur d'information. Elle représente un saut significatif dans la complexité et constitue sans aucun doute une étape importante du processus de dématérialisation des machines qui s'est affirmé au cours des siècles suivants et se poursuit actuellement. (Jean Marguin)
Concernant la localisation des pascalines, nous savons que
deux machines arithmétiques surnommées « Pascalines » et appartenant à la Ville de Clermont-Ferrand proviennent directement de la famille de Blaise Pascal. Elles avaient été léguées par Marguerite Périer, fille de Gilberte Pascal et de Florin Périer et donc nièce de Blaise, à l’Oratoire de Clermont. Après la Révolution, la machine dite « de Marguerite Périer », inv. n° 138, entre dans les collections publiques. Conservée dans différentes institutions, elle est enfin présentée dans les murs de l’hôtel de Fonfreyde, alors musée du Ranquet. Elle y est rejointe par la machine dite « du chevalier Durant-Pascal » inv. 985-23-1 à 3 (la machine, le coffret et la notice), acquise par la Ville en 1985. Cette dernière, au moment de la Révolution, avait été récupérée par le chevalier Durant-Pascal.
Source : Les dernières tribulations des pascalines de Clermont-Ferrand, Pierre Pénicaud, in Courrier du Centre International Blaise-Pascal [En ligne], 28 | 2006, mis en ligne le 02 décembre 2015.
Quant à savoir si les descendants de Blaise Pascal ont trouvé des pascalines dans leur grenier, c'est une autre histoire. Nous ne trouvons aucune mention de cela sur nos sites ressources françaises ou anglaises. Nous avons trouvé toutefois un descendant à la 12e génération d'une cousine au 6e degré de Blaise Pascal. Jacques Chanis, généalogiste, a réalisé l'arbre de son aïeul. Il est possible de le contacter via Généanet en créant un compte.
Pour comprendre le mécanisme de la pascaline :
Pour approfondir le sujet
La pascaline, la « machine qui relève du défaut de la mémoire », Daniel Temam, Bibnum, Calcul et informatique, mis en ligne le 01 mars 2009
Les machines de Pascal : du bon usage des ressorts / Anne Frostin, 2018
Qu'est-ce que la machine de Pascal ? France culture, épisode de Sans oser le demander du mercredi 24 novembre 2021
Bonne journée.



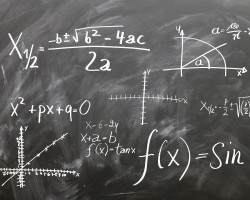
 Mémo visuel d’agronomie :
Mémo visuel d’agronomie :