Les végétaux ont-ils une conscience ?
Réponse du Guichet
Si pour certain·es les végétaux ont une conscience, de quelle conscience s'agit-il ? "La communication électrique chez les plantes et la circulation de messages via des ondes de dépolarisation membranaire" suffisent-elles pour affirmer qu'ils en ont une ? Peut-on parler d'intelligence végétale ? Les avis sont partagés, argumentés et étayés dans notre réponse par des extraits d'articles publiés en revue ou sur le Net.
Quant à la douleur chez les végétaux, elle ne semble pas être ce que les médias grand public aiment à répandre.
Bonjour,
Ces dernières années il est de plus en plus courant d'entendre dire que les plantes ont une conscience voire une intelligence mais les points de vue divergent selon les chercheurs.
Ainsi, pour certains, le comportement d’une plante serait proche de celui d’une machine, alors que d’autres y voient une proximité avec celui de l’animal ou même avec des spécificités de l’esprit humain.
Afin de comprendre ces débats, il convient de s’entendre sur l’histoire et la nature de ce concept d’intelligence et de ses enjeux avant de se demander s’il peut ou non s’appliquer aux plantes et dans quelle mesure. L’intelligence peut être analysée sous plusieurs approches : la cognition, la communication, la mémoire, l’apprentissage, la rationalité ou la conscience. Quelles sont les expériences scientifiques et les positionnements philosophiques qui étayent ou contestent la présence de ces facultés chez les plantes ?
Source : Du comportement végétal à l'intelligence des plantes ?, INRAe, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, 2020
Cette page INRAe cite également des extraits du livre éponyme écrit par Quentin Hiernaux, chargé de recherche au Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS) et enseignant à l’université libre de Bruxelles, qui donnent des éclairages sur la conscience et des références antérieure à 2000 sur le sujet :
La philosophie reconnaît en réalité plusieurs formes de conscience (elles-mêmes relativement interdépendantes). À côté de la conscience réflexive existe une conscience spontanée, c’est-à-dire une conscience immédiate de son environnement (Lalande, 1996, ibid.). L’existence d’une telle conscience (awareness) chez tous les êtres vivants et donc chez les plantes a été défendue par certains scientifiques (Margulis et Sagan, 1995 ; Chamovitz, 2014 ; Trewavas, 2014, chap. 25). Les plantes ont ainsi conscience du type de lumière ou de contact, de la gravité et des signaux chimiques qui les atteignent, de leurs expériences passées et des conditions de leurs modifications physiologiques antérieures (Chamovitz, 2014, p. 166).
(...)
Des formes de reconnaissance de soi (une conscience corporelle ou « sociale »), qui impliquent plus que la simple connaissance immédiate de l’environnement, invitent à s’interroger sur une forme intermédiaire de conscience. De telles facultés se manifestent de diverses manières qui demandent toutes de posséder au minimum un système de valeurs différenciant le soi et l’environnement de la plante.
Dans «La communication chez les plantes : biologie et performativité» publié dans Communications, no. 1, 2022, ce même auteur souligne quelques problèmes épistémologiques soulevés par cette question :
Sans aller nécessairement jusqu’à utiliser un vocabulaire anthropomorphique, les études biologiques récentes sur les plantes soulèvent des problèmes épistémologiques à propos des nouveaux dispositifs expérimentaux et de l’interprétation de leurs résultats. Les controverses qui animent des revues de physiologie végétale au sujet de l’apprentissage, de l’intelligence ou de la conscience des plantes depuis maintenant une quinzaine d’années en témoignent. Les attaques des sceptiques portent en partie sur la robustesse des données, le manque d’observations ou d’autres éléments empiriques et méthodologiques. Toutefois, elles tiennent aussi à des divergences conceptuelles et philosophiques liées à la polysémie des termes, à la pertinence des métaphores en science, à la portée explicative des analogies, à la survalorisation de modèles de compréhensions animaux, à un cadre anthropocentré, au poids de préjugés historiques, voire à des erreurs de raisonnement… Ce flou interprétatif sur fond de polémique explique sans doute en partie les fantasmes et les espoirs au sujet des aptitudes des végétaux que les pseudo-sciences et l’ésotérisme font parfois naître dans le grand public. Si les sciences du vivant et plus encore du comportement ne sont pas des sciences exactes, cela signifie-t-il pour autant que toutes les interprétations des phénomènes se valent ?
Mais avec ce texte Hiernaux veut "contribuer à éclairer le débat sur la « question végétale » dont il étudie une dimension bien particulière" à travers la communication qui est une forme d'intelligence (intelligence interpersonnelle) parmi les 9 selon la théorie des intelligences multiples de Gardner. Cette intelligence permet de communiquer avec les autres et de résoudre des problèmes. En interprétant "les différences et les analogies qui existent entre le langage humain et la communication végétale grâce aux outils de la théorie des actes de langage d’Austin", il conclut ainsi :
Parler de communication chez les plantes, et plus généralement au sein du vivant, s’avère donc légitime dans la mesure où les fonctions et les finalités performatives de la communication biologique ne sont ni dues au hasard ni entièrement déterminées, programmées et invariables, comme le serait une machine ou une réaction à un stimulus de type réflexe.
Selon lui, les plantes auraient donc bien une conscience.
C'est également l'avis de Stefano Mancuso, auteur de L'intelligence des plantes. Dans "Les plantes sont les vrais moteurs de la vie sur terre" sur France Culture en 2019, celui-ci disait "Les plantes ont des récepteurs partout" c'est le "cerveau diffus". Pour lui, si la définition de l'intelligence est "la capacité à résoudre des problèmes", alors les plantes sont intelligentes.
Stefano Mancuso, biologiste est, avec Frantisek Baluska, celui qui a forgé l'expression "neurobiologie végétale", devenue un domaine de recherche en 2006. Polémique à l'époque (tout comme l'expression "intelligence végétale"), cette idée était peut-être moins folle qu'on le pensait. François Bouteau et Patrick Laurenti, dans La neurobiologie végétale, une idée folle ? publié dans la revue Pour la science en 2018, signalaient qu'elle n'était pas récente :
Suite aux travaux pionniers de l’Italien Luigi Galvani à la fin du XVIIIe siècle, l’explorateur Allemand Alexander von Humboldt réalisa de multiples expériences concluant à une similarité de la nature bioélectrique des animaux et des plantes. Plus encore, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des potentiels d’action, c’est-à-dire des messages électriques qui se transmettent, furent mis en évidence chez divers végétaux, principalement la dionée et le mimosa pudique. Ainsi, l’excitabilité de certaines cellules végétales serait un moyen de communication intercellulaire chez ces organismes.
Pour François Bouteau, directeur du Laboratoire d'électrophysiologie des membranes (LEM), à l'université Paris-Diderot, il est certain que les plantes ont une neurobiogogie :
La communication électrique chez les plantes et la circulation de messages via des ondes de dépolarisation membranaire ont été mises en évidence il y a des années, rappelle-t-il. Et l'on sait désormais qu'il y a chez les plantes des phénomènes d'exocytose et d'endocytose, soit d'expulsion et d'absorption membranaires de molécules, qui rappellent beaucoup les synapses nerveuses des animaux. Certes, les plantes n'ont ni neurones, ni synapses, ni organe qu'on puisse qualifier de cerveau; chez elles, tout va bien plus lentement... mais on peut bel et bien parler de neurobiologie végétale.
Source : Intelligence des plantes : un règne végétal à repenser, Science & Vie, février 2013 - article disponible en biliothèque ou via Europresse par les abonné·es de la BML.
L'article de Science & Vie rapporte également que ce serait par les racines que les plantes communiquent.
Difficiles à étudier car enfouies sous terre, les racines des plantes ont longtemps été négligées. Aujourd'hui pourtant, on examine de plus en plus leur grande sensibilité et leurs comportements sophistiqués et souvent coordonnés. Siège d'une activité chimique et électrique importante, capables d'envoyer des signaux aux tiges et aux feuilles comme d'en recevoir, elles sont vues par certains comme le "cerveau décentralisé" des plantes, qui contrôle l'ensemble de leurs activités.
1. Les racines sont toutes interconnectées
Les racines convergeant toutes vers la base de la tige, chacune d'entre elles est en relation avec toutes les autres. Elles forment donc un réseau où circulent sans cesse, dans toutes les directions, informations et nutriments.
2. Elles intègrent les nombreux signaux reçus
Les racines intègrent et combinent de façon complexe les différents signaux qu'elles reçoivent, afin de produire un comportement; certains signaux sont jugés prioritaires. La détection de rivales, par exemple, modifie les stratégies d'exploration.
A ces questions, les tenants de la neurobiologie végétale ont une réponse fascinante, quoique contestée empruntée du reste à Darwin (voir l'encadré ci-contre). Les plantes auraient un cerveau distribué, situé à l'extrémité des racines. Ils argumentent que la pointe de chaque racine possède une zone dite "de transition", située entre le premier et le second millimètre, où se fait l'intégration des multiples informations qu'elle reçoit (voir l'infographie ci-dessus). Stefano Mancuso aime à montrer le film en accéléré d'une radicelle progressant le long d'une surface plane : elle évoque irrésistiblement un ver, ralentissant périodiquement et relevant la "tête", la pointant à gauche et à droite, semblant humer son milieu avant de repartir. Chaque racine mesure ainsi en continu au moins 15 paramètres physiques et chimiques, et détermine sa trajectoire en fonction. Si l'on coupe l'extrémité de la racine, ce comportement exploratoire disparaît : l'organe continue à s'allonger en ligne droite, rapidement, mais il semble avoir perdu toute sensibilité à l'environnement, sa "zone de transition" ayant disparu.
3. Elles ont un pic d'activité électrique aux extrémités
La zone de transition, située entre le 1er et le 2nd millimètre de l'extrémité de chaque radicelle, est parcourue par des courants de faible intensité. C'est la partie de la plante où se déroule la plus forte activité électrique, celle qui consomme le plus d'oxygène.
4. Elles échangent des signaux électriques et chimiques
Avec la sève circulent de multiples molécules qui vont des feuilles et des tiges vers les racines, et inversement. Des signaux électriques ont également été mis en évidence, par exemple pour transmettre aux feuilles l'ordre d'évaporer moins d'eau en cas de sécheresse.
5. Elles adaptent leur croissance
La croissance des racines varie constamment. Selon les informations reçues, elles changent d'orientation, accélèrent, ralentissent, se ramifient... En revanche, si la pointe de la racine est coupée, la croissance est uniforme.
6. Elles sont très riches en capteurs de toutes sortes
On sait déjà que les racines sont sensibles à la température, à l'humidité, aux nutriments du sol, aux signaux émis par leurs congénères ainsi que par les bactéries et champignons du sol. Elles distinguent le haut du bas, fuient la lumière, et réagissent même à certains sons !
Au niveau des forêts, ce réseau de communication végétale a largement été décrit dans La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, un monde inconnu s'ouvre à nous de Peter Wohlleben. Voir aussi Comment les arbres communiquent entre eux : découvrez le "réseau internet" de la forêt, France info.
A ces chercheurs s'opposaient le professeur Lincoln Taiz de Santa Cruz et ses collègues. Dans Plants Neither Possess Nor Require Consciousness, Biologists Say, le site sci-news fait part d'un article de synthèse publié en juillet 2019 dans la revue Trends in Plant Science de l'Université de Californie, où sont exposés leurs arguments contre l'idée que les plantes possèdent une conscience. Taiz et ses co-auteurs soutiennent que les partisans de la neurobiologie végétale établissent des parallèles en décrivant le cerveau comme quelque chose qui ne serait pas plus complexe qu’une éponge. Ils reprochent à la neurobiologie végétale de ne pas prendre en compte l'importance de l'organisation cérébrale, la complexité et la spécificité du phénomène de la conscience. A ce propos vous pouvez lire l'article en français Les plantes possèdent-elles une conscience ? publié sur Trustmyscience.
Dans Les plantes souffrent-elles aussi ? publié publié par Echosciences Grenoble en 2019, Eugenia Brun Hernández, docteure en biologie végétale, rappelle d'abord de quoi les plantes sont capables :
Elles sont tout d’abord des êtres de lumière, façonnées pour percevoir l’énergie lumineuse. À titre comparatif, on compte 14 types différents de photorécepteurs chez la plante alors que nous en possédons seulement 4 (Chamowitz, 2012). Les plantes sont aussi sensibles aux odeurs, elles peuvent émettre des substances chimiques volatiles lors d’une attaque par des insectes, ce qui a une répercussion sur les plantes environnantes. Cette perception de substances volatiles permet même à certaines plantes d’orienter leur croissance. L'émission de composés volatils joue aussi un rôle crucial dans l’interaction des plantes à fleurs avec des pollinisateurs, notamment pour les attirer et augmenter ainsi leurs chances de disperser leur pollen (Labandeira Kvacek & Mostovski, 2007). Le son est également perçu par les végétaux. Mais attention, ce n'est pas le style de musique écoutée qui leur fait de l’effet mais les fréquences sonores dont la musique est formée. Ces fréquences peuvent favoriser la germination de leurs graines, leur croissance, ou l'allongement de leurs racines, mais aussi avoir des effets inhibiteurs (Hassanien et al., 2004). Pour les plantes le son n'a qu'une dimension vibratoire.
En tout, il a été démontré que les plantes peuvent percevoir au moins 20 paramètres physiques et chimiques dont, entre autres, le taux d'humidité, les champs électromagnétiques, des gradients électriques, des gradients chimiques, la pesanteur (Morot-Gaudry & Prat, 2012). On pourrait dire que ce qu’elles perdent en mobilité à ne pas avoir de jambes ou de pattes, elles le gagnent en souplesse génétique. En d’autres termes, puisqu’elles sont des organismes sessiles, c’est-à-dire des organismes fixés au sol, elles doivent percevoir les signaux environnants avec une sensibilité et discrimination accrues en comparaison avec les animaux (Trewavas, 2009).
Puis elle donne des explications plus nuancées sur la neurobiologie des plantes :
Les plantes sont dépourvues de nerfs, cela veut dire qu’elles ne possèdent pas les organes dédiés à la transmission des signaux électriques que les animaux utilisent pour la conduction de ces signaux. Malgré les ressemblances, l'architecture générale des voies de communication internes d'un végétal se distingue nettement de celle qui caractérise le corps des animaux. Ces derniers sont dotés d'un cerveau vers lequel convergent tous les signaux. Les plantes quant à elles disposent de structures en modules répétés, notamment de nombreux méristèmes ou « centres d'élaboration de données » comme les appellent Stefano et Viola (2013). Ceux-ci permettent un traitement des signaux très différent du nôtre.
Même si effectivement des mouvements d'ions calcium appelés « des ondes de calcium » apparaissent chez tous les êtres multicellulaires dont les plantes, qui ont aussi des potentiels électriques similaires à ceux du règne animal, seuls les animaux présentent une activité neuronale. Cette activité est responsable des fonctions cognitives telles que la pensée ou la capacité à avoir l’expérience subjective de la souffrance (Pereira & Alves, 2019). Il est clair qu’il existe des mécanismes communs à tout le vivant. Néanmoins, la physiologie des végétaux repose sur d'autres principes que celle des animaux et cette différence essentielle a aussi été jusqu'à aujourd'hui un des principaux obstacles à une compréhension approfondie des plantes et à la reconnaissance de leurs capacités.
Son article très référencé est suivi d'une bibliographie rassemblant majoritairement des titres anglophones.
A propos de la douleur chez les plantes, dans Les plantes ressentent-elles la douleur ?, Natacha Zimmermann sur Slate en 2022 écrit :
En 2014, des chercheurs de l'université du Missouri ont découvert que certaines plantes pouvaient «entendre» les vibrations des chenilles qui grignotent leurs feuilles et ainsi déclencher des défenses chimiques pour les contrer. Il en est de même pour les feuilles en train d'être mangées : les cellules signalent le danger aux autres parties de la plante, qui se préparent alors à réparer les dégâts, précise Discover. Une réponse que certains n'hésitent pas à comparer à un système nerveux.
Mais pour Eugenia Brun Hernández, "il n’y a tout simplement aucune étude scientifique qui trouve la moindre trace de douleur chez les plantes ni même des études qui le suggéreraient. Nous ne pouvons donc pas dire aujourd’hui que les plantes souffrent."
Il n‘y a aucun doute, les cellules réagissent à des signaux associés à une blessure, mais être sensible à une blessure ne prouve en rien qu’il y ait une souffrance qui en découle. Par exemple, Antoine Larrieu a observé lors d’une étude sur la réponse des plantes aux agressions en 2014 qu’il suffisait «de déposer un broyat de plante sur une feuille pour déclencher une réponse à la blessure. Cela permet notamment à la plante de se préparer à d’éventuels dommages supplémentaires».
[..]
La souffrance est une expérience consciente. Elle représente une cascade d'effets physiologiques, immunologiques, cognitifs et comportementaux (National Research Council, 2009). Pour pouvoir ressentir de la douleur il faut avoir des nocicepteurs. Ces structures font partie d’un système nerveux qui existe chez les vertébrés. La nociception est un premier stade nécessaire mais pas suffisant pour éprouver de la douleur (Balcombe, 2018). Le prochain stade nécessaire pour éprouver de la douleur est, d’après la IASP (Association international pour l’étude de la douleur), l'expérience de la "douleur" elle-même, ou de la souffrance, qui est définie comme l'interprétation interne et émotionnelle de l'expérience nociceptive. Comme le chercheur Jacques Tassin l’a très bien exprimé : la réaction d’une plante à un stimulus négatif « ce n’est ni de l’automatisme ni de la douleur, mais une forme de complexité du vivant ». Essayons de reconnaître les plantes pour ce qu’elles sont, des êtres omniprésents sur la Terre et bien plus sophistiquées qu'on ne le croyait.
Selon Jean-Baptise Veyrieras, dans Les végétaux ressentent-ils la douleur ? publié sur Science&Vie en 2020, "si les plantes perçoivent la douleur, elles ne souffrent pas pour autant. [...] aucune étude scientifique n’a prouvé l’existence de récepteurs de la douleur chez les plantes, à l’image des nocicepteurs chez les animaux, ces neurones sensoriels chargés de percevoir les stimuli et de produire un signal douloureux."
Pour Taiz "les plantes n'ont tout simplement pas besoin de conscience, ni de douleur. Alors que les sensations désagréables ont appris à nos ancêtres à éviter une menace imminente - à retirer leurs mains du feu, pour ainsi dire - les plantes ont développé leurs propres stratégies inconscientes. De plus, les blessures corporelles ne sont pas une préoccupation grave pour un organisme qui peut se régénérer à volonté", Can Plants Feel Pain?, Cody Cottier, discover, may 2021
Pour finir, Eugenia Brun Hernández invite à accueillir la différence et à la considérer comme une richesse :
À mon avis, penser que les plantes souffrent ou qu’elles aiment écouter du Mozart relève d’une mauvaise utilisation de l'anthropomorphisme. Celui-ci peut être décrit comme la tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. Il n’est pas en soi bon ou mauvais mais un outil dont nous nous servons. Plus l’espèce étudiée est proche de nous en termes phylogénétiques, plus l'anthropomorphisme est pertinent. Au contraire, moins une espèce est proche de nous, moins l'anthropomorphisme va nous aider à la comprendre. Nos hypothèses doivent tenir compte des connexions évolutives.
Nous avons aujourd’hui plus que jamais, l'opportunité d’étudier le règne végétal en profondeur. Nous pouvons le faire en ayant une approche qui part du point de vue du sujet que l’on étudie. Cette opération est une ouverture sur l’altérité, la reconnaissance de l’autre. C’est un exercice qui demande l’effort de sortir des préjugés passés mais c’est le prix à payer pour mieux connaître les plantes.
Petite bibliographie de livres à lire si vous souhaitez approfondir le sujet :
- Philosophie du végétal : botanique, épistémologie, ontologie / textes réunis par Quentin Hiernaux, 2021
- La femme qui tendait l'oreille aux plantes : le récit incroyable d'une biologiste entre découvertes scientifiques et rencontres avec l'esprit des plantes / Monica Gagliano, 2021
- Les émotions cachées des plantes/ Didier van Cauwelaert, 2020
- La révolution des plantes : comment les plantes ont déjà inventé notre avenir / Stefano Mancuso, 2019
- La conscience des plantes : une plongée fascinante au coeur des dernières découvertes du monde végétal / Joseph Scheppach, 2018
- L'intelligence des plantes / Stefano Mancuso, Alessandra Viola, 2018
- L'intelligence des plantes : les découvertes qui révolutionnent notre compréhension du monde végétal / Fleur Daugey, 2018
- La plante et ses sens / Daniel Chamowitz ; préface de Jean-Marie Pelt ; traduit de l'anglais par Jeremy Oriol, 2014
- Les langages secrets de la nature : la communication chez les animaux et les plantes / Jean-Marie Pelt, 1996
Bonne journée.



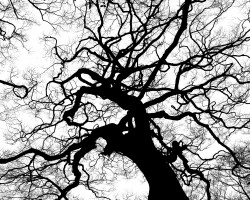
 Le jardin d’Emily
Le jardin d’Emily