Où s'habillait l'homme du peuple à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle ?
Question d'origine :
Bonjour,
Où s'habillait l'homme du peuple à Paris dans la seconde moitié du XIX e siècle ?
Merci et joyeuses fêtes à toute l'équipe du Guichet du savoir !
Réponse du Guichet
Les classes populaires achetaient leurs vêtements auprès de coopératives de consommation, de magasins à succursales multiples et dans les grands magasins populaires vendant à crédit comme par exemple les Magasins Dufayel.
Bonjour,
Tout d'abord, permettez-nous de vous souhaiter une excellente année 2023 !
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les ouvriers passent de la blouse à l'habit. C'est ce que nous explique Fabrice Laroulandie dans son ouvrage intitulé Les ouvriers de Paris au XIXe siècle qui répond à vos interrogations :
Pendant la première moitié du siècle, les ouvriers s'habillent chez les fripiers ou les revendeurs qui alimentent le marché des vêtements d'occasion. Dans le quartier du Temple, à la "Halle au vieux linge", on peut se vêtir de la tête au pied dans l'un des quatre hangars où s'activent près d'un millier de marchands. Pour le neuf, exceptionnel, les ouvriers doivent recourir au crédit du tailleur de quartier qui fournit le drap. Or à partir du Second Empire, le développement du prêt à porter sonne peu à peu le glas de la friperie en mettant le vêtement neuf à la portée des petits budgets : pionnier dans ce domaine, le magasin La Belle Jardinière vend dès la fin des années 1820 des vêtements de travail, puis du dimanche, faits d'avance, à l'usage d'une clientèle populaire. Le système de l'abonnement, à la fin du siècle, facilite le renouvellement et une plus grande variété des garde-robes.
On trouve trace de cette évolution dans la comparaison des deux budgets de charpentiers en 1856 et en 1890.
Le ménage de l'ouvrier du Second Empire s'inscrit encore dans le cycle d'Ancien Régime des vêtements qui ignore l'achat du neuf : les vêtements se lèguent (une partie du trousseau de l'ouvrière a été reçue en héritage de sa sœur), se conservent d'autant plus longtemps qu'ils sont portés rarement (les habits du dimanche étrennés le jour des noces du couple ont quinze ans d'âge), s'achètent d'occasion (le paletot, la robe en laine) et, pour l'essentiel, se confectionnent à la maison. L'épouse, ancienne couturière, a fait elle-même son petit trousseau avant son mariage et coud pour son mari des chemises et des gilets de flanelle. Gardienne d'une économie domestique de la récupération, elle rafraîchit inlassablement les vêtements de la famille et met les ressources de son aiguille au service d'une résurrection des effets hors d'usage : avec les habits du père, elle habille le fils et adapte ses vêtements élimés pour la fillette. Ses propres jupons sont taillés dans de vieilles robes.
Le neuf, en revanche, est entré dans les habitudes vestimentaires du ménage de la fin du siècle : le charpentier renouvelle régulièrement certains vêtements de travail et ses habits du dimanche ne sont pas destinés à durer aussi longtemps que ceux de son collègue du Second Empire. Les vêtements du dimanche du ménage de 1856, bijoux compris, valent 437 F, soit la moitié du montant du mobilier ; ceux du ménage de 1890 sont estimés à 478 F, dépassant 60% de la valeur des meubles. En 1890, la femme achète une robe de coton et de laine presque chaque année ainsi que deux jupes de coton. [...]
Le désir de belle allure se satisfait plus facilement à la fin du siècle : tous les observateurs le répètent, la rue parisienne s'embourgeoise. Dans ses Misères et remèdes (1885), le comte d'Haussonville constate que "les dimanches et jours de fête, la blouse disparaît complètement, et il n'y a plus guère d'ouvriers qui ne prennent tournure de demi-bourgeois."
Jean-Claude Daumas précise :
Traditionnellement, les classes populaires s’approvisionnaient en vêtements chez les fripiers et en meubles chez les brocanteurs mais, dans la seconde moitié du XIXe siècle, leur univers a été bouleversé par l’apparition de formes de commerce modernes : les coopératives de consommation, les magasins à succursales multiples et les grands magasins populaires. Toutefois, l’historiographie du commerce les a longtemps ignorées. Ce fut tout particulièrement le cas, jusqu’à une date récente (Albert, 2012), pour les grands magasins populaires vendant à crédit auxquels elle accordait au mieux quelques lignes ou une note de bas de page pour signaler leur existence, alors même qu’ils ont joué un rôle essentiel dans l’extension de la consommation populaire. Les contemporains, Georges d’Avenel, André Saint-Martin ou Charles Couture, au contraire, en avaient parfaitement conscience mais se sont essentiellement intéressés aux Magasins Dufayel qui étaient les plus considérables.
À la Belle Époque, les grands magasins vendant à crédit aux classes populaires pullulaient dans Paris : d’après le Bottin du commerce, il y en avait 31 en 1883 et 44 en 1913 ; ils étaient particulièrement concentrés dans le centre de la capitale, à proximité du quartier du Sentier et du faubourg Saint-Antoine (Albert, 2015, p. 196-197). Ils avaient pour nom les Grands Magasins Dufayel, Au Bon Génie, Aux Classes Laborieuses, Aux Phares de la Bastille, Le Pèlerin de Saint-Jacques, Aux Bons Travailleurs, Aux Enfants de la Chapelle, etc. Ces magasins qui vendaient essentiellement des meubles, des objets de la maison, des vêtements et des chaussures, appliquaient certes les mêmes procédés commerciaux que les grands magasins bourgeois, mais ils s’en distinguaient, d’une part, par la pratique de la vente à crédit, et de l’autre, par une offre commerciale adaptée à la clientèle en termes de qualité et de prix, sans qu’on puisse être plus précis faute de disposer de leurs catalogues, à l’exception de ceux de Dufayel.
source : Les grands magasins et la modernisation du commerce de détail au XIXe siècle / Jean-Claude Daumas
Vous pouvez aussi consulter ces documents écrits par Anaïs Albert :
La vie à crédit [Livre] : la consommation des classes populaires à Paris, années 1880-1920
Bonne journée.




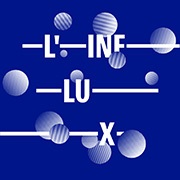 Les dessous du maillot de bain
Les dessous du maillot de bain