Question d'origine :
sommes-nous dans des sociétés insécures ? L'insécurité est-elle objet d'analyses philosophiques ? quelles émotions y président ? Comment la combattre politiquement ?
Réponse du Guichet
Le sentiment d'insécurité est un phénomène difficile à évaluer et à replacer dans une perspective historique. Il est en tous cas à dissocier des chiffres de l'insécurité eux-mêmes. Les peurs individuelles peuvent entrer en résonance entre-elles et émerger sur des peurs collectives issues de représentations sociales véhiculées et amplifiées par les médias et les discours ambiants.
Le philosophe Thomas Hobbes a cherché comment échapper au sentiment d'insécurité. Nous vous laisserons prendre connaissance des documents cités en bibliographie pour aller plus loin sur ces questions.
Bonjour,
Vivons-nous dans une société insécure ?
La société actuelle est-elle vraiment plus insécure qu'au Moyen-Âge où la famine, les guerres et la peste pouvaient apparaître particulièrement anxiogènes ?
Nous vous invitons à consulter cet article qui replace le sentiment d'insécurité dans une perspective historique :
DENYS, Catherine. Insécurités ? Des insécurités vécues aux discours sécuritaires policiers dans les villes de l’Europe septentrionale au XVIIIe siècle In : La ville en ébullition : Sociétés urbaines à l’épreuve. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014
Les historiens peuvent sembler démunis pour proposer une mesure du sentiment d’insécurité et évaluer les transformations de ce dernier. Quelle est la réalité de la violence perçue ?
Dans cet article "Expliquer le sentiment d'insécurité : pression, exposition, vulnérabilité et acceptabilité" (Revue française de science politique, 48ᵉ année, n°2, 1998. pp. 274-305) , Sebastian Roche dissocie le sentiment d'insécurité des faits de violence :
On peut se demander si le sentiment d'insécurité est autre chose que l'expression actuelle de la tendance historique longue à la «sensibilisation à la violence» dans un contexte plutôt défavorable. Il faut honnêtement reconnaître que le modèle Prexvu et l'ensemble des chiffres présentés ne permettent pas complètement de traiter la question. Il est en effet possible que la sensibilité à la violence et la délinquance grandissent toutes les deux, en parallèle. On tend souvent à se demander si l'une ou l'autre croissent, comme s'il y avait là une sorte d'exclusive et une opposition de substance entre les «faits» et les «opinions». Il est imaginable que la sensibilité à la violence continue à faire son chemin et que celle-ci rende de plus en plus intolérable les délits que nous connaissons, favorisant ainsi l'expression d'un sentiment d'insécurité. Sur une moyenne ou une longue période, il est moins facile qu'il y paraît d'opposer le sentiment et les délits. Perspectives comptables et émotionnelles ne sont pas des registres si disjoints : la sensibilité d'un collectif détermine le niveau de violence. Et le sentiment d'insécurité détermine ce qu'est la violence, c'est-à-dire si, par exemple, un vol
simple est une violence. Les évolutions du sentiment d'insécurité font changer les définitions reconnues du crime : plus la sensibilité s'élève, plus les choses sont perçues comme violentes et finissent par faire l'objet de lois ou règlements, et finalement de statistiques sur les faits et affaires traitées par les organisations. En longue période, il ne peut y avoir de décalage entre le sentiment d'insécurité et ce qu'on nomme parfois «l'insécurité réelle» (terme qui ne signifie pas grand-chose) : ils se définissent mutuellement.
Le sentiment de peur peut également être le fruit d'une construction sociale et être auto-entretenu par les médias et le discours ambiant :
« La peur est avant tout un sentiment individuel, une réaction plus ou moins directe à la perception d’un danger. Bien entendu, elle ne repose pas nécessairement sur une réalité objective, sinon, la peur des fantômes n’existerait pas …
Bien sûr, les angoisses individuelles peuvent entrer en résonance les unes avec les autres ; émergent alors des peurs collectives, fruits d’une construction liée à la diffusion de représentations sociales : des éléments sont combinés en des récits, des mythes et des pratiques qui suscitent et orientent la peur. De la peur de la fin du monde à celle de la damnation, en passant par celle des communistes, des envahisseurs ou de l’inflation, les peurs collectives sont légion, même dans une société qui a érigé la Raison scientifique au rang d’idéologie.
Le « sentiment d’insécurité », au sens d’être victime d’une infraction, peut… se constituer en peur collective quand il se décline en récits par médias interposés, quand il envahit les « réseaux sociaux » ou colonise les discours politiques. Il s’incarne alors au sein des représentations sociales en des figures de la peur - situations, individus ou groupes d’individus - constitués collectivement en source de danger, dont la crainte apparaît alors légitimée, voire encouragée »
Source : MINCKE Chr. et MAES R. (2014) : Eloge de la phobie, in La Revue Nouvelle, 69e année, n°3, mars, p. 39-40
Lire aussi : DE VISSCHER Pierre, « Craintes, peurs, insécurités », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2015/4 (Numéro 108), p. 719-743.
Le sociologue Zygmunt Bauman a élaboré le concept de "société liquide". C'est une société où ni le travail, ni l’amour, ni l’amitié ne sont des structures solides. Tout devient éphémère. On observe alors une dilution du lien social favorisant le sentiment d'insécurité.
Pour le sociologue, qui poursuit sa réflexion sur l'entrée de nos sociétés dans une modernité "liquide", soumise aux errances du marché, de la flexibilité et du court terme, ce changement d'époque n'a pas seulement pour effet de ruiner la solidarité. Il inaugure une "culture du rebut" où la conviction que rien n'est vraiment irremplaçable se traduit par la production croissante de "déchets humains", condamnés à mener une "vie perdue", perçus comme formant les nouvelles "classes dangereuses". D'où le paradoxe lié au triomphe global de la modernité : l'Etat social d'hier fondait sa raison d'être sur la promesse d'insérer la sécurité dans les vies. L'Etat contemporain, lui, laisse au contraire présager "une vie encore plus précaire et remplie de risques". Selon Bauman, c'est dans cette faillite que l'exploitation politique du "capital-peur", comme nouvelle source de légitimité de l'Etat - peur du voyou, de l'immigré clandestin ou du terroriste -, trouve aujourd'hui tout son sens. Et sa triste efficacité.
source : Le Présent liquide Peurs sociales et obsession sécuritaire de Zygmunt Bauman / A. L.-L. - Le Monde - 17 mai 2007
lire aussi :
Simon Tabet, « Du projet moderne au monde liquide », Socio, 8 | 2017, 35-56
Pourquoi avons-nous peur ? / propos recueillis par Gilles Anquetil et François Armanet - Palimpsestes - Entretien paru le 24 mai 2007
Zygmunt Bauman, il avait vu la «société liquide» / Robert Maggiori - Libération - 11 janvier 2017
Le présent liquide : Lecture de Marc Dumont
L'insécurité est-elle objet d'analyses philosophiques ?
La revue philosophie magazine consacre un article à Thomas Hobbes (1588-1679) qui a travaillé sur cette question " Comment échapper à l'insécurité permanente ? ". Peut-être trouverez-vous des réponses à vos questionnements dans ses écrits ?
Comment vivre sans avoir peur ? C’est l’obsession de ce penseur anglais. Dans son autobiographie, Thomas Hobbes raconte qu’il est né avant terme car sa mère a accouché de terreur en apprenant une hypothétique invasion de son pays par la flotte espagnole. Plus tard, Hobbes assiste aux violentes dissensions entre le Parlement et le roi, à la mise à mort de ce dernier, à la prise de pouvoir de Cromwell, puis au retour de la monarchie...
Comment échapper à cette insécurité permanente ? Nourri de culture grecque et latine, Hobbes se met en quête. Il voyage, rencontre Galilée, polémique avec Descartes, s’enthousiasme pour la géométrie. Il trouve enfin la clé pour vaincre l’angoisse humaine face à l’insécurité.
Comme Galilée pour le monde physique, il va appliquer la méthode mathématique, rigoureuse et démonstrative, au réel et à l’humanité. À l’époque, c’est révolutionnaire, car la plupart des penseurs suivent encore les préceptes d’Aristote, qui refuse de mathématiser la vie humaine. Dans De la nature humaine, il postule que l’homme n’est qu’un corps en mouvement. Animé par le « désir de persévérer dans son être », ou conatus (endeavor en anglais), retranscription du principe d’inertie des corps de Galilée, l’individu cherche seulement à vivre et progresser.
Mais Hobbes veut vaincre la peur. Il applique donc ses principes matérialistes au monde politique. Dans Éléments de la loi naturelle et politique, Du Citoyen, puis dans le célèbre Léviathan, il imagine l’homme vivant hors de toute organisation politique. Dans cet « état de nature », « l’homme est un loup pour l’homme » : chacun est en guerre contre tous, car personne n’est assuré de conserver ce qu’il possède et d’assurer sa sécurité. Pour avoir une chance de vivre en paix, l’individu invente un contrat que chacun passe avec chacun, et qui consiste à déléguer son pouvoir d’autodéfense à un tiers. À qui ? À l’État-Léviathan, à fois effrayant et rassurant.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire l'article de Dominique Weber : Léviathan, la sécurité et le monde liquide.
Quelques émotions mentionnées au cours de nos recherches : peur, désarroi, désespérance, culpabilité, inquiétude, vulnérabilité, préoccupation... Le champ lexical est vaste !
Quelques livres pour aller plus loin et répondre à votre dernière question :
Propositions - Volume 2, Eloge du danger / Laurent de Sutter
Mêlant musique et droit romain, philosophie et histoire de l'assurance ou encore psychanalyse et théologie, l'auteur propose une réflexion sur la notion de danger ainsi que sur son corollaire, la demande de sécurité, sur laquelle le pouvoir politique prospère.
Désarroi de notre temps : et autres fragments sur la guerre / Simone Weil présentation, étude, notes et index par Pascal David
Dans ces écrits, rédigés en 1939, S. Weil décrit une situation d'attente et une insécurité qui trouvent un écho dans la société contemporaine. Elle délivre une réflexion sur l'idée de nation, présente la barbarie comme inhérente à la nature humaine et alerte sur la menace que constitue l'Allemagne nazie. Nouvelle édition enrichie de textes inédits.
Un art de vivre par temps de catastrophe : transformer nos manières de penser et de vivre / écrits de Simone Weil
Trois écrits de la philosophe présentés et annotés, accompagnés de lettres appartenant à la tradition de la correspondance philosophique et spirituelle ainsi que d'un essai de politique par temps de catastrophe pour analyser la crise sanitaire, économique, sociale et écologique. La réflexion invite à changer ses manières de penser et de vivre, afin de réinscrire les hommes dans le monde.
Les besoins de l'âme : extrait de L'enracinement / Simone Weil
Réflexion sur l'âme et ses besoins, dans laquelle S. Weil aborde des thèmes aussi variés que le besoin de cohérence et de sécurité, la liberté de parole, le consentement, la responsabilité ou encore la vérité.
L'Europe et la profondeur Volume 10, Une porte sur l'été / Pierre Le Coz
A côté d'analyses de certaines thématiques littéraires, philosophiques ou théologiques (la vérité, le temps, l'ennui...), le philosophe s'intéresse à des sujets plus actuels tels que les raisons du vote populiste, les théories du complot ou l'insécurité.
Kant : la paix dans et en dehors des limites géographiques des Etats / Dr Salif Coly
A travers l'étude des principes pacifistes développés par E. Kant, l'auteur pose le débat sur la question de la paix entre les Etats et à l'intérieur de ces Etats. Il souligne l'importance d'une meilleure compréhension de la nature des relations entre les individus d'une part et entre les Etats d'autre part, prônant une anthropologie fondée sur l'acceptation de la dualité de la nature humaine.
Au service du sacré : sauter à l'angle moderne : Paul Celan, Martin Heidegger, Barnett Newman / Fabrice Midal
L'auteur se penche sur ce qui, dans l'oeuvre de P. Celan, M. Heidegger et B. Newman, annonce l'insécurité chronique comme caractéristique de la postmodernité et la soif de sacré qui la caractérise. Une quête à finalité spirituelle qui se réclame de l'héritage de Chögyam Trungpa.
Eloge de l'insécurité / Alan W. Watts
S'interroge sur l'incapacité de l'humain à s'assurer de son salut et ce malgré sa quête de sécurité psychologique dans la religion et la métaphysique.
La philosophie de l'inquiétude en France au XVIIIe siècle / Jean Deprun
Quelques documents sur la sécurité en psychologie et sur la sécurité en sociologie :
- Sociologie de la sécurité / François Dieu
- Du sentiment d'insécurité à l'Etat sécuritaire / Philippe Robert, Renée Zauberman
- L'insécurité culturelle / Laurent Bouvet
- L'invention de la violence : des peurs, des chiffres et des faits / Laurent Mucchielli
- Le présent liquide : peurs sociales et obsession sécuritaire / Zygmunt Bauman
- L'Insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ? / Robert Castel
- Sociologie politique de l'insécurité : violences urbaines, inégalités et globalisation et Le sentiment d'insécurité / Sebastian Roché
Quelques documents audio :
Le catastrophisme contemporain [Disque compact] : contre la culture de la peur : une réflexion philosophique / proposée par Pascal Bruckner
Quels sont les fondements du catastrophisme dans lequel nous vivons ? Pascal Bruckner, philosophe et romancier, nous interpelle de façon saisissante en s’interrogeant, dans une réflexion libre, sur Le Fanatisme de l’Apocalypse. Cette formule rend compte du climat actuel de dramatisation et de suspicion lié à certaines dérives écologiques et dévoile le danger du discours apocalyptique né d’un amalgame entre science et superstition. De la « nourriture poison » aux « médicaments tueurs » sans oublier l’écologie culpabilisatrice, Pascal Bruckner examine différents domaines de notre société pour mieux comprendre ses mécanismes. Ses réflexions foisonnantes se cristallisent en une observation lucide de notre temps où règne la propagande par la peur. Un discours optimiste qui propose une alternative à la désespérance en encourageant à parier sur le génie humain, à avoir confiance en la capacité de l’homme à se dépasser.
La peur [Disque compact] : d'un point de vue philosophique / expliqué par Pierre-Henri Tavoillot
"Comment ne pas avoir peur ? L’occident contemporain est le théâtre d’une montée irrésistible des angoisses, depuis les plus petites – ce que nous mangeons, ce que nous respirons – aux plus grandes – annonces millénaristes de l’apocalypse et résurgence des nouveaux diables. Pourtant, d’un point de vue historique, nous vivons dans un monde plus sûr que jamais. Partant de ce paradoxe, Pierre-Henri Tavoillot pose clairement la question des grandes réponses apportées par l’humanité au problème de la peur. Quels ont été les dispositifs spirituels et parfois politiques qui ont permis de rassurer l’homme dans sa communauté, depuis les réponses anciennes, jusqu’aux réponses modernes puis contemporaines. « Ose savoir et prend garde », telle est la devise à laquelle nous invite Pierre-Henri Tavoillot, qui permettra à l’homme démocratique de lutter contre les peurs sans vouloir les abolir." Claude COLOMBINI FRÉMEAUX
CD1 : LES RÉPONSES ANCIENNES • CD2 : LES RÉPONSES MODERNES • CD3 : LES RÉPONSES CONTEMPORAINES.
Bonne journée.



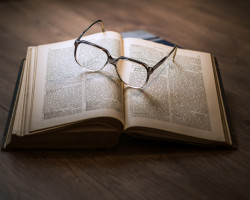
 Femmes, soyez soumises à vos maris
Femmes, soyez soumises à vos maris