Des auteurs ont-ils forgé le concept de "contre-langue" ?
Question d'origine :
Y a-tii des auteurs qui ont forgé le concept de "contre-langue" ?
Que signifie précisémnt le "contre-" en suffixe ? En quoi est-ce différent de "anti-" ?
Réponse du Guichet
Denis Thouard a consacré de nombreuses études à cette notione de "contre-langue".
Bonjour,
Denis Thouard semble avoir développé cette notion de "contre-langue" ou du moins l'a-t-il étudié chez des auteurs comme Célan.
Ainsi, dans l'article Langue et contre-langue (p. 341-350) publié dans l'ouvrage La philologie au présent,
Denis Thouard commence par étudier le contre-mot pour aborder la notion de contre-langue :
L’hypothèse de la constitution d’une « contre-langue » qui prolonge et systématise le geste du « contre-mot » est au centre des interprétations de Celan par Jean Bollack. La « langue célanienne » ou « l’idiome » est l’outil heuristique principal du déchiffrement. Comme on apprend une langue étrangère, il s’agit d’apprendre le « célanien » si l’on veut comprendre les poèmes. Les mots de la langue ordinaire y subissent une « réfection » qui les réinvente et les dotent de nouvelles capacités de faire sens. Si toute poésie s’arrache d’une certaine façon à la langue « courante » pour s’en abstraire, instaurer son propre rythme et son propre temps, palpable dans la forme qu’elle se donne et qui se fait reconnaître pour telle, l’hypothèse de la contre-langue radicalise ce geste eu égard à une situation historique particulière de la langue. Celan écrit en allemand, mais contre l’allemand témoin et complice des crimes d’une histoire militaire et intellectuelle dont ont ne peut faire abstraction. Il écrit donc pour porter la contradiction dans la langue, pour la sonder, l’analyser, la brutaliser … »
Jean Bollack, Paul Cellan, jean genet
Dans son étude, il mentionne des auteurs comme Jean Bollack, Paul Celan et Jean Genet.
Certains d'entre eux font d'ailleurs l'objet d'une recherche de Denis Thouard dans Herméneutique critique. Bollack, Szondi, Celan.
Par ailleurs, ce chercheur dans la recension de l'ouvrage "Paul Celan et Martin Heidegger. Le sens d'un dialogue" par Hadrien France-Lanord (publié dans Revue de métaphysique et de morale, avril-juin 2007, Du langage et du symbole, avril-juin 2007) écrit que Célan
"s'efforcera au contraire de porter la contradiction dans la langue allemande elle-même pour en faire une Gegensprache ou « contre-langue », la remettant en question, avec la tradition littéraire qui l'avait illustrée, d'une façon radicale qui est bien éloignée de la méditation destinale de Heidegger"
Vincent Texeira s'intéresse lui, à La langue de personne ou l’outre-langue des écrivains de nulle part.
Sur Jean Genet, l'approche de Mathias Verger, bien que ne faisant pas référence à la contre-langue, nous semble intéressante : Irrévérence morale et linguistique chez Jean Genet. Formes et fonctions du calembour.
Quant aux définitions de "contre" et "anti", nous nous sommes reportées au Dictionnaire Historique de la langue française par Alain Rey.
Contre, prép., adv., préf. Et n., dès 842 sous la forme latine contra, puis cuntre (1080) et contre (V. 1170), est issu du latin contra adverbe et préposition « en face de, vis-à-vis », « au contraire de », « en sens contraire de », « par opposition à ». Contra a des correspondants dans les langues indoeuropéennes (gothique, italique) et présente un suffixe marquant l’opposition de deux notions (également dans extra), d’ailleurs employé en indo-iraninien (sanskrit àtra « ici, tátra « là ») dans une indication de lieu...
Dès le XIe s., le mot est attesté avec trois sens différents qui se sont maintenus jusqu’à aujourd’hui. Une idée de contact, de proximité dans l’espace ou dans le temps est réalisée par la préposition (1080, contre terre) et l’adverbe (en composition là-contre, ci-contre, tout contre). On en rapprochera l’usage de la préposition en franco-provençal (Suisse, etc. ) avec le sens de « vers, en direction de » …Enfin, l’idée dominante est celle d’une opposition, aussi bien avec une valeur offensive, attestée dès 842, en particulier après quelques verbes de combats, au propre et au figuré, qu’avec une valeur défensive …
Pour ce qui est du préfixe Anti il note :
préfixe très productif, est tiré de la préposition grecque anti, exprimant notamment l’opposition et la protection contre le mal (…)
Anti-, préverbe et préposition dont le sens premier est « en face », est passé en latin avec une grande productivité. Le thème ant-, outre antiè a servi à former l’adverbe anta « en face » (qui a de nombreux dérivés, mais a été vite remplacé en grec par anti).
Par ailleurs, les définitions apportées par le centre national de ressources textuelles et lexicales complètent ces premières informations. Nous ne vous présentons ici que de brefs extraits et vous laissons parcourir ces définitions dans leur intégralité.
.− Contre- marque l'inversion, l'oppos. par rapport à une première orientation, par rapport à une première action.
A.− Contre- marque l'inversion.
1. Le composé désigne l'inverse symétrique de la chose désignée par la base.(...)
2. Au fig. Le composé désigne la reproduction, mais avec des traits moraux négatifs de la chose désignée par la base. V. les sens fig. de contre-calque, contre-épreuve, contretype et le mot contrefaçon.
(...)
B.− Le composé désigne un mouvement, une force, un agent, etc. de nature similaire à celui désigné par la base, mais qui agit en sens contraire, qui en neutralise les effets.
1. Le composé est un subst. qui fonctionne de manière autonome(...)
a) La base désigne un mouvement orienté(...)
b) La base désigne un agent, une force. ..
(...)
c) La base désigne un acte juridique, une procédure parlementaire
2. Le composé fonctionne à l'intérieur d'un syntagme prép. introd. par à, (ou, rarement, par en).
C.− Le composé désigne une action d'un type similaire à celle désignée par la base, et ayant pour fonction de la neutraliser.
1. La base est un verbe d'action...
2. La base est un nom d'action ...
3. La base est un subst. désignant une personne..;.
II.− Contre- marque simplement le redoublement, la complémentarité.
A.− Le composé désigne la partie symétrique, le complément fonctionnel, la chose qui renforce celle que désigne la base. ...
B.− Le composé désigne une action de même nature que celle que désigne la base, dans une intention de vérification, de confirmation, de garantie supplémentaire (ou d'oppos., d'où les interférences possibles avec I C). Contre- est équivalent de contradictoire, au sens juridique. V
C.− Le composé désigne une pers. dont la fonction est d'assister la pers. désignée par la base. ...
•ANTI-, élément formant
I.− Le composé signifie « qui est contre la notion désignée par la base »; c'est un adj. (substantivable) formé à partir d'un adj. ou d'une loc. adjectivable formée à partir d'un substantif.
A.− Le composé est un adj. formé à partir d'un adjectif.
1. Il signifie « qui est hostile au système d'idées ou d'opinions caractérisé par l'adj. de base », ou, quand il est substantivé, « la personne hostile à... »....
2. Il signifie « qui combat la maladie, le phénomène pathologique caractérisé par l'adj. de base »; substantivé au masc., il signifie « le remède, la substance qui combat la maladie, le phénomène pathologique ... »...
3. TECHNOL. Le composé signifie « qui annihile les effets de, protège contre, etc. »; substantivé, il signifie « dispositif, arme qui annihile les effets de, protège contre, etc. » ...



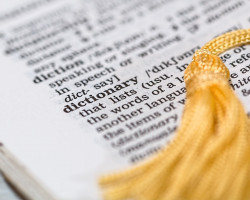
 Les mots ont des oreilles
Les mots ont des oreilles