Nos proches ont-ils des attentes auxquelles nous ne pouvons pas répondre ?
Question d'origine :
Est-ce que la plupart de nos proches et de nos amis ont des attentes de nous auxquelles on ne peut pas tout le temps répondre-à toutes ces attentes qu'ils ont de nous?
Réponse du Guichet
Il est au fond assez normal et inévitable que certaines attentes de nos proches ne puissent être comblées. Elles peuvent être, pour nous, démesurées, en inadéquation avec nos ressources, nos compétences, nos désirs. Votre interrogation, vaste, en suscite bien d'autres ! Qu’est-ce qui rend possible la réponse à leurs attentes ? Mais aussi, comment ne pas chercher à répondre à toutes les attentes de nos proches ? Et quel risque existe-t-il à vouloir les combler ? Pourquoi cherche-t-on à le faire ?...
Nous vous proposons quelques ouvrages ou podcasts qui vous permettront d’approfondir ces interrogations.
Bonjour,
Dans son livre Se libérer enfin du regard de l’autre, la psychologue Muriel Mazet analyse les attentes qui se jouent dans la relation de couple et l’équilibre, toujours précaire à trouver, entre affirmation de soi et respect de l’autre:
« Pour être aimé, nous avons souvent cette tendance presque instinctive à nous calquer sur l’autre, sur ses désirs, sur ses penchants; à nous noyer dans son regard. Et bien souvent, dans cet amour-là, nous sommes à la recherche de nous-mêmes […]. Douter,ne pas oser, hésiter devant tout choix, se conformer au regard de l’autre, tout comme se plier à l’autorité, suivre la parole dominante, obéir systématiquement aux ordres donnés, ne pas faire de vague, c’est tous les jours que cela peut arriver à chacun d’entre nous. Et comme toujours c’est l’image que l’on craint de donner de soi qui en est à l’origine ».
Le fait de répondre ou non aux attentes de nos proches est donc très lié à l’image de soi ainsi qu’à la capacité à s’affirmer. Muriel Mazet écrit à ce sujet: « Toute notre vie nous chercherons dans le regard des autres la preuve de notre valeur […]. C’est ainsi qu’hélas nous pourrons en arriver à nous dire “je suis ce que l’on m’a dit d’être”, cherchant à l’extérieur dans une quête perpétuelle cette reconnaissance que nous n’avons pu malheureusement trouver en nous-mêmes […]. Elles sont si nombreuses les voies que nous choisissons pour correspondre à ce que les autres attendent de nous ». En somme, il y a des attentes qui ne peuvent pas être comblées, d’autres qui ne doivent pas l’être parce qu’elles nous aliènent plutôt qu’elles ne contribuent à notre bien-être.
Ce rapport aux attentes des autres peut d’ailleurs tourner à la névrose, obsessionnelle en l’occurrence. Comme le raconte la psychanalyste Mardi Noir dans un podcast pour Slate Audio, le névrosé obsessionnel vit très mal d’être soumis aux demandes de l’autre, il est tributaire de ces attentes qu’il ne peut satisfaire « et ça le met en rage d’être à ce point soumis à leur demande ».
Dans un registre moins psychopathologique, les attentes des autres favorisent ce que le psychologue Robert Rosenthal appelle l’effet Pygmalion, qui s’apparente à une prophétie auto-réalisatrice. « C’est un phénomène psychologique selon lequel les attentes des autres envers un individu influencent le comportement et les performances de ce dernier. Ces attentes peuvent être conscientes ou inconscientes et avoir un impact positif ou négatif ». On ne peut pas toujours répondre aux attentes de nos proches; mais se savoir soutenu par ceux qui croient en nous, qui attendent de nous, peut favoriser notre réussite. Précisons tout de même que la communauté scientifique a, depuis les premières expériences de Rosenthal, nuancé cet effet Pygmalion.
On peut également approcher cette question des attentes par le biais des loyautés familiales. Ce concept, développé par le psychiatre Ivan Boszormenyi-Nagy est décrit de la façon suivante par Catherine Ducommun-Nagy, thérapeute familiale :
« La loyauté familiale fait partie du domaine de l’éthique relationnelle parce qu’elle est avant tout basée sur une attente de justice entre les générations. Elle trouve son origine dans la disponibilité que les parents manifestent envers leurs enfants et ensuite seulement dans la dette des enfants à leur égard. Si les rapports familiaux sont basés sur la confiance mutuelle et la loyauté réciproque, nous pourrions compter sur le soutien des nôtres dans les tournants difficiles de notre vie. Nous saurions aussi ne pas nous décourager devant l’adversité. La loyauté familiale basée sur l’éthique relationnelle devient alors une source de résilience pour chacun des membres de la famille.
Nous pouvons nous acquitter de notre dette envers nos parents de manières multiples : en nous montrant disponible à leur égard dans leurs vieux jours, tout comme ils l’ont été envers nous au cours de notre enfance. Nous pouvons aussi poursuivre des missions auxquelles ils tiennent. Beaucoup de parents trouvent déjà une grande satisfaction à remplir leur rôle et ne demandent rien en retour, si ce n’est que d’être rassurés sur le fait qu’ils ont été de bons parents. Il nous est donc possible de nous montrer loyaux envers eux simplement, en leur montrant qu’ils ont réussi dans leur tâche de parents et n’ont pas gâché la vie qu’ils nous ont transmise.
Même s’ils n’ont pas été capables de répondre à nos besoins ou si nous n’attribuons que peu de valeur à ce qu’ils nous ont transmis, nous serions injustes en refusant de reconnaître leurs efforts. Il en est de même quand nos parents ont des attentes tout à fait irréalistes ou franchement destructives pour nous. Dans ces situations, nous avons le droit de ne pas répondre aveuglément à leurs attentes, mais nous leur devons tout de même un minimum de considération ».
Finissons pas une question : à quel moment cherchons à nous à répondre aux attentes réelles de nos proches ou projetons-nous sur eux des attentes à notre égard? C’est la question qui traverse le podcast «jusqu’où peut-on aller pour répondre aux attentes des autres?». « On a tous·tes tendance à imaginer les attentes des autres, à vouloir prédire leur réaction, à s’inquiéter des conséquences de nos mots, de nos actions et à se demander ce que nos interlocuteur·ice·s vont penser de nous. Ces pensées parasitantes peuvent devenir paralysantes et défaire ces réflexes peut prendre des années ». La journaliste dialogue notamment avec Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie à Lyon, qui s’est intéressé à la façon dont on se représente le désir de l’autre et dont on anticipe leur réaction: « un processus mental directement lié à notre empathie et présent dès notre plus jeune âge ».
Bonnes lectures et écoutes !
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Pourquoi choisissons-nous des modèles auxquels ressembler...



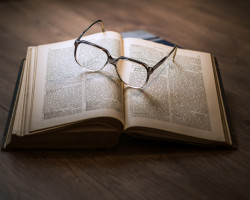
 Ici-bas, pourquoi la Torah n’est pas au ciel
Ici-bas, pourquoi la Torah n’est pas au ciel