Pourquoi retrouve-t-on les mêmes contes à travers le monde ?
Question d'origine :
[Contes de fées - Migration]
Salut les collègues,
voilà, je monte une petite expo sur les contes de fées (vision européenne) et je voudrais faire un panneau expliquant pourquoi on retrouve les [presque] mêmes contes à travers le monde. Par exemple Cendrillon que l'on retrouve d'Europe au Japon en passant par l'Afrique. J'écume les sites anglais et français et j'ai bien trouvé quelques courtes infos sur les motifs culturels universels, les migrations et les échanges culturels... mais je n'ai pas vraiment de source claire et précise ; tout semble être des suppositions un peu floues.
Bref : Comment les contes ont-ils migrés ? Et d'où viennent ces théories exactement ? De chercheurs en anthropo, certainement, mais...
Bien sur, ma planche ne fera que quelques lignes et est à visée Grand public, alors je ne cherche pas non plus à m'étaler. Mais je voudrais être certaine que ce que je dis est correct et ne pas me contenter de recopier bêtement ce que je trouve sur internet.
Je vous remercie !
(Pour vous remercier, je vous offre une image : c'est Le Petit Chaperon Rouge dans un style Romantisme Noir)

Réponse du Guichet
Un certain consensus semble se former autour de l'idée que les contes et les mythes partagent une généalogie : apparus il y a longtemps, parfois dès avant la sortie d'Afrique, ils ont été transportés dans le monde entier au gré des migrations de notre espèce, non sans se modifier selon les changements de milieux et des échanges culturels entre les populations. Une démarche dite phylogénétique, héritée de la biologie, couplée à un énorme corpus de versions de récits patiemment réunis, sont actuellement très porteurs pour la mythologie comparée.
Bonjour,
Merci pour cette belle image ! Nous sommes heureux de l'arborer sur notre site (cependant n'hésitez pas à nous préciser en commentaire si elle est bien libre de droits ou si vous possédez les droits).
La question de l'origine et de la généalogie des contes a enflammé de nombreux débats, depuis que les érudits ont commencé à s'intéresser à collecter ces témoignages du folklore : la ressemblance entre mythes et contes du monde entier pourrait témoigner d'une révélation primordiale de type religieux, être le fruit de simple coïncidences, ou encore révéler les structures d'un inconscient collectif, comme a pu le penser le psychanalyste CG Jung... aujourd'hui toutefois, un certain consensus sur une hypothèse généalogique : les contes et mythes partageraient un air de famille pour la bonne raison qu'ils sont issus les uns des autres. Leur diffusion a accompagné les grandes migrations humaines depuis le berceau africain de notre espèce, et leurs évolutions sont le fruit des changements de nos milieux de vie autant que de nos échanges culturels.
Vous avez raison de suggérer que les anthropologues sont ici dans leur élément. C'est pourtant un philologue Max Müller, qui dans un ouvrage du milieu du XIXè siècle, Essai de mythologie comparée (également consultable sur Gallica), a fondé une méthode d'analyse de nos mythes qui a fait florès depuis. Mais si, comme vous le verrez dans l'article Wikipédia Mythologie comparée, Müller, comme d'autres savants comme Georges Dumézil restraignaient leur analyse à la recherche de structures communes de contes à l'intérieur d'une aire culturelle, les chercheurs aujourd'hui vont beaucoup plus loin.
Car les bases de données mythologiques, comme d'ailleurs les outils d'analyse, ont profondément évolué depuis eux. On doit par exemple à un Vladimir Propp une tentative de typologie systématique du conte de fées. Voir son ouvrage : Morphologie du conte [Livre] suivi de Les transformations des contes merveilleux / Vladimir Propp. suivi de L'étude structurale et typologique du conte / Evguéni Mélétinski ; traductions du russe de Marguerite Derrida, Tzvetan Todorov et Claude Kahn.
Plus près de nous, un Yuri Berezkin réunit depuis quarante ans une base de donnée titanesque de mythes et de légendes :
Yuri Berezkin est le créateur d'une base de données regroupant des motifs mythologiques, contenant plusieurs dizaines de milliers de résumés d'histoires orales du monde entier. Les motifs mythologiques qu'ils contiennent sont classés et attribués à des groupes ethniques. La base de données est utilisée dans la recherche statistique sur la diffusion culturelle et la reconstruction des migrations passées et des contacts interculturels. La base de données de Yuri Berezkin contient plus de 2264 motifs provenant de plus de 934 peuples à travers le monde.
En s'appuyant sur ces sources, ainsi que sur les capacités de modélisation et de statistiques offertes par les outils informatiques, les chercheurs contemporains ont pu développer une approche phylogénétique de la généalogie des contes et des mythes. La phylogénétique, discipline issue de la biologie, est l'étude de la parenté des êtres vivants. En l'appliquant aux récits oraux et écrits, et en la combinant à d'autres disciplines, notamment l'aréologie (analyse géographique de la présence d'un trait culturelle) et la génétique des populations, des résultats très cohérents ont été obtenus. C'est ainsi que Sciences et avenir pouvait écrire à propos d'une étude britannique :
Barbe bleue, Peau d’Ane… Les contes de fées ne s’adressent pas qu’aux enfants. Ils intéressent aussi les scientifiques. Et deux chercheurs ont eu l’idée de rechercher l’origine de ces récits merveilleux peuplés d’êtres surnaturels. Résultat : certaines fables remonteraient… à l’Age du Bronze ! La Belle et la Bête pourrait ainsi être née il y a 4000 ans, alors que le thème de Faust, présent dans Le forgeron et le diable, de Hans-Christian Andersen, serait vieux de 6000 ans. C’est du moins la conclusion d’une étude publiée dans The Royal Society Open Science par deux anthropologues, Sara Graça da Silva, de l’université de Lisbonne (Portugal), et Jamshid J.Tehrani, de l’université de Durham (Angleterre).
Les chercheurs ont fait appel aux méthodes statistiques et phylogénétiques comparatives habituellement utilisées en biologie de l’évolution pour analyser les relations existant entre des contes. Ils ont ainsi réunis 275 contes qu’ils ont réduit à 76 structures de base – certains contes n’étant que des variantes – dont ils ont étudié l’évolution au sein des langues indo-européennes. Les deux spécialistes sont ainsi parvenus, en construisant un arbre des contes, à établir que plusieurs d’entre eux, issus de lointaines traditions orales, étaient bien antérieurs aux époques supposées de leur apparition dans la littérature, à savoir généralement l’époque de la Renaissance au 16e siècle. Les chercheurs rappellent d’ailleurs que les frères Grimm, auteurs de nombreux contes au 19e siècle, étaient eux-mêmes convaincus des origines proto-indo-européennes de certaines fables traditionnelles allemandes qu’ils avaient compilées.
Cette étude est également citée par Futura-sciences :
En utilisant des méthodes de phylogénétique habituellement employées par les biologistes de l'évolution, pour décrire les liens entre les espèces, Jamshid Tehrani, un anthropologue de l'université de Durham, et Sara Graca Da Silva de la nouvelle université de Lisbonne, ont étudié les liens entre des histoires du monde entier. Leur étude est parue dans Royal Society Open Science. L'objectif était de trouver les origines des contes.
Les contes se sont transmis à la fois verticalement dans les populations ancestrales, des parents aux enfants, mais aussi horizontalement, entre sociétés contemporaines. Dans leur article, les chercheurs montrent que les traditions orales des contes trouvent probablement leur origine bien avant l'émergence de la littérature, comme l'explique Sara Graca Da Silva. « Certaines de ces histoires remontent beaucoup plus loin que les premiers enregistrements littéraires, et bien plus loin que la mythologie classique - certaines versions de ces histoires apparaissent dans des textes latins et grecs -, mais nos résultats suggèrent qu'ils sont beaucoup plus vieux que cela. »
L'étude de Jamshid Tehrani et Sara Graca Da Silva, Comparative phylogenetic analyses uncover the ancient roots of Indo-European folktales, est disponible en ligne. Vous pourrez donc vous faire une idée de la solidité de leur méthode si vous jouissez d'une solide compétence en anglais.
Si ce n'est pas le cas toutefois, sachez que de grands noms francophones s'illustrent dans cette discipline : voyez par exemple l'ouvrage Avant nous le déluge ! : l'humanité et ses mythes, riche en cartes, où Jean-Loïc Le Quellec suit des mythes fondateurs tels que le plongeon cosmogonique ou l'émergence primordiale, dans leur migration de l'ancien au nouveau monde, à l'époque où le détroit de Béring pouvait se traverser à pied sec :
Depuis le début de l'humanité, nous inventons des récits, les mythes, pour mieux comprendre notre monde. Jean-Loïc Le Quellec les collecte, les étudie, les compare, à toute époque, même la plus reculée, dans tout peuple, dans autant de langues que possible.
On explique l'universalité des mythes aujourd'hui par une transmission au fil des migrations. Cette diffusion n'est pas systématique, elle se fait ou pas, ou de différentes manières, dessinant ainsi les évolutions des peuples en une fabuleuse cartographie historique du monde.
Citons également Julien d'Huy qui, dans Cosmogonies et L'aube des mythes, se propose d'utiliser la méthode phylogénétique pour dégager les contours de mythes... paléolithiques. Ses résultats semblent très convaincants et suggèrent des constantes dans la diffusion des mythes : ceux-ci connaissent de longues plages de stabilité avant des changements subits et rapides, ils évoluent et se transmettent moins facilement que le génome, sont très sensibles aux modification de milieux de vie et de structures socio-religieuse (l'inverse n'étant pas vrai)... nous vous conseillons vivement la lecture de cet ouvrage.
Le Quellec et d'Huy ont d'ailleurs cosigné en 2016 une tribune dans la revue La Recherche Les mythes ont aussi un arbre généalogique, qui vous donnera une idée plus précise de leur méthode :
« Quiconque veut s'intéresser au folklore doit [...] remplacer la méthode historique par la méthode biologique », écrit, dès 1924, le folkloriste français Arnold Van Gennep. L'idée qu'il existe différents types de versions d'un même mythe et que les récits oraux évoluent à la façon des êtres vivants imprègne la recherche en mythologie comparée depuis le XIXe siècle (1). Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'application d'outils informatiques aux traditions orales donne un second souffle à cette comparaison. Émerge alors une nouvelle discipline : la phylomémétique, étude des faits culturels à l'aide d'outils empruntés à la biologie de l'évolution, qui permet d'établir des arbres phylogénétiques de langues, de techniques et de mythes. Dans ces arbres, un ancêtre commun figuré sous forme d'un point donne un ou plusieurs descendants reliés à lui par un trait. Le point de jonction est appelé « noeud » (Fig. 1). Cette approche permet de reconstituer la façon dont les mythes ont évolué et dont ils se sont transmis d'un continent à un autre au cours de l'histoire.
Reconstruire le passé lointain est très difficile. Les biologistes le font pourtant quotidiennement, en comparant des séquences de gènes : plus les séquences de deux espèces se ressemblent et plus leur ancêtre commun est récent. Des algorithmes informatiques facilitent l'établissement de ces comparaisons. Leurs résultats sont graphiquement présentés sous forme d'arbres. Ces méthodes peuvent également être appliquées aux mythes et aux contes puisque certains d'entre eux semblent diverger très lentement les uns des autres, et l'on peut donc espérer construire des arbres phylogénétiques.
Pour cela, chaque version appartenant à un même type de récit est d'abord réduite à une série de « motifs », des phrases extrêmement courtes telles que : « le héros est un homme » ou « le héros affronte un dragon ». Pour chaque version, ces traits sont ensuite codés par 1 s'ils sont présents dans le récit, par 0 dans le cas contraire. Les incertitudes sont prises en compte et codées par un point d'interrogation. Une fois codée, chaque famille de récits se présente sous la forme d'une série de chaînes binaires. On leur applique alors des algorithmes phylogénétiques afin de déterminer quelles versions sont les plus proches les unes des autres. On obtient ainsi un arbre phylogénétique des récits.
Les sources proviennent ordinairement de plusieurs langues. Heureusement, le mythe « résiste » aux pires traductions et même aux traductions de traductions qui ne modifient ni l'ordonnancement de ses motifs, ni leur sens, puisque ces motifs se réduisent à des phrases extrêmement simples.
ÉLÉMENTS EMPRUNTÉS AU FOLKLORE
L'approche doit néanmoins être précautionneuse. Dans la réalité, mythes et contes n'évoluent pas exactement comme des gènes. Les emprunts et les inventions indépendantes sont légion. Cinq minutes suffisent à retenir la structure du Petit Chaperon rouge et à l'adapter dans une autre langue en y ajoutant, le cas échéant, des éléments empruntés au folklore autochtone. Par ailleurs, plus le signal est ancien et plus le « bruit » l'entourant (c'est-à-dire les éléments indésirables qui viennent se greffer au signal) est important, ce qui peut biaiser les résultats.
Une première précaution consiste à évaluer la solidité de l'arbre obtenu, en calculant la part des transmissions verticales (de version « mère » à versions « filles ») et celle des emprunts ou des inventions indépendantes, ce que l'on appelle les « transmissions horizontales ». Il existe pour cela des outils statistiques, comme l'indice de rétention. Son calcul permet d'évaluer la probabilité que plusieurs des récits étudiés aient été inventés indépendamment. Autre possibilité : établir des « réseaux » de mythes, où chaque version peut être reliée par plus d'un trait aux autres versions. Cela permet d'observer les emprunts entre mythes et renforce la probabilité qu'ils soient apparentés. Une seconde précaution consiste à multiplier les angles d'approche du motif ou du récit étudié. Si l'on obtient les mêmes résultats à partir de corpus indépendants, il est alors possible de leur accorder un certain degré de confiance.
Plus spécifiquement sur le conte merveilleux, citons l'ouvrage D'un conte l'autre de la mythologue russe Galina Kabakova :
Le conte, qu'on croyait cantonné à l'univers de la petite enfance, n'a pas livré tous ses secrets. Omniprésent dans notre vie, il nous interroge par sa longévité et son imprévisibilité. Malgré des milliers de contes collectés et publiés à travers le monde, il se niche dans cette grande constellation un objet fabuleux non identifié : le conte étiologique ou explicatif. Celui qui pose des questions parfois loufoques sur l'univers et l'humanité, comme par exemple pourquoi le mariage du soleil fut-il annulé, et apporte des réponses inattendues. Il est là pour faire le lien entre le passé mythique et le présent prosaïque, pour donner à celui-ci du sens et de la poésie. Le livre est consacré en grande partie à l'exploration de ces contes séculaires, car les contes sont aussi les traces de migrations très anciennes, à commencer par celles qui ont amené nos ancêtres en Europe et en Asie il y a des dizaines de milliers d'années avant J.-C. L'ouvrage se penche également sur les motifs qui traversent toute l'Europe : comment s'expriment les plantes dans les contes ? pourquoi l'homme vit une « vie de chien » ? comment chaque peuple obtint-il son destin ? Une attention particulière est portée à l'est de l'Europe, où les contes font encore partie de la tradition orale. L'aventure dans le domaine russe rend presque inévitable la rencontre avec Baba Yaga, la sorcière mondialement connue. On partira à la recherche de ses origines, ce qui nous fera traverser le conte, l'imagerie populaire et les débuts de la littérature russe. On la croisera encore lorsqu'on s'intéressera aux mutations du conte russe au XXe siècle, aux périodes de disgrâce et de réhabilitation.
Pour aller plus loin :
Mythologie comparée [Livre] / Max Müller ; présentation établie, présentée et annotée par Pierre Brunel [ ; trad. de l'anglais par Georges Perrot et Léon Job]
Routes et parcours mythiques [Livre] : des textes à l'archéologie : actes du septième Colloque international d'anthropologie du monde indo-européen et de mythologie comparée (Louvain-la-Neuve, 19-21 mars 2009) / sous la direction de Alain Meurant
Esquisses de mythologie [Livre] / Georges Dumezil ; préf. de Joël H. Grisward
Mythologies du XXe siècle [Livre] : Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade / Daniel Dubuisson
Voir aussi notre précédente réponse Je souhaiterais avoir une bibliographie assez riche sur l'analyse des contes.
Bonne journée.



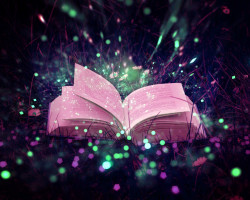
 Genderflou
Genderflou