Les femmes et enfants des maîtres-ateliers canuts étaient-ils payés ?
Question d'origine :
Est ce que, à Lyon, en 1831, les femmes des maîtres-ateliers canuts étaient payés ? Par leur mari ? Et est ce que les enfants étaient payés ?
Réponse du Guichet
Le père et mari avaient vraisemblablement la main sur le salaire des femmes et des enfants, les chefs d’atelier y compris.
Bonjour,
Nous n’avons pas trouvé d’indications sur le paiement d’un salaire ou non pour les enfants et les femmes des maîtres-ateliers canuts mais nous pouvons, pour celles-ci noter l’impuissance juridique dont elles sont accablées par le droit.
L'ouvrage Femmes de Lyon présente les conditions de vie des femmes :
p. 83
nous savons que, depuis le milieu du XVe siècle, la Grande Fabrique de la soie rassemble une main-d’œuvre féminine abondante, sous payée et peu encadrée dans un système corporatif par ailleurs faible.
(…)
A l’exception des veuves dont le statut est tout à fait particulier, les jeunes filles et les jeunes mariées demeurent la plupart du temps sous une juridiction masculine – du père ou des frères d’abord, puis du mari ensuite. Ces figures tutélaires disposent des droits et des prérogatives sur les actions de leurs filles, sœurs ou épouses, ainsi que sur leurs biens, tempérés par le souci collectif de protéger les femmes dans des situations potentiellement – et souvent bien réellement – délicates, comme le veuvage.
(…) les mères ont, à l’égard de leurs enfants, relativement peu de droits et de prérogatives indépendantes (..) la disponibilité de leurs biens est cautionnée par l’accord de leurs responsables légaux.
Les autrices constatent néanmoins des espaces de liberté :
Il va de soi, par exemple, que les femmes gèrent à l’intérieur des ménages, l’achat de nourriture et de vêtements. A partir de cette réalité nécessaire au fonctionnement concret des ménages et de la société, s’ouvrent des possibilités juridiques que les femmes exploitent savamment
(…)
Le régime matrimonial en vigueur dans le Lyonnais prévoit la séparation des biens entre les époux : les femmes peuvent ainsi disposer de manière indépendante de tous les biens qui seraient à leur nom et qui ne rentrent pas dans l’escarcelle de la dot. Elles peuvent en disposer de manière largement libre. Les biens dotaux que les femmes reçoivent de leurs familles au moment de leur mariage ou bien qu’elles forment d’elles-mêmes grâce à leur travail, demeurent de leur propriété, mais sont administrés par le mari
(…)
Cela limite les prérogatives d’usage de ce type de biens : le mari peut disposer des revenus qui en découlent, mais ne peut pas, par exemple, les hypothéquer sans consentement
p. 94-96
Quelques éléments concrets permettent d’évaluer cette hiérarchie. Pour les années 1722-23, par exemple, le salaire d’une dévideuse est compris entre 24 et 36 livres par an. La position des tireuses de cordes est différente : les maîtres tisserands sont obligés de leur proposer un contrat annuel ainsi que le gîte, le couvert et un salaire compris entre 36 et 40 livres. Cette somme dépasse parfois celle des revenus de certains maîtres-ouvriers qui gagnent en moyenne entre 24 et 39 livres.
Ces filles sont très jeunes : elles arrivent souvent des campagnes environnantes à l’âge de 13 ou 14 ans, et cherchent à quitter leur tâche dès qu’elles le peuvent, en général au bout de cinq ou six ans de travail – si elles survivent ! – pour accéder à des occupations mon pénibles
(…) les femmes ne peuvent concurrencer les hommes tout en assurant un travail bien fait et moins bien rémunéré.
(…) le recrutement de la main-d’œuvre est assuré en bonne partie par la collaboration de l’un des institutions traditionnelles de la ville : l’Aumône générale qui se charge de la mise en apprentissage des jeunes confié (e)sà ses soins (…) L’hôpital qui recueille les pauvres, non seulement les met directement au travail dans ses propres structures dès l’âge de sept ans ; mais il confie en apprentissage à des maîtres et maîtresses de la ville ses jeunes, dès qu’ils/elles le peuvent (… ) les Catherines sont des filles délaissées par leurs familles, mais de naissance légitime, tandis que les Thérèses sont issues de naissance illégitime. Les premières sont acheminées vers des professions plus évaluées et rentables, généralement à l’intérieur des corporations féminines ; car l’apprentissage de base que l’hôpital leur fourni comprend aussi la couture – tandis que les Thérèses vont grossier les rangs des dévideuses et des ourdisseuses de la Grande Fabrique
p. 122
En 1833, le Monde de la fabrique compte 14 940 maitres, 29 550 compagnons,27 210 femmes et 38 890 enfants, mais ces deux derniers groupes sont cantonnés dans des tâches subalternes.
Par ailleurs, les actes du colloque Lorsque l'enfant grandit entre dépendance et autonomie apportent des informations sur le rôle des enfants dans l'atelier familial. Nous ne vous en présentons ici qu'un extrait :
Au fur et à mesure que l’enfant grandissait, il s’intégrait à l’unité familiale de production. Cette intégration commençait tôt.
(..) le canut lyonnais Sébastien Commissaire, lui-même fils de canut, aide un père qui, dans les années 1830 connaît des débuts difficiles de «chef d’atelier». L’enfant fréquente quelque peu l’école des frères, mais, avant même l’âge de 10 ans, il doit faire des «cannettes» le soir.
(…) en préparant les cannettes, il déchargeait en tout cas l’adulte d’une tâche nécessaire, économisant un temps précieux
(…)
La figure du chef de famille apparaît comme ambigüe: il est à la fois le père avec qui l’enfant a des liens affectifs et le patron qui fait travailler (…) c’est le père qui détermine les modalités du labeur imposé à l’enfant dans l’atelier familial et qui a la haute main sur toutes les questions de rétribution (…)



![[Usine du Rhône à Saint-Fons : vue d'ensemble] / Jules Sylvestre (1859-1936) - BML](https://www.guichetdusavoir.org/media/cache/thumb_illustration_bloc/usine-du-rhone-a-saint-fons-vue-d-ensemble-60b650d5b47ca456567970.jpg)
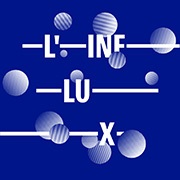 Histoire de la Suède
Histoire de la Suède