Le philosophe Luckacz a-t-il une philosophie des relations humaines ?
Question d'origine :
Le philosophe Luckacz a-t-il une philosophie des relations humaines ? (confiance, trahison, loyauté...)
Réponse du Guichet
Les relations humaines sont au coeur de la pensée de Lukács, bien que parfois masquées derrière son haut niveau d'abstraction.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir si le philosophe Georg Lukács aborde dans ses écrits la question des relations humaines.
À priori, on peut considérer que ces sujets ne sont pas au cœur de l’œuvre de Georg Lukacs, qui s’est plutôt préoccupé de questions esthétiques, abordées sous l’angle d’une sociologie de la culture, et politiques, traitées sous le prisme d’une philosophie de l’histoire. Mais on peut également considérer que l’ensemble de son œuvre, dans sa tentative marxiste de concilier réalité objective et perception subjective du monde traite de cette question. En effet, Lukács cherche à dépasser la dimension téléologique présente dans la pensée marxiste pour rendre à l’histoire sa complexité et son imprévisibilité le vécu et la praxis de l’individu au centre de la réflexion, sans toutefois tomber dans les travers de l’existentialisme, qu’il récuse en tant que «philosophie bourgeoise».
Il ne sera donc évidemment pas question de vous livrer une analyse exhaustive de l’œuvre, par ailleurs assez exigeante, de Lukács. Nous pouvons toutefois vous conseiller de vous pencher sur ses deux derniers ouvrages, l’Esthétique et l'Ontologie de l’être social.
Nous référant à l’entrée consacrée à Lukacs dans le Dictionnaire des philosophes dirigé par Denis Huisman, on peut considérer qu’il s’appuie sur la pensée de Marx pour penser la société comme un «complexe des complexes», qu’il cherche à reconstruire depuis le travail jusqu’aux activités idéologiques les plus différentiées. Il mobilise en ce sens la notion d’alternative, et une distinction entre objectivation, extériorisation, réification et aliénation. Il s’appuie également sur une distinction entre la spécificité du genre humain en soi (qui reflète le statu quo social) et la spécificité du genre humain pour soi (qui incarne les aspirations vers une existence non aliénée) pour proposer une conception subtile de processus historique. Ce faisant, il propose une conception ouverte de l’être, concevant le monde comme une interaction de complexes hétérogènes en perpétuel devenir, où l’on retrouve continuité et discontinuité, et dont l’irréversibilité est la caractéristique fondamentale.
Ainsi, il explique dans les «prolégomènes à l’ontologie de l’être social» (p.410-411):
Et le fondement économique d'une généricité unitaire de l'humanité, le marché mondial, apparaît certes jusqu'à présent sous des formes extrêmement contradictoires, puisque pour le moment il exacerbe au lieu d'atténuer, et encore moins de supprimer les contrastes entre les groupes individuels, mais c'est précisément par là, en raison des interactions réelles qui interviennent jusque dans la vie des individus, qu'il est un moment ontologique important dans l'être social actuel. Ces dernières remarques devraient aussi servir à souligner encore une fois le caractère purement causal de ces processus. Ce sont les déterminations ontologiques elles-mêmes (catégories en tant que formes d'existence) qui avec leurs interrelations ontologiques imposent cette socialisation croissante de l'être social. […]
C'est ce développement objectif de l'être social, dans lequel des catégories toujours plus purement sociales prédominent objectivement dans les processus décisifs, qui nous ramène à la question de la conception marxienne de la genèse et du rôle sociaux de la conscience humaine, de son lien indissoluble avec la praxis sociale comme moment essentiel des processus objectifs sur l'action conjuguée desquels se construit l'être social. […]
Les complexes que constituent la réalité objective et l'image du monde dans la pensée, qui sont très souvent conçus dans la philosophie comme séparés sont des moments ontologiquement inséparables d'un processus en définitive unitaire, historique dans son essence. C'est pourquoi la prise de conscience de la réalité ne peut jamais être saisie adéquatement comme le simple fait de penser « à propos » de quelque chose ; ce « à propos » doit être plutôt considéré comme un moment certes indispensable, mais seulement comme un moment du processus global de pensée, qui a nécessairement son origine et son aboutissement dans les activités sociales de l'homme.
Pour aller plus loin sur la relation entre Lukács et l’existentialisme, nous pouvons également vous conseiller de parcourir le récent ouvrage de Stéphanie Rosa, Le marxisme est un humanisme : Jean-Paul Sartre, Georg Lukacs : deux philosophies pour l'humanité (1923-1975).
Vous pouvez également vous intéresser à la pensée de certains des élèves de Lukas, qui se sont intéressés plus explicitement aux relations sociales. Par exemple Ágnes Heller, dans ses ouvrages Au-delà de soi ou Une éthique de la personnalité.
Vous souhaitant d'excellentes lectures,
Le département civilisations



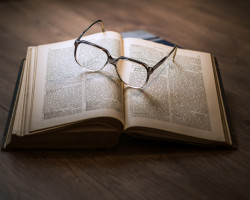
 French Theory
French Theory