Question d'origine :
La rancune semble souvent critiquée, de la Bible à Nietzsche ("ressentiment"), pourtant elle peut être juste et légitime. Quels philosophes en parlent ? Pourquoi cette désapprobation de ce sentiment l'gitime, notamment à la suite d'une trahison ?
Réponse du Guichet
La rancune, plutôt analysée sous le terme de «ressentiment» en philosophie, est en effet le plus souvent connotée négativement. Il faut cependant noter que les philosophes n’en contestent pas toujours la légitimité mais plutôt les effets. Par ailleurs, on peut aussi trouver des analyses plus positives, travaillant sur la valeur ou le dynamisme du ressentiment.
Bonjour,
Courte définition extraite de Les notions philosophiques. Dictionnaire. 2:
«Le ressentiment peut tout d’abord se définir comme l’action ou le fait de ressentir au sens ancien de ce verbe [..]. Aujourd’hui, ce concept évoque très précisément un état d’animosité maintenu par le souvenir d’une offense dont on aspire à se venger. Il a ainsi pour synonymes: rancune ou rancœur […]»
Références
Vous pointez Nietzsche (Généalogie de la morale) et il est en effet un des premiers à associer le ressentiment, cette «morale d’esclaves» à la faiblesse et l’impuissance.
«Le «ressentiment», et Nietzsche en fait ici la véritable théorie, est ce sentiment engendré par une force qui est séparée de ses pouvoirs d’agir. Il est «esprit de vengeance», incapacité d’oublier, désir de conserver ou de retourner au passé censé se tenir plus près des véritables valeurs que le présent.»
Généalogie de la morale. Friedrich Nietzsche, Universalis
Dans les références listées ci-après, ce sont les effets du ressentiment sur l’individu comme sur les sociétés qui sont surtout critiquées. Il s’agit de dénoncer les «pathologies» du ressentiment.
Reviennent essentiellement les risques de repli sur soi, d’inversion des valeurs, de complotisme, de communautarisme, d’enfermement dans la victimisation, de haine de l’Autre.
Le texte en ligne de Marc Angenot Le ressentiment : raisonnement, pathos, idéologie (dans Emotions et discours. L’usage des passions dans la langue) développe fort bien toutes les critiques adressées au ressentiment. Il en fait également «la source des démagogies nationalistes et des idéologies identitaires».
Dans l’article Wikipédia Ressentiment, vous trouverez une liste des principaux auteurs, ayant parlé, souvent négativement, du ressentiment, cette «passion triste», avec des résumés de leur pensée :
Luis Lavelle, Morale et religion, (chapitre IV Amour propre et ressentiment en ligne)
Max Scheler, L’Homme du ressentiment, (lire en ligne « L’Homme du ressentiment » de Max Scheler ou l’erreur de Nietzsche, Cèdric Monget)
Marc Angenot, Les idéologies du ressentiment
Dugald Stewart, Éléments de la philosophie de l'esprit humain
René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque (théorie du bouc émissaire)
Marc Ferro, Le ressentiment dans l'histoire : comprendre notre temps (voir critique)
Plus récemment, le livre de Cynthia Fleury Ci-gît l'amer : guérir du ressentiment : essai, a eu un retentissement certain. Elle fait du ressentiment une maladie de la démocratie :
«Elle explique ainsi comment cette «maladie» est typique de la démocratie, car ancrée dans une profonde aspiration égalitaire – ce qu’ont pu montrer, sur un autre plan, différents travaux de sciences sociales. Pour autant, c’est d’abord aux dynamiques de subjectivation que s’intéresse cet essai. S’il y a des conditions «objectives» au ressentiment (insécurités et inégalités croissantes) et si l’importance d’un État de droit est soulignée, le cœur du questionnement porte sur la part de responsabilité du sujet.»
Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment, Cynthia Fleury/ Gallimard, 2020, 336 p., 21 €, Émilie Reclus, Revue Projet 2021/1 (N° 380), page 94
Autres approches:
Cependant, quelques travaux récents tentent de revaloriser la notion de ressentiment en la comparant au «resentment» anglo-saxon, notamment à partir de Théorie de la justice de John Rawls.
Dans l’article de Passions sociales, écrit par Florent Guénard, on peut ainsi lire, après le déroulé des interprétations traditionnelles :
«Le ressentiment est une passion qui naît en démocratie, mais ce n’est pas une passion démocratique – comme si la démocratie n’était que ce régime de la revanche des faibles contre les puissants. La différence est fondamentale: car en elle se loge la possibilité de comprendre le ressentiment non comme cet «empoisonnement psychologique» des âmes faibles décrit par Scheler, mais comme l’expression émotionnelle du sens de la justice.
[…] Autant dire que le ressentiment n’est pas par lui-même l’émotion des faibles: il est d’abord l’expression d’une aspiration démocratique d’égalité et de droit, qui peut se retourner contre elle-même et s’abîmer dans le ressassement lorsqu’on condamne les hommes ordinaires à l’impuissance.»
Florent Guénard développe cette idée avec Antoine Grandjean dans Le ressentiment, une passion sociale.
«L’ouvrage a pour objectif annoncé de remettre en question trois idées communes sur le ressentiment: (a) le ressentiment serait une passion spécifiquement moderne liée aux sociétés de masse; (b) le ressentiment serait lié à l’interprétation nietzchéenne et schélerienne qui en fait un produit de l’hostilité impuissante des faibles à l’égard des puissants; (c) le ressentiment serait une rancune honteuse, une passion négative, une «passion triste», pour reprendre le vocabulaire spinoziste. Contre ces trois idées, la critique est exposée très clairement dans la quatrième de couverture: l’ouvrage veut montrer que le ressentiment a une histoire […]. Il entend également construire une critique des interprétations traditionnelles […]. Il souhaite enfin organiser une analyse du dynamisme dont le ressentiment est l’expression.»
Le ressentiment : chemin de traverse vers la justice sociale ?, À propos de : Antoine Grandjean et Florent Guénard (dir.), Le Ressentiment, passion sociale, Rennes, PUR, 2012,Solange Chavel, dans Raison publique 2012/2 (N° 17), pages 277 à 281
A lire aussi l’analyse en ligne fouillée « Valeur et légitimité du ressentiment », de Pierre Fasula (en vidéo Pierre Fasula, La valeur du ressentiment, séminaire P4 #11).
Il s’appuie notamment tout en le critiquant sur le texte de Didier Fassin On Resentment and Ressentiment.The Politics and Ethics of Moral Emotions.
A lire également parce que le ressentiment a évidemment à voir avec le pardon:
Une réalité sans nom : l’impardon, Christophe Perrin, Revue philosophique de la France et de l'étranger 2017/2 (Tome 142), pages 159 à 174
Par-delà le crime et le châtiment : essai pour surmonter l'insurmontable, Jean Améry
Pour aller plus loin, mais plus pointu et avec des références essentiellement en anglais :
Article Ressentiment sur l’Encyclopédie Philosophique en ligne
Bonnes lectures !



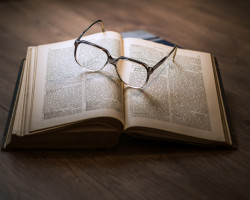
 Ici-bas, pourquoi la Torah n’est pas au ciel
Ici-bas, pourquoi la Torah n’est pas au ciel