Question d'origine :
D'où viennent les règles morales dans les bagarres: 'il ne faut pas s'en prendre à une femme'; 'c'est lâche d'attaquer quelqun par derrière ou de parler dans le dos de quelqu'un'; 'on ne frappe pas quelqun quand il est à terre'; 'c'est lâche de s'en prendre à plusieurs sur quelqu'un' etc?
Réponse du Guichet
Les sociétés ont, depuis tout temps, élaboré des codes de comportement, définissant ce qui était socialement acceptable et ce qui ne l’était pas. Bref, un savoir-vivre propre à un groupe social ou une communauté que l’on peut aussi relier plus largement à la politesse.
Bonjour,
Lorsqu’on aborde l’histoire d’une idée, d’un phénomène, d’un processus, on commence souvent par en évoquer la source. Dans le cas du savoir-vivre, comme l’a fort bien dit Norbert Elias dans son œuvre La civilisation des mœurs, « il est impossible de remonter aux origines d’un processus qui n’en a pas. Où qu’on commence, tout est mouvement et continuation d’un stade précédent ».
Nous pouvons essayer de suivre les différents éléments comme dans un jeu de piste. Dès l’Antiquité, il existe des textes brefs n’ayant que l’ambition d’énoncer des règles à suivre dans certaines circonstances, comme, par exemple, à table, ainsi que des traités de plus grande ampleur, érigeant la politesse et la bonne tenue au rang de l’éthique, comme chez Cicéron et Sénèque. Ils serviront d’inspiration au Moyen Age et permettront de rédiger abondance d’ouvrages que nous pouvons considérer aujourd’hui comme les ancêtres des traités de savoir-vivre plus contemporains. C’est d’ailleurs précisément le Moyen Age qui, loin de négliger le polissage des mœurs, fait émerger le modèle courtois dès la fin du XIe siècle pour en former une sorte d’idéal prônant une vie sociale harmonieuse au milieu de gens attentionnés, bienveillants, intelligents.
L’éthique chevaleresque, répandue par la littérature médiévale, exigeait non seulement la fidélité au seigneur, la protection de l’Eglise, mais plus largement une conduite sans failles dictée par la générosité, le dévouement, la loyauté, le courage et la courtoisie, qualités dont le chevalier devait constamment faire preuve. Citons ici un petit exemple, issu des écrits de Chrétien de Troyes qui mentionne ces vertus dans son roman "Perceval ou le conte du Graal", composé autour de 1180-1190. L’adoubement, la remise publique de l’épée fait entrer l'écuyer dans « l’ordre de la chevalerie, qui doit être sans vilenie » (Perceval, V, 1595-6). Il est aussitôt question de l’éthique chevaleresque qui consiste à épargner le chevalier vaincu, demandant grâce, et secourir les jeunes femmes solitaires.
Au XVIe siècle, l’histoire de la civilité prend un tournant décisif. Elle inspire un véritable genre littéraire, la littérature de la civilité qui se développe durant trois siècles et s’enrichit d’influences diverses. Ces ouvrages réalisent une ambition plus grande : ce sont de grands traités dont le sujet principal est la civilité comprise comme guide de bonne conduite, mais surtout appréhendée comme une véritable « éducation sociale », l’équivalent de ce qu’on désigne aujourd’hui par « l’éducation civique ». Il faut citer deux principaux titres qui fondent ce courant, tous les deux assez rapidement traduits en Europe. Il s’agit du "Livre du courtisan" paru en Italie en 1528, dont l’auteur, Baldassar Castiglione, est un diplomate et un homme de cour lui-même. L’auteur du deuxième livre, Erasme, est un humaniste de renom. "De la civilité des mœurs puériles" publié à Bâle en 1530 s’adresse à un fils de prince, mais le traité reste une œuvre qui enseigne plus largement aux enfants des règles essentielles, une éthique de vie fondée sur le respect des autres et de soi, donne un cadre de vie et un système de valeurs communes.
Dans son petit livre "Politesse, savoir-vivre et relations sociales", le psycho-sociologue Dominique Picard rappelle les 4 piliers du savoir-vivre: la sociabilité, principe constitutif. Elle prône la supériorité du social sur l’individuel et renvoie aux règles qui privilégient le contact et les liens sociaux ; l’équilibre, principe régulateur de l’ordre social qui ancre les relations dans un système d’échanges et de réciprocité. Il préfère par exemple l’accord à l’affrontement. Ensuite vient le respect d’autrui, principe relationnel, qui met en avant le tact et la réserve. Enfin, le respect de soi se présente comme le principe déterminant de la tenue. Il s’exprime dans la distinction, valeur essentielle à laquelle aboutissent l’ensemble des attitudes prônées par le savoir-vivre.
Dans l’ouvrage de Frédéric Rouvillois, "Histoire de la politesse de 1789 à nos jours", éd. Flammarion, 2020, vous trouverez également un chapitre intéressant dédié à l’histoire du duel vu à la fois comme sanction et objet de politesse, où les principes généraux d’égalité sont clairement soulignés. Selon un de ses principaux théoriciens, Adolphe Tavernier, pour qu’il puisse y avoir un duel, encore faut-il que l’offense subie soit le fait d’un égal. Un homme du monde ne saurait se mesurer à un vieillard, à un enfant, à un individu sans honneur ou d’une classe sociale nettement inférieure à la sienne. Dans ce chapitre, l’auteur rappelle également qu’il serait impossible à l’homme du monde de se mesurer avec une femme. De toute évidence, il ne pourrait contrevenir au principe d’égalité des armes ni piétiner l’obligation fondamentale de protéger toute personne du sexe faible.
Une exposition au Musée de l’Armée à Paris illustrant le duel en tant qu’art du combat peut également vous intéresser. A titre d'information, elle est ouverte jusqu’au 18 août 2024.
Pour élargir le champ de votre question, vous pouvez lire "La raison des gestes dans l’Occident médiéval" de Jean-Claude Schmitt, éd. Gallimard 1990 et les publications de Jean Flori, spécialiste du Moyen Age, comme, e.a. "Chevaliers et chevalerie au Moyen Age", éditions Hachette, 1998 ou, plus succinct, "La chevalerie", éd. Gisserot, 2015.
Nous vous souhaitons d’agréables découvertes !



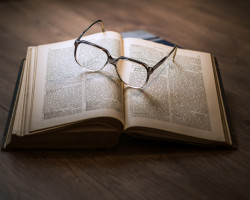
 Zones
Zones