Comment mentionner plusieurs fois en note une archive dans un travail universitaire ?
Question d'origine :
Bonjour,
Dans un travail universitaire ou scientifique, lorsqu'on mentionne plusieurs fois en note la même archive, quelle abréviation peut-on utiliser afin de ne pas alourdir les notes infra-paginales ? NB : je parle bien bien d'un document d'archive, non pas d'un livre ou d'un article. Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur les sites qui exposent les normes académiques sur le sujet.
Cordialement.
Réponse du Guichet
Il existe plusieurs normes pour citer des archives en bas de page. Concernant les documents cités plusieurs fois, nous n'avons trouvé nulle part d'information précise. Le recours à des livres en citant abondamment nous apprend toutefois que les abréviations Id. et Ibid. sont couramment employées pour les archives, mais pas les Op. cit.. Si vous réalisez une thèse ou un mémoire universitaires, votre directeur ou directrice sera, en dernier recours, vous ôter vos derniers doutes !
Bonjour,
Les quelques documents que nous possédons sur la méthodologie et la rédaction de mémoires et de thèses sont assez elliptiques sur le sujet des notes de bas de page ; nous n'y trouvons rien d'intéressant pour votre questionnement.
Il y a quelques années nous répondions à la question note de bas de page pour citer une archive. Nous y citions le blog "Devenir historien-ne" qui a consacré un article à la question Comment citer un document d’archives, une thèse ou un mémoire ?, source qui reste encore aujourd'hui la plus claire et complète que nous ayons trouvé sur le sujet... mais qui ne donne pas de réponse directe. L'auteur de l'article, l'historien Emilien Ruiz, remarque en effet :
Il existe probablement autant de façons de citer des sources qu’il existe de sources… Il y a toutefois au moins un principe de base à respecter : citez systématiquement l’ensemble des informations qui permettront d’identifier en détail le document ainsi que le fonds où vous l’avez trouvé.
Concernant la citation en bas de page, on apprend tout de même :
Dans une note de bas de page, il faut identifier le plus précisément possible le document utilisé, tandis que les détails du fonds de conservation peuvent être légèrement résumés.
Par exemple :Note n°2.023 du directeur du Budget (Gourdin) pour le ministre des Finances (Cathala), Paris, le 11 mai 1942. CAEF, fonds Cabinets, 1A032.
Ici figure l’ensemble des informations disponibles sur le document lui-même : toutes les notes, correspondances et autres archives administratives ne sont pas numérotées, l’auteur et le destinataire ne sont pas toujours indiqués, de même que la date… L’essentiel est de repérer les informations disponibles et de les noter avec précision.
Le de conservation de cette note est aussi mentionné : il s’agit du Centre des archives économiques et financière, qui se situe à Savigny-le-Temple (et fera probablement l’objet d’un billet dans la rubrique “lieux“). Le document est tiré du fonds “Cabinet” (ce qui correspondrait, aux Archives nationales, à ce que l’on appelle la “série”), et conservé dans un carton sous la cote “1A032”.
L’ordre dans lequel vous mentionnerez le document et le centre d’archives n’a pas véritablement d’importance, l’essentiel étant (comme toujours) de maintenir une certaine cohérence dans votre mémoire : si vous citez vos archives en commençant par le document ou par le centre d’archives, il faudra procéder de la même façon jusqu’à la fin.
Ici, la note pourrait donc tout à fait être :
CAEF, fonds Cabinets, 1A032. Note n°2.023 du directeur du Budget (Gourdin) pour le ministre des Finances (Cathala), Paris, le 11 mai 1942.
En note de bas de page, ma préférence va à la première façon de faire (d’abord le document, puis le fonds), car elle me semble beaucoup plus agréable à la lecture.
L’utilisation d’une abréviation pour le nom du centre d’archives, voire pour les noms des séries, s’impose souvent d’elle-même. Généralement, il faut veiller à citer le centre et la série en toutes lettres lors de la première mention en note et préciser que l’abréviation sera utilisée pour le reste du document.
L’idéal est de bien mentionner cette abréviation dans la partie “Sources et bibliographie” de votre mémoire, de façon à ce que l’on puisse s’y référer au lieu de rechercher la première note dans les dizaines, voire centaines, de pages qui précèdent pour retrouver le nom du centre.
L'article ne dit pas un mot des citations répétées de la même source, mais la discussion au bas de l'article évoque cette question. A une personne qui dit vouloir "éviter les “art. cit.” “op. cit.” et autres “ibid", l'auteur répond ne pas voir pourquoi ceux-ci "prendraient une place folle" - validant implicitement leur usage - non sans préciser qu'une certaine liberté est possible "si tant est que la discipline, le/la directrice de recherche, etc. l’acceptent".
Nous mettons cette phrase en gras car il ne faut pas oublier que, si vous rédigez un mémoire ou une thèse par exemple, votre directeur ou directrice aura son mot à dire sur vos partis-pris rédactionnels ! Il peut dès lors s'avérer utile de s'adresser à cette personne pour des questions de ce type.
Nous avons toutefois continué nos recherches. Comme vous, nous avons échoué à trouver notre information sur les sites suivants :
Université laurentienne (Canada)
Université de Neuchâtel (Suisse)
Université du Québec à Montréal (Canada)
Ayant toutefois à notre disposition un très large catalogue d'ouvrages en tous genres - mais très peu d'ouvrages universitaires, du fait de notre vocation généraliste - nous sommes alors allés voir à la source, c'est-à-dire dans des ouvrages ayant des chances de citer des archives, donc des livres d'histoire. Nous en avons sélectionnés trois sur le simple critère qu'ils en citent abondamment :
Vivre à Paris pendant la Grande Guerre / Pierre Darmon
Les Juifs français et le nazisme (1933-1939) : l'histoire renversée / Jérémy Guedj ; préface de Johann Chapoutot
L'affaire Lip : 1968-1981 / Donald Reid ; traduit de l'anglais par Hélène Chuquet ; préface de Patrick Fridenson
Dans le premier de ces ouvrages, on peut lire au bas de la page 111 :
10. APP, carton D/B, document non daté.
11. Ibid., circulaire non datée (1916) du Préfet de Police au directeur de la Police judiciaire et aux commissaires de Police.
Ce qui suggère que le bon vieil Ibid est applicable aux archives, mais également que l'auteur considère le carton d'archives comme une entité intellectuelle, comme il le ferait d'un ouvrage ou d'un article.
On lit également p. 269 :
11. ASSA, carton A 3046, note du 30 juillet 1915.
12. Ibid., note du 15 août 1915.
Toutefois, lorsque deux citations d'une même source ne sont pas consécutives, ou qu'elles se trouvent sur deux pages différentes, l'auteur choisit de ne pas utiliser d'abréviation type "Op. cit." mais de répéter le nom de la source (en l'occurrence, ici, "ASSA, carton A 3046").
L'auteur du second livre, Jérémy Guedj, utilise "Id." quand il cite le même document, même si ce n'est pas sur la même page (voir pp.240-241). Contrairement à Pierre Darmon, il opère un distinguo entre les différents documents d'un même carton, puisqu'aux pages citées et à la suivante la source "CADN, Tunisie, 1er versement, carton 1724" est citée intégralement trois fois, la description du document considéré étant précisée chaque fois.
Donald Reid, enfin, dans le dernier ouvrage, utilise volontiers Ibid. quand deux citations du même document se suivent, mais opère comme Jérémy Guedj s'il s'agit de deux documents distincts conservés ensemble.
En revanche nous ne trouvons nulle part la mention Op. cit., ce qui paraît logique puisqu'il serait difficile de considérer une archive comme un "Opus", une œuvre...
Nous espérons vous avoir été utiles et vous souhaitons une bonne journée.



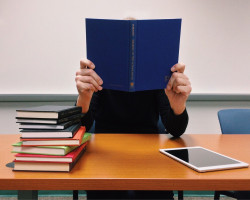
 Méditerranée
Méditerranée