Ces réflexions sur Don Quichotte ont-elles été abordées dans la littérature sur le sujet ?
Question d'origine :
Cher Bibliothécaire, bonjour,
1°Je voudrais savoir s'il existe quelques occurrences de l'expression "Je veux pas me le rappeler", signifiant "Je n'arrive jamais à me le rappeler" ?
Au début de Don Quichotte, il est écrit "Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom...", et j'ai lu dans une édition critique espagnole de cette oeuvre que "je ne veux pas me rappeler" pourrait signifier "je n'arrive pas à me rappeler (malgré mes efforts". Or, je crois me souvenir avoir entendu quelquefois certaines personnes dire "Je ne veux vraiment pas me rappeler ce nom" quand pour la nième fois ce nom ne leur revient pas.
Qu'en pensez-vous?
2) Toujours au sujet de Don Quichotte, en lisant le récit du portrait qu'un témoin oculaire fait de Dulcinée, une paysanne assez moche et crasseuse, et donc ne collant absolument pas avec l'image idéalisée que s'en fait Don Quichotte et son intention proclamée de combattre à mort tous ceux qui ne la reconnaîtraient pas comme la plus belle femme du monde sans l'avoir vue et sur la seule foi de ce que Don Quichotte en dit, je me suis fait la réflexion que cette histoire rappelait étrangement le statut de la Vierge Marie, idéalisée, belle comme le jour,et que tout chrétien est censé admirer et vénérer sous peine de mort (à l'époque) toujours jeune et dont aucun témoin oculaire n'a fait la description physique, sans doute celle d'une simple femme de charpentier, peut-être nullement belle et ne suscitant nulle admiration particulière en son temps...
D'autres indices dans la première partie du livre m'ont fait penser qu'il y avait entre les lignes une subtile critique de la religion.
Songez que Don Quichotte croit dur comme fer aux "merveilles" des livres de chevalerie et que le curé (tiens, tiens) fait un autodafé de tous ces livres impies. Par ailleurs Don Quichotte raisonne bien et est de bon conseil quand il n'est pas prisonnier de sa "folie". Peut-on imaginer en comparaison, un brave marchand chrétien, très sage en affaires et dans sa famille, mais passionné par la religion, la Trinité, la Résurrection, les miracles de Jésus, etc. Ne devrait-il pas pris pour un fou?
Est-ce que vous savez si une telle opinion a déjà été rapportée dans l'immense littérature que cette oeuvre a suscitée?
Je vous remercie par avance.
Réponse du Guichet
S'il existe quelques occurrences de l'expression "Je ne veux pas me rappeler de ce nom", elles sont bien souvent analysées comme le refus de nommer l’innommable ou pour éviter de raconter quelque chose de désagréable, de déshonorant, de honteux, ou d'offensant.
Dans son "Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche", Miguel de Cervantès dresse une critique de la crédulité superstitieuse et des excès de l'Inquisition.
Bonjour,
Cervantes utilise délibérément une vieille expression castillane (vouloir + infinitif) qui peut signifier qu'il n'arrive pas à s'en rappeler mais nous supposons qu'il ne souhaite pas réellement indiquer le lieu de provenance de Don Quichotte.
D'après nos lectures, il semblerait en effet que Cervantes refuse délibérément de mentionner un nom de lieu dont il se souvient sans doute. Nous traduisons (approximativement, veuillez nous en excuser) un article extrait de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes :
Mais la construction syntaxique "(no) querer acordarse de " était bien connue et utilisée aux XVIe et XVIIe siècles. Nous avons extrait du CORDE (Corpus Diachronique de l'Espagnol) de l'Académie Royale Espagnole, à titre d'exemple, plus de cinquante citations non-Cervantines antérieures à Don Quichotte. [...] dans les rares usages personnels de "querer + infinitif" collectés par l'Instituto Caro y Cuervo, cette périphrase signifie "aller, être sur le point de", et indique des actes dans lesquels une décision consciente fait défaut, comme tomber ou mourir, mais pas "se souvenir" (tout comme "quelque chose est sur le point d'arriver" dans des phrases impersonnelles et non personnelles , du type "il veut pleuvoir" ou "le soleil veut se coucher", d'où peut-être vient cet usage). En revanche, toutes les citations de CORDE avec "querer + acordarse" sont dépourvues de ce sens et expriment un acte de volonté évident et délibéré, comme si la mémoire en dépendait en grande partie, plutôt que de l'inconscient, comme dans les cas courants. [...]
En résumé, Cervantes ne crée aucune expression qui lui soit propre, ni ne lui confère un nouveau sens périphrasique pour son usage personnel, ni même ne la place pour la première fois là où le lecteur la trouve : mais en utilisant la vieille formule castillane avec sa valeur habituelle dans l'ouverture du Quichotte, avec son aide, il donne déjà le ton d'une forme inaccoutumée de narration, qu'il s'agisse de perspectivisme, de relativisme ou de réalité oscillante, par cette formule. Il ne s'agit pas de diminuer l'originalité du narrateur, mais d’essayer de le décrire dans ses termes propres.
À ce stade, il faut se demander pourquoi Cervantes peut refuser de se souvenir d'un toponyme. Bien sûr, pas sur un coup de tête, sans raison précise, car cela n’arrive jamais dans aucun autre exemple.
source : De cuyo nombre no quiero acordarme / Alfredo Baras Escolá - Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Ce village de la Manche que Cervantes ne veut pas nommer est probablement Argamasilla d’Alba où il a été détenu en prison :
l'on admet presque généralement que ce furent les habitants du bourg d'Argamasilla de Alba qui jetèrent Cervantès en prison, révoltés contre lui, soit parce qu'il leur réclamait des dîmes arriérées pour le grand prieuré de San-Juan, soit parce qu'il enlevait à leurs irrigations les eaux de la Guadiana, pour y préparer des salpêtres. Il est certain qu'on montre encore aujourd'hui dans ce bourg une antique maison, appelée casa de Medrano, où la tradition immémoriale du pays place la prison de Cervantès. Il est également certain que le pauvre commissaire des dîmes ou des poudres y languit fort longtemps, et dans un état si misérable, qu'il fut obligé de recourir à son oncle, don Juan Barnabé de Saavedra, bourgeois d'Alcazar de San-Juan, pour lui demander sa protection et ses secours. On conserve le souvenir d'une lettre écrite de Cervantès à cet oncle, et qui commence par ces mots : « De longs jours et de courtes nuits (des insomnies) me fatiguent dans cette prison, ou pour mieux dire, caverne.... » C'est en mémoire de ces mauvais traitements qu'il commença le Don Quichotte par ces mots de bien douce vengeance : « Dans un endroit de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom.... »
source : L'ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche / par Miguel de Cervantes Saavedra
En français, on retrouve également la construction syntaxique "ne pas vouloir se rappeler" mais bien souvent, dénonçant le refus de se rappeler d'un nom. En omettant de prononcer un nom, on veut probablement éviter de raconter ou d'expliquer quelque chose de désagréable, de déshonorant, de honteux, ou d'offensant. Voici quelques exemples d’occurrences extraites de la base Gallica :
Nous dûmes cette dureté à un jeune lieutenant dont je ne veux pas me rappeler le nom. Il était logé en face de l'église et notre aspect lui était sans doute désagréable.
source : Après la défaite : souvenirs & impressions d'un prisonnier de guerre en Allemagne / Victor Thiéry
Je suis allée chez vous , me dit-elle d' une voix mal assurée , j'ai dit qu'il fallait que je vous parlasse tout de suite. On m' a dit que vous étiez peut-être dans cette maison. J' y suis venue vous demander, vous veniez d'en sortir avec une dame dont on m' a dit le nom, que je ne veux pas me rappeler. Je
vous ai attendu, vous n'êtes pas rentré seul, je ne pouvais donc vous aborder. J' ai attendu de nouveau, j' eusse attendu jusqu' au jour, puisque je voulais vous voir et vous parler.
source : La dame aux perles / Alexandre Dumas fils
« Dans une ville dont je ne veux pas me rappeler le nom, on laissa dans la misère, poursuivi, sans secours, emprisonné, cet homme qui révolutionna l'art nautique en inventant l'hélice...» Signé GERMOND DE LAVIGNE. »
source : Les Dents du dragon / Alphonse Karr
Samuel a mis bas quatre livres de science : un livre sur les quatre évangélistes, — un autre sur la symbolique des couleurs, — un mémoire sur un nouveau système d'annonces, — et un quatrième dont je ne veux pas me rappeler le titre. — Ce qu'il y a de plus épouvantable dans ce dernier, c'est qu'il est plein de verve, d'énergie et de curiosités. Samuel a eu le front d'y mettre pour épigraphe : Auri sacra famés !
source : La fanfarlo / Charles Defayis
Bénédicte tomba malade. or C'est grave m, avoua le médecin. Et il me dit un nom de maladie, crue je ne veux pas me rappeler. Ma surprise fut égale à mon désespoir. Une maladie — dont on meurt! J'étais si satisfait de la vie que je n'avais jamais songé à la mort. D'ailleurs,
nous étions trop jeunes.
source : Le Voleur illustré : cabinet de lecture universel
Pour répondre à votre deuxième question : doit-on voir en Don Quichotte une critique de la religion ?
Il semble s'agir davantage d'une critique de la crédulité et des comportements superstitieux, de l'attitude du croyant inconditionnel et des excès de la contre-réforme.
Quand la duchesse, lectrice assidue du premier volume, reçoit don Quichotte dans son château et lui soutient que « cette dame n’existe pas », sinon dans son imagination, le chevalier errant lui rétorque : « Dieu sait s’il y a une Dulcinée au monde ou non, fantastique ou non : car ce ne sont pas des choses dont on doive faire la vérification jusqu’au bout » (II, 32, p. 279)6. Le refus de la « vérification » [averiguación] fait de la croyance en Dulcinée un véritable acte de foi de sa part. L’homologie avec la croyance en Dieu ne cesse de troubler quand on pense à la tension de longue date qui parcourt la théologie chrétienne entre d’une part l’affirmation de la possibilité de preuves rationnelles soutenant la croyance, et d’autre part le rappel de l’inconditionnalité et du caractère non rationnel de la foi. Don Quichotte l’avait affirmé aux marchands tolédans rencontrés au début de ses aventures, mais sur le ton de la certitude objective plutôt que sur celui de la conviction intime : « L’important est de le croire sans la voir ; et de le confesser, de l’affirmer, de le jurer et de le soutenir les armes à la main » (nous modifions la traduction « Folio », I, 4, p. 93)7. Le dogmatisme dont il faisait preuve alors était loin de son attitude de la seconde partie, où il manifeste une prudence accrue, multipliant les expressions comme « à mon avis », « il me semble », « tout est possible », et les mises en garde répétées contre les apparences à l’adresse de Sancho. Dans sa réponse à la duchesse, il rejette la réalité de Dulcinée dans le domaine de la connaissance incertaine, et même de la connaissance impossible. Sa croyance, consciente de sa fragilité, suppose ici le doute ; elle contient ou enveloppe en elle la possibilité de l’incrédulité. Elle devance ainsi toute objection, articulant, comme souvent au XVIe siècle, une attitude sceptique vis-à-vis du désir de connaissance à une posture radicalement fidéiste (une foi qui se passe de justification rationnelle). C’est ce qu’avait bien vu un grand interprète chrétien de Cervantès au début du XXe siècle, Miguel de Unamuno, dans une autre de ces lectures à la fois fulgurantes et contestables du Quichotte8. Une lecture fin de siècle tout de même contestable, parce que le référent chrétien n’est ici que le comparant de la Dulcinée imaginaire : le transfert métaphorique, dont nous verrons plus loin les conséquences, fait que l’attitude du croyant s’applique ici non pas à la foi chrétienne mais à une fiction romanesque. [...]
Américo Castro a le premier attiré l’attention sur les allusions de Cervantès, forcément plus discrètes que celles d’un Rabelais en France, étant donné le contexte inquisitorial et censorial de l’Espagne à son époque12. À bien des reprises, Cervantès procède à travers son duo comique à une satire du comportement superstitieux : don Quichotte et Sancho ne cessent de voir des présages, de crier au démon, de se signer. Les deux personnages se renvoient la balle : don Quichotte se moque souvent de la crédulité de Sancho, mais Sancho retourne la leçon tant rabâchée par son maître quand ce dernier croit reconnaître des « signes » annonçant son malheur (II, 73). Leur attitude lors de la rencontre avec le cortège funèbre (I, 19) est d’autant plus comique que la peur superstitieuse est réversible : si le chevalier, « catholique et chrétien fervent » comme il le rappelle, prend les pénitents pour des démons échappés de l’enfer, ces derniers croient voir en lui un diable. De même, la plaisanterie continuée des coups de fouet que doit s’infliger Sancho dans la seconde partie équivaut à une parodie de grande ampleur des pratiques pénitentielles ; un épisode comme celui du désenchantement de la pseudo-Altisidore (II, 69) est une satire pure et simple des faux-miracles, grand sujet de préoccupation à l’époque13. Mais il y a plus : quand le chevalier de la Manche se définit comme chevalier de la foi incarnant les valeurs de la féodalité chrétienne, quand il charge les passants ou les moutons qui se trouvent sur son chemin (surtout dans la première partie), il compromet avec lui une version fanatique du catholicisme militant souvent associé à la contre-réforme, notamment à Philippe II (1547-1598), ce souverain croisé qui avait peu d’affinités avec Cervantès, et qui avait entraîné l’Espagne dans quelques déroutes par excès de zèle et d’idéalisme.
Il n’y a pas lieu d’y voir un quelconque parti pris anti-chrétien, même à l’état d’allusion : l’idée qu’il ne faut pas croire à la légère se rencontre fréquemment dans le christianisme renaissant, notamment dans la mouvance érasmienne. La nécessaire méfiance peut s’alimenter de lieux communs bibliques, comme ce « Operibus credite, et non verbis » (Jn, 10, 38) par deux fois répété : « Croyez les oeuvres et non les paroles »14. Incrédulité ne signifie pas incroyance, et l’on trouverait difficilement trace d’une telle attitude chez Cervantès. Le désir de tolérance souvent manifesté chez lui, avec une certaine ambiguïté quand il s’agit des minorités morisques ou gitanes, le situe dans la lignée du christianisme dépouillé et charitable recommandé par Érasme.
source : Correard, Nicolas. « Croyance et incrédulité dans Don Quichotte : une perception (pré-)moderne de la fiction ». Naissance du roman moderne : Rabelais, Cervantès, Sterne, édité par Christian Michel, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2007
Pour aller plus loin :
- Nicolas Correard, « Lucien, Torquemada et les « merveilles » des mondes cervantins », Atalaya, 19 | 2019
- El pensamiento religioso de cervantes revisión bibliográfica y estado de la cuestión / Blanva Santos De La Morena
- Lo RELIGIOSO en el QUIJOTE et l'ouvrage de Salvador Muñoz Iglesias : Lo religioso en el Quijote
Bonne journée.



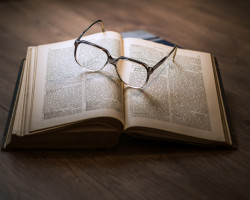
 Le boom des retraductions
Le boom des retraductions