Quelles sont les origines du langage argotique et familier ?
Question d'origine :
D'où viennent les expressions que les gens utilisent comme insultes? Quelles sont les origines du langage soutenu et du langage argotique ou familier?
Réponse du Guichet
En règle générale, la sociolinguistique distingue trois niveaux de langue : le registre courant, le registre littéraire ou soutenu et le registre familier, argotique voire ordurier.
Ces niveaux de langue proviennent de la diversité des usages de la parole, en fonction d'une situation de communication précise, de contextes variés (environnement, âge du locuteur et de l'allocutaire...) ou encore du milieu social dans lesquel ou par référence auquel la parole est employée. La variété des façons de parler s'inscrit aussi dans le temps (changements diachroniques résultant de l'évolution de la langue) et l'espace (variations géographiques dites diatopiques – dialectes et patois).
Sur le plan stylistique, on note que les expressions du registre familier et argotique trouvent leur origine dans des procédés aussi bien sémantiques (emprunts à d'autres langues) que formels (inversions des syllabes en verlan).
Bonjour,
Vous souhaitez connaître les origines du langage soutenu et du langage familier ou argotique incluant les insultes. Ce champ d'étude relève de la linguistique et plus spécifiquement de la sociolinguistique qui se penche sur les liens entre le langage et la société. D'autres disciplines comme la géolinguistique, la linguistique historique et l’ethnolinguistique étudient ces liens.
En effet, à travers votre question, vous interrogez la notion de "registres de langues" que nous tenterons de définir ci-dessous, notamment grâce aux articles de l'Encyclopédie universalis consacrés respectivement aux niveaux et aux registres de langues.
La notion de registre de langue correspond aux différents usages de la langue, dans une situation de communication précise. Celle-ci dépend du contexte, des personnes à qui le locuteur s’adresse (un proche, un supérieur hiérarchique, un inconnu...), de son milieu socioculturel, de son âge, etc. Un même locuteur peut donc employer tour à tour différents niveaux de langue correspondant à diverses situations. À l’inverse, un niveau de langue peut ne pas correspondre à la situation de communication dans laquelle il est employé. Cela peut être voulu par le locuteur, et crée donc un décalage. Ou bien le locuteur peut n’en être pas du tout conscient. Par exemple, un registre soutenu utilisé dans une conversation peut donner l’impression d’un locuteur prétentieux.
La linguiste Catherine Fuchs donne une définition des registres de langue (ou registres de paroles) :
On appelle «registres de langue» les usages que font les locuteurs des différents «niveaux de langue» disponibles, en fonction des situations de communication. Ces usages relèvent de la «parole» telle que la définit Ferdinand de Saussure (1857-1913), c'est-à-dire de l'utilisation effective de la langue : c'est pourquoi on parle également de «registres de la parole».
Source : Encyclopédie universalis
Les différences entre ces registres sont de nature lexicale mais également phonétique, morphologique et syntaxique. On remarque ainsi que les formations lexicales argotiques recourent à une multiplicité de procédés aussi bien sémantiques (emprunts à d'autres langues, métaphores) que formels (inversions des syllabes en verlan, troncation des mots, redoublement de syllabes, etc.). Les différences linguistiques entre niveaux de langue peuvent également toucher la phonétique, la morphologie et la syntaxe : là où la langue soutenue dit « Qu'as-tu mangé ? », la langue populaire dit « T'as mangé quoi ? ».
En règle générale, 3 niveaux de langue peuvent être distingués : le registre courant, le registre littéraire ou soutenu et le registre familier. Les dictionnaires font généralement mention du niveau de langue associé à l'acception d'un mot ( niveau courant "avoir peur" vs niveau familier "flipper").
Le registre courant, utilisé à l'oral comme à l'écrit, est employé dans des situations quotidiennes, dans lesquelles les locuteurs se connaissent peu (travail, démarches administratives...) et se caractérise par l’emploi de phrases à structure correcte, mais simple. Les règles linguistiques sont généralement respectées et le vocabulaire est ordinaire.
Le registre soutenu / littéraire, principalement utilisé à l'écrit, est employé dans des situations plus officielles (discours solennels, textes littéraires...) et se caractérise par l’emploi de phrases à structure souvent complexe. Toutes les règles linguistiques sont respectées ; le vocabulaire est recherché, c'est-à-dire rare (comme le mot "corroboration") ou littéraire (comme le mot "bisaïeul") et certains temps verbaux sont privilégiés comme le passé simple, le plus-que-parfait, les temps du subjonctif...
Le registre familier / populaire / argotique voire vulgaire, principalement utilisé à l'oral, est employé dans des situations informelles, dans lesquelles les locuteurs sont proches et n’ont pas de rapport hiérarchique (les conversations entre amis...) et se caractérise par l’emploi de phrases à structure relâchée (Tu habites où ?), voire parfois incorrecte : omission du "ne" dans les formes négatives du verbe (J’habite pas ici) ou omission de syllabes (p’tit-déj). Le vocabulaire y est familier (baffe, clébard...), populaire (pour les mots associés à un groupe social), argotique (teuf, kiffer, castagner, chnouf...) ou vulgaire voire insultant et ordurier (chlinguer, ta gueule).
> Sur l'argot plus précisément, vous pouvez lire l'article en ligne de Pierre Guiraud, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Nice : L'argot in Encyclopédie Universalis (Consulté le 20 février 2025).
> Sur les dialectes et patois, vous pouvez lire l'article en ligne de Pierre Encrevé, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris : Dialectes et patois in Encyclopédie Universalis (Consulté le 20 février 2025)
La sociolinguistique
La notion de niveaux de langue a été reprise par la sociolinguistique en termes de variétés de langue où sont distinguées des variétés en fonction de l'usager et des variétés en fonction de l'usage. Au titre des premières, on range les variétés diachroniques (diversité dans le temps), diatopiques (diversité dans l'espace géographique) et diastratiques (diversité dans la société). Au titre des secondes, se trouvent les variétés diaphasiques (diversité de styles, niveaux ou registres) et diamésiques (diversité liée à l'emploi écrit ou oral).
Conduites dans le cadre de la sociolinguistique variationniste, diverses études ont montré que la façon dont les locuteurs pratiquent leur langue résulte d'une dynamique complexe : ainsi Françoise Gadet dans La Variation sociale en français (2003). En définitive, il apparaît que les performances langagières des locuteurs sont fonction tout à la fois de leur répertoire et des ressources qu'ils utilisent, mais aussi de leurs fonctionnements cognitifs ainsi que du jugement qu'ils portent sur leur langue et sur la manière dont eux-mêmes ou d'autres la parlent.
Source : Encyclopédie Universalis
Ainsi, le comportement linguistique d'un locuteur est défini par un couple de concepts : compétence (ou savoir linguistique du locuteur) et performance (ou réalisation concrète de ce savoir linguistique dans des actes de communication, qu'il s'agisse d'émission (le sujet fait des phrases) ou de réception (le sujet comprend des phrases).
> à ce sujet nous vous conseillons de lire l'article de Louis-Jean Calvet, docteur ès lettres et sciences humaines, professeur à la Sorbonne : compétence et performance linguistique.
> Sur la sociolinguistique en particulier, vous pouvez lire l'article de Catherine Fuchs.
Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre à la Bibliothèque municipale de Lyon qui donne accès à de nombreux documents sur le sujet :
Livres sur la sociolinguistique
Les expressions les plus truculentes de la langue française [Livre] / Daniel Lacotte, 2014
Injuriez-vous ! [Livre] : du bon usage de l'insulte / Julienne Flory, 2016
Les insultes en français [Livre] : de la recherche fondamentale à ses applications (linguistique, littérature, histoire, droit) / dir. Dominique Lagorgette, 2009
Parler en ville, parler de la ville [Livre] : essais sur les registres urbains / dir. Paul Wald, 2004
Les voix de la ville [Livre] : introduction à la sociolinguistique urbaine / Louis-Jean Calvet, 1994
Les élites lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur langage [Livre], 2007
Histoire de la langue française [Livre] / Jacques Chaurand,..., 2021
Dictionnaire amoureux de la langue française [Livre] / Jean-Loup Chiflet, 2014
Les curiosités de la langue française pour les nuls [Livre] / Jean-Loup Chiflet, 2020
Bonne journée !



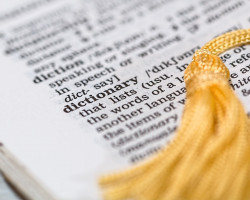
 Le boom des retraductions
Le boom des retraductions