Ce diagnostic sur l'indépendance des universités et de la recherche est-il d'actualité ?
Question d'origine :
Cher Guichet,
Dans "l'Histoire assassinée; les pièges de la mémoire , Editions de Paris,", 2006, jacques HEERS écrit page 254 : "Monsieur X et Madame Y (...) sont en charge des ECUE(s) qui ne portent pas de nom s et que l'on désigne par des assemblages de lettres et de chiffres : AZB14,CDX22,. Il parle de temps perdu, de recherche sacrifiée, de chercheurs sous tutelle , d'universités dépossédées de leur indépendance.
Qu'en est-il de ce diagnostic sévère en 2025, 15 ans plus tard ?
Réponse du Guichet
Les libertés académiques semblent reculer à travers le monde depuis 2006 mais se stabilisent en France avec un taux à 0.90 selon les chiffres donnés par l'Academic Freedom Index. En revanche, la France est à la peine en ce qui concerne l'autonomie de ses universités qui sont jugées encore très insuffisantes par la Cour des Comptes dans une note publiée en 2021. Des améliorations sont nécessaires en matière de ressources humaines, de gestion financière ou d'indépendance de la recherche. La surcharge des tâches administratives et les décisions ubuesques créées par l'organisation universitaire semblent être aujourd'hui encore au coeur des contestations des enseignants et professeurs de l'enseignement secondaire.
Bonjour,
Si l'ouvrage de l'historien médiéviste Jacques Heers, L'Histoire assassinée : le piège de la mémoire (Editions de Paris, 2006), est surtout une critique de la manipulation de l'enseignement de l'Histoire à des fins politiques pour servir ce qu'il nomme une véritable "propagande d'Etat", le chercheur aborde aussi, à la fin de son livre, la situation qu'il juge critique du milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur en France au milieu des années 2000.
Dans des pages à charge, il s'attaque aux arcanes de l'administration universitaire, aux situations ubuesques occasionnées par une surenchère de réformes qui font grossir les rangs des corps intermédiaires au sein de ces établissements et dénonce des décisions politiques trop souvent verticales provoquant pertes d'autonomie des universités et essouffement des libertés académiques.
Si nous ne pourrons procéder à la vérification des propos de J. Heers et les comparer à la situation de l'enseignement supérieur en France eu début/milieu des années 2020, nous pouvons vous proposer une série d'études et de rapports en lien avec l'autonomie des universités et l'analyse de l'étendue de leurs libertés académiques.
Hasard ou non ? À vous d'en juger, mais nous tenons en premier lieu à porter à votre connaissance cet article du journal Le Monde qui fait état des conclusions d'une enquête de portée internationale qui entend mesurer objectivement le degré de libertés académiques des universités des pays du monde entier : La liberté académique menacée dans le monde : « Les universitaires ont intérêt à s’exprimer ouvertement avant qu’il ne soit trop tard ».
Très pratique pour répondre à votre question, cette étude de 2023 s'appuie sur des chiffres de 2006 pour évaluer mondialement les fluctuations de ces libertés à l'aide d'un indice de 0 à 1 construit à partir de 5 critères d'appréciation : la liberté de recherche et d’enseignement, la liberté d’échange et de diffusion universitaires, la liberté d’expression académique et culturelle, l’autonomie institutionnelle des universités et l’intégrité des campus.
Entre 2006 et 2023 donc, les scientifiques observent une tendance générale à la baisse de cette liberté : "En 2006, année faste un citoyen sur deux dans le monde vivait dans une zone de liberté académique, désormais cette proportion est d’un citoyen sur trois." A ce titre, 45,5% de la population mondiale vivrait dans un pays où la liberté académique n'existe pas.
La France conserve entre 2006 et 2023 un niveau élevé de liberté académique si l'on se réfère à cet indice. Légèrement en hausse, la France passe en 17 ans de 0.89 à 0.90, ce qui la classe parmi les meilleurs au monde et à un niveau assez élevé en Europe. Si vous ne possédez pas d'abonnement au Monde, rendez-vous sur la carte interactive du site de l'Academic Freedom Index.
Pour des données légèrement actualisées et une mise en perspective par classement de la situation de la France dans le monde, voir ce rapport 2024 en anglais qui met à jour d'une année les données 2023 : Academic Freddom Index - Update. La France redescend un peu et se place 25ème position mondiale.
Voir également le compte rendu de ces études proposé par la Ligue des Droits de l'Homme : Les libertés académiques en recul. Ou cette émission diffusée sur France Culture en 2024 et qui réunit des universitaires et spécialistes de la question : Universités : les libertés académiques sont-elles menacées ?
Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, nous pouvons vous proposer cet article de Camille Fernandes, La liberté académique, une liberté spécifique? publié dans la Revue des Droits de l'Homme (n°24, 2023)
Pour rappel, ces chiffres mesurent la liberté académique, un droit accordé aux universitaires individuellement et qui implique d'exercer son métier sans contraintes doctrinale, idéologique ou morale comme la censure institutionnelle. L'autonomie des universités en revanche, concerne davantage les établissements eux-même et renvoie à leur capacité à gérer indépendamment leurs ressources humaines, leurs masses salariales, leurs politiques de formation et de recherche ou encore leur gestion budgétaire.
C'est en terme d'autonomie universitaire que la France semble aujourd'hui davantage à la peine. Une étude conduite au niveau européen en 2023 par l'European University Association (EUA) informe d'une baisse quasi généralisée de la France, par rapport aux chiffres de 2017, sur les 4 critères évalués : organisation, finance, gestion des ressources humaines et autonomie académique :
Comparé à 2017, la France perd des places sur les quatre dimensions de l’autonomie des universités, selon le nouveau tableau de bord de l’EUA, publié le 7 mars 2023. Sur 35 systèmes d’enseignement supérieur examinés, elle se classe ainsi 24e quant à l’autonomie organisationnelle (-4 places), 27e en matière d’autonomie financière, 31e pour la gestion des RH (-4 places) et 32e concernant l’autonomie académique (-5 places). Cependant, le score enregistré par la France progresse de quelques points pour ce qui est de l’autonomie en matière académique (+5 points) et en termes de GRH (+1 point).
Source : Autonomie des universités : la France perd à nouveau des places dans le tableau de bord de l’EUA - aefinfo.
Nous vous suggérons de lire les résultats de l'étude citée en source pour comprendre les critères évalués ainsi que l'ampleur du phénomène décrit. Pour plus d'informations, voici en téléchargement libre l'étude complète au niveau européen : University Autonomy in Europe IV: The Scorecard 2023.
Pour recentrer le propos sur la France et la production de données produites au sein du territoire national, vous pouvez vous appuyer sur cette note très instructive de la Cour des Comptes publiée en 2021 : Les universités à l’horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités (à télécharger). La Cour encourage les décideurs publics à parachever une autonomisation des universités qui se laissent attendre malgré les premières avancées de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de 2007. Elle estime que plusieurs leviers d'action peuvent être mobilisés à l'horizon 2030 afin d'améliorer leur autonomie et libérer ces institutions du contrôle d'un pouvoir encore trop centralisé :
Face à ce constat, les différents travaux produits par la Cour permettent de distinguer trois leviers d’action pouvant être mobilisés dans les dix années à venir. Le premier concerne l’approfondissement de l’autonomie, qui passe par une réforme du dispositif d’allocation des moyens, par l’attribution de latitudes nouvelles pour mener une véritable stratégie de recrutement et de management des ressources humaines, par la reconnaissance d’un statut à part entière d’opérateur de recherche, et par une dévolution généralisée du patrimoine. Le second axe de réflexion conduit à penser l’université comme un véritable lieu de réussite et de vie, et en faire l’unique interlocutrice des étudiants. La troisième piste d’avenir serait d’assumer et de maîtriser les différences entre universités, ce qui ouvrirait la perspective de la création de collèges universitaires.
Source : synthèse de la note de la Cour des Comptes - Les universités à l’horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités (2021).
Au sujet de la perte de sens des enseignants à l'université évoquée par J. Heers et de la place de plus en plus importante consacrée aux tâches administratives, le constat semble être le même, voire continue de se dégrader. Cet article du sociologue Pascal Ughetto documente et retrace assez bien les mutations du métier d'enseignant chercheur et l'éloignement progressif du corps professoral de ce qu'ils estiment constituer le coeur de leur métier : enseigner. Extrait :
Toujours est-il que, à l’UPEM, toutes et tous convergeaient, dans le questionnaire, vers un sentiment de charge administrative excessive. La spécificité de cette université joue son rôle. L’établissement est, selon l’expression consacrée, « sous-doté », c’est-à-dire que, depuis sa création, en 1991, les effectifs d’enseignants-chercheurs ou de BIATSS que le ministère lui accorde n’égalent pas — rapportés au nombre d’étudiants — ceux que l’on observe ailleurs. Il n’est donc pas exceptionnel de voir des témoignages tels que celui de ce jeune maître de conférences qui explique : « Recruté il y a cinq ans, j’ai géré une licence pro dès mon arrivée et j’en ai créé une nouvelle. Et je fais 450 h de cours ! »
Dans le même temps, l’UPEM est également une université en pointe dans les formations en apprentissage, une modalité qui génère un surcroît de travail par rapport aux formations classiques : relation avec les entreprises et les maîtres d’apprentissage, encadrement rapproché des étudiants, relation avec les centres de formation d’apprentis… En outre, dans cette université de taille moyenne, les relations sont moins impersonnelles que dans les grandes structures et les étudiants entretiennent avec les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs des liens de proximité. Cette accessibilité va de pair avec des sollicitations denses et un travail d’accompagnement assez lourd, envers un public qui est souvent composé de jeunes provenant de milieux socio-culturels peu familiers des études universitaires.
Source : La charge de travail administrative va-t-elle faire craquer les enseignants-chercheurs ? - Metis, correspondances européennes du travail.
Si vous parvenez à vous la procurez, nous vous recommanderions aussi la lecture de cet article de Mathieu Uhel et Bruno Mantel : Le travail à l’Université en perte de sens ?. Et dans nos collections la parution récente de cet ouvrage : En quête d'enseignants : regards croisés sur l'attractivité d'un métier / sous la direction de Géraldine Farges et Loïc Szerdahelyi ; préface de Christian Maroy (PUR, 2024).
Bonnes lectures,



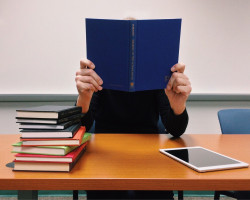
 Le KGB contre l’Ouest.
Le KGB contre l’Ouest.