Est-ce que tout le monde agit en fonction d'une idéologie ?
Question d'origine :
Est-ce que tout le monde a forcément à un moment ou un autre un parti pris, une forme d'idéologie qui lui permet de confronter la vie, le monde et de vivre sa vie dans le monde? Est-ce que tout le monde n'adopte pas quand même une forme d'idéologie qui est quand même assez personnelle et subjective pour lui permettre d'interagir avec la vie et le monde?
Réponse du Guichet
Nous ne sommes pas bien sûrs de vous comprendre... Voici toutefois quelques références sociologique, philosophique et neuroscientifique relatives à la construction de nos opinions, notre appréhension du réel et l'expression de notre subjectivité.
Bonjour,
Ne saisissant pas tout à fait le sens de votre question, nous vous suggérons certaines lectures qui pourraient vous aider à mieux comprendre comment se forment nos opinions, nos avis, bref en somme notre subjectivité :
Avec l'aide des neurosciences, ce livre d'Albert Moukheibert nous apprend que notre cerveau est à l'origine de biais cognitifs inconscients qui façonnent nos points de vue, nos croyances, nos peurs : Votre cerveau vous joue des tours (Allary, 2019) : "Pourquoi croyons-nous souvent avoir raison lorsque nous avons tort ? Pourquoi sommes-nous terrorisés par une toute petite araignée inoffensive ? Pourquoi avons-nous peur de parler en public alors qu'aucun danger ne nous guette ? Pourquoi nous laissons-nous avoir par les infox ? Face à un réel multiple et complexe, nous sommes sujets à l'approximation, à l'illusion et à l'erreur. Ces mécanismes cérébraux nous permettent de construire une vision cohérente du monde. Mais trop souvent ils nous font perdre notre lucidité, nous enferment dans nos a priori et nous détournent des autres. Riche de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences de psychologie sociale, cet essai rend accessibles les dernières découvertes des neurosciences et propose des outils pour faire de notre cerveau notre allié en toutes circonstances." Cette petite conférence offre un bon résumé du livre : Votre cerveau vous joue des tours - Albert Moukheiber - Conférence Tilt Nantes.
Nous recommandons aussi chaudement la lecture de ce livre marquant de l'histoire de la sociologie : La construction sociale de la réalité de Peter Berger et Thomas Luckmann (Armand Colin, 1966, réédition 2018) "Il s’agit pour Peter L. Berger et Thomas Luckmann d’étudier les mécanismes à la fois ordinaires et institutionnels, les représentations quotidiennes qui fondent le réel et sa compréhension, entre « significations subjectives » et « facticités objectives »", comme le décrit ce résumé du livre sur Dygest. "Publié en 1966, ce livre, référence majeure de la réflexion sociologique contemporaine, s'attache à expliquer et faire tenir dans une dialectique commune les dimensions objective et subjective, individuelle et institutionnelle de la société."
Sur la notion de subjectivité en philosophie, cette excellente notice de l'encyclopédie philosophique est idéale pour en appréhender les différentes facettes :
Au sein de l’épistémologie, la notion de subjectivité est principalement mobilisée pour qualifier certaines attitudes épistémiques (telles que les jugements), par contraste avec l’objectivité. Dans ce contexte, le problème soulevé par cette notion est double : il a trait d’une part à la question de savoir en quoi un jugement peut être dit subjectif, et d’autre part au lien entre subjectivité et connaissance. Toute connaissance est-elle objective ? À supposer qu’il existe des jugements irréductiblement subjectifs, peuvent-ils exprimer des propositions vraies ? Existent-ils des faits qui ne peuvent être connus que depuis un point de vue subjectif ?
Source : Millière, Raphaël (2016), «Subjectivité (A)», dans Maxime Kristanek (dir.), l'Encyclopédie philosophique.
Vous pourriez aussi nourrir votre réflexion en parcourant ce manuel universitaire de Claude Dargent, Sociologie des opinions (Armand Collin, 2011) : "L'opinion serait-elle devenue la vox populi des démocraties occidentales actuelles ? À en croire l'omniprésence de la notion et son invocation rituelle dans le champ médiatique et politique, elle semble avoir gagné une vraie légitimité, même si l'on peine à s'accorder sur son statut épistémologique. Les opinions suscitent en effet la controverse. Qu'expriment-elles exactement ? Quel rapport entretiennent-elles avec les comportements - politiques, économiques, sociaux? Comment évaluer leur force ? Qui peut valablement les interpréter ? Avec quelles précautions ? Pour quels usages ? Autant de questions qui en font un objet sociologique de première importance, appréhendé ici par Claude Dargent. Dans un travail d'exégèse, l'auteur revient sur les fondements intellectuels et historiques de l'opinion comme objet de la recherche sociologique."
Bonnes découvertes,



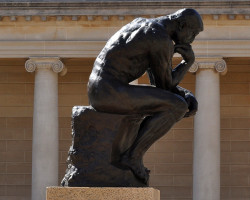
 Zones
Zones