Quel a été le lectorat des Misérables à sa sortie ?
Question d'origine :
Bonjour,
Je cherche à connaitre les type de publics/lecteurs des Misérables à la publication du livre en 1862. Comment a été accueilli l’œuvre à sa publication ? On parle de “succès populaire” et de “sortie événement”, mais à cette époque qu’est ce que cela signifie vraiment ? Est-ce l’œuvre dans sa totalité (les 10 volumes) qui étaient lues ou des versions abrégées existaient-elles déjà ? Finalement le lectorat des Misérables a t-il vraiment évolué depuis sa première édition ?
Réponse du Guichet
À sa sortie en 1862, Les Misérables de Victor Hugo furent un immense succès populaire, touchant un public très large, bien au-delà des frontières françaises. Le roman s'écoula à des dizaines de milliers d'exemplaires en seulement quelques jours, suscitant un engouement dans toutes les classes sociales, y compris chez les lecteurs modestes qui partageaient ou empruntaient les volumes.
Bonjour,
La publication des Misérables en 10 tomes entre les mois d'avril et de juin 1862 semble avoir été l'événement littéraire de l'année. Qu'elle ait été encensée ou critiquée, la grande fresque romanesque de Victor Hugo a fait l'effet d'un pavé dans la mare lors de sa publication. Les revues de presse ou les articles consacrés à sa réception font le récit d'un livre sur toutes les lèvres et lu par tous. Tout est hors norme dans ce nouveau roman, "sa genèse et son écriture au long cours, sa longueur, le battage médiatique et les débats qui l’entourent" écrit Le Monde. Ajoutez à cela que plus de 30 ans se sont écoulés depuis la publication de son dernier roman, Notre Dame de Paris (1831) (comme le rappelle Le Figaro), et que le public est informé que le romancier y a consacré plusieurs décennies ; ce sera "l’œuvre du siècle" (Critique et Politique: La Réception des Misérables en 1862 de Max Bach, 1962), mais aussi que Victor Hugo dispose encore du statut d'écrivain opposé au régime (le Second Empire de Napoléon III) lorsque Les Misérables débarquent en librairie... Et vous avez là les ingrédients qui font de cette sortie un moment hors du commun de l'histoire littéraire du 19ème siècle.
Voici quelques articles et documents sur lesquels prendre appui pour mesurer la popularité et comprendre la réception des Misérables au moment de sa publication :
- La série "Réception d'une œuvre" du Monde lui consacre un épisode : 1862 : « Les Misérables », événement littéraire planétaire (2020)
«Ce livre est d’un grand effet»: parution des Misérables le 3 avril 1862, qui revient sur l'histoire de sa publication et le traitement médiatique du livre par le journal (2017)
Publication des Misérables de Victor Hugo sur France Archives (mise à jour 2023).
Les Misérables, Les essentiels de la BNF (2015).
Les Misérables face à la critique, focus de la BNF sur la réception d'auteurs célèbres du texte de Hugo.
Au sujet de la composition et de la publication des éditions originales du roman : Éclaircissements sur l'édition originale des Misérables de Victor Hugo, sur édition-originale.com (2022).
Nous trouvons parmi ces articles plusieurs informations au sujet de la composition du lectorat des Misérables en 1862.
D'un point de vue géographique, le phénomène n’est pas limité à la France: le roman est publié simultanément dans plusieurs capitales et traduit très rapidement. Il était disponible à sa sortie dans une douzaine de pays, "du Brésil à la Russie" (selon le Monde). C'est un événement planétaire dès la parution du premier volume fin mars début avril, qui pousse les imprimeurs à faire face à la demande spectaculaire (ruptures de stocks) et de batailler contre la diffusion de 5 éditions pirates (Le Monde).
On parle de dizaines de milliers d'exemplaires écoulés pour le premier volume en quelques jours, "cinquante mille" selon cet article paru à l'occasion du centenaire de sa publication en 1962 (« Les Misérables », cent ans de gloire et de gros tirages).
Il faut dire que la presse hugolienne avait préparé les esprits à une telle sortie. Les extraits choisis soigneusement titrés, où Hugo est nommé "l'illustre maître" ou "le maître des maîtres" prédisposent le lectorat à une sortie exceptionnelle (Max Bach, 1962). Et la campagne de lancement, digne des plus grands événements culturels, utilise affiches géantes, extraits dans la presse, et une stratégie de prix abordable pour toucher le plus grand nombre
Et le succès est au rendez-vous. Ainsi Adèle Hugo, la fille de l'écrivain rapporte dans une lettre le 11 mai les faits suivant : « Les Misérables [produisent] dans toutes les classes une émotion sans pareille ; le livre est dans toutes les mains ; les personnages devenus types déjà sont cités à toute occasion et à tout propos. Les images de ces personnages sont à toutes les vitrines des marchands d’estampes ; des affiches monstres annonçant Les Misérables sont placardées à tous les coins de rue. »
Même son de cloche pour Le Figaro qui publie dans ses colonnes dès avril 1862 ces observations, qui rendent compte déjà de la difficulté d'estimer le nombre de lecteur du livre (tout ou partie) mais aussi de la cherté de l'objet : "On ne saurait dire toutes les ruses imaginées par les bons Parisiens pour lire les Misérables sans les acheter. Un cercle d’amis s’est divisé par douze; chacun a mis vingt sols, et on s’est repassé l’ouvrage... Des gens qui payent leur dîner deux louis trouvent que douze francs sont une somme considérable en librairie. On voudrait avoir les romans inédits de Victor Hugo dans les journaux à cinq centimes!» (Le Figaro, «Ce livre est d’un grand effet»: parution des Misérables le 3 avril 1862).
Victor Hugo aurait privilégié une publication morcelée en plusieurs tomes pour mieux combattre la censure et la contrefaçon qu'auraient fait peser une parution au compte goutte dans les journaux ou une publication d'ampleur d'un seul volume (BNF - Les Misérables), bien que l'auteur se soit confié dans une lettre (datée du 7 février) sur l'atténuation de la force du récit qu'engendre une telle partition.
Au sujet de l'objet livre comme symbole du début d'une culture de masse au XIXème siècle, nous vous conseillons la lecture de cet article : Le prix du livre au 19e siècle de Jean-Charles Geslot (La revue de la BNU). Ainsi que le compte rendu de ce colloque des années 1980 : Lectures et lecteurs au XIXe siècle, qui fait écho à ce livre : Le triomphe du livre : une histoire sociologique de la lecture dans la France du 19e siècle / Martyn Lyons ; trad. de l'anglais (Promodis, 1987). Mais aussi cet ouvrage tout récent : Le pouvoir des lectrices : une histoire de la lecture au XIXe siècle / Isabelle Matamoros (CNRS, 2025).
Nous ne résistons pas à l'envie de vous partager cette nouvelle anecdote qui décrit les stratégies mises en place par des personnes aux capitaux économiques et culturels modestes pour découvrir eux aussi ces histoires. Jean-Yves Mollier, dans un article publié en 2019 dans la revue La Pensée évoque la diffusion des grandes histoires françaises, jusqu'à Cuba et donne d'autres explications justifiant l'immense popularité du roman et de son auteur. Une baisse des couts d'emprunt et de nombreuses lectures "sauvages" du livre expliquent, au-delà des tirages, sa renommée :
Ainsi le nom donné à l’un des meilleurs cigares cubains, le « Montecristo », s’éclaire-t-il si l’on sait que les ouvriers des manufactures de cette île payaient l’un des leurs pour lire le roman éponyme pendant qu’ils roulaient les feuilles de tabac. Sans qu’il y ait de lien direct, on peut relier cette pratique culturelle avec une autre, plus politique, qui permit à de nombreux ouvriers parisiens de lire Les Misérables dès leur mise en vente, en 1862, alors que les dix tomes coûtaient 60 F – quinze ou vingt jours de travail –, une somme évidemment hors de leur portée. Le témoignage du commissaire de la Librairie chargé d’enquêter sur la diffusion de ce roman qu’il qualifiait de « socialiste » permet de comprendre pourquoi la baisse soudaine de la location à la journée de 1 F à 0,25 F de chaque volume emprunté au cabinet de lecture avait multiplié le nombre de lecteurs. Adèle Hugo ajoutait que d’autres prolétaires formaient des sortes de tontines pour acheter à plusieurs les volumes au fur et à mesure de leur parution et tiraient au sort l’ordre de lecture, le dernier lecteur conservant pour lui les précieux volumes. Manifestement, ces lectures « sauvages » ont contribué à la « gloire » de Victor Hugo et expliquent que son enterrement ait été suivi par près de deux millions de personnes en juin 1885, transformant un hommage de la nation en plus gigantesque manifestation que la ville ait jamais connue.
Source : Mollier, J.-Y. (2019). Livre et société. La Pensée, 397(1), 117-12
Bonne journée,



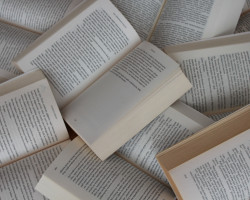
 Voyage voyage
Voyage voyage