Qui a écrit le conte intitulé "Mon mari sait ce qu'il fait" ?
Question d'origine :
bonjour à toute l'équipe et bien merci par avance,
pouvez-vous me dire de quel auteur provient ce conte intitulé "Mon mari sait ce qu'il fait" et dont voici les premières lignes :
« Il était une fois un pauvre homme. Un beau jour il dit à sa femme : ma chère femme, je vais à la foire pour vendre notre cheval. D’accord, fais comme tu veux. En route pour la foire il rencontra un homme qui emmenait une vache. Je veux vendre cette vache, pour le prix que j’en aurais j’achèterais un cheval dit l’homme. Dans ces cas-là, faisons un échange. Bon d’accord, j’accepte. Ma femme n’arrête pas de me dire que ce serait bien d’avoir un peu de lait à la maison.
Sur la route notre homme vit un mouton qu’un homme menait au bout d’une corde. Il dit à l’homme : ma femme me dit toujours que si nous avions un mouton nous aurions de la bonne laine, nous devrions faire un échange. Un peu plus loin, il vit un homme avec une oie. Ma femme me dit toujours que ce serait bien d’avoir une oie, elle donnerait des plumes et nous aurions des petites oies, faisons un échange. Ainsi fut fait. Il continua son chemin vers la ville et avant d’y arriver il vit un homme qui avait une poule noire et blanche. Ma femme me dit souvent que les poules noires et blanches sont les meilleures pondeuses. Alors il proposa l’échange à l’homme.
...
Réponse du Guichet
Cette petite histoire nous rappelle le conte « Hans im Glück » popularisé par les frères Grimm, où le héros, naïf mais heureux se déleste peu à peu de ses biens sans jamais perdre son optimisme. Ce récit, qui connait de nombreuses adaptations en Europe illustre le paradoxe d’un bonheur trouvé dans la simplicité et l’absence de possession. Selon Corona Schmiel, ce récit est singulier car il inverse le schéma classique du conte merveilleux.
Bonjour,
Cette histoire de troc ressemble comme à s'y méprendre à une version simplifiée du conte popularisé par les frères Grimm, Hans im Glück (ATU 1415) (ou Jean le Chanceux, Jean la Chance en français), dans leur recueil Contes de l'enfance et du foyer (1819).
Ce conte aborde le thème de la naïveté, Jean est persuadé à chaque rencontre de faire de bonnes affaires, mais aussi celui de la simplicité. Malgré des biens qui se réduisent considérablement, Jean reste optimiste et heureux même après avoir égaré la pierre à aiguiser, le dernier objet qui lui restait de toutes ces tractations.
De nombreuses adaptations de ce récit semblent s'être déversées un peu partout en Europe. Corona Schmiel dans son article « “J’ai mis mon bonheur dans rien” » publié dans Masques et métamorphoses de l’auteur dans les contes de Grimm (Presses universitaires de Caen, 2015) évoque ces nombreuses traductions dès l'introduction :
Par sa simplicité mythique, ce petit récit anodin de « Hans im Glück » a fait rêver et en a inspiré d’autres. Notamment, à travers Andersen et son Lykke-Per, le roman du danois Pontoppidan, Hans im Glück – Pierre le Chanceux, assorti d’une interprétation par Georg Lukács ; jusqu’au jeune Brecht et à sa pièce fragmentaire du même nom.
Wikipédia mentionne également une version de Adelbert von Chamisso et Ludwig Bechstein.
Nous vous laissons avec cette analyse très intéressante de Corona Schmiel, qui évoque le contresens narratif employé par ce conte et qui en caractérise toute l'originalité :
Hans nous touche par le paradoxe de son existence : le bonheur, il l’a, comme un capital inentamable, mais il ne le trouve nulle part (à chaque étape, ce n’est pas cela, il est déçu).
Il nous touche, ou plus précisément, il nous fait respirer, parce qu’il cherche à se débarrasser de tout ce qui pèse, à devenir nu comme un nouveau-né.
Tout cela, seule la version Grimm peut nous le suggérer, la source reste terne à côté, une pure farce sur un sot qui n’inspire que la joie mauvaise du malheur des autres.
Le récit fait rêver parce qu’il illustre peut-être une « idée première de l’humanité ». L’histoire, bien que dérivée d’une farce, est merveilleuse, sans que rien en elle ne relève du merveilleux. Bien que solidement ancrée dans la réalité, elle l’est, justement, parce qu’elle inverse le schéma proppien du conte merveilleux, où le héros part en quête de la réparation d’un manque initial. Ici, au contraire, il retourne chez lui et le manque « objectif », matériel, se trouve à la fin. Le cas est rare, sinon unique dans les khm.
Source : Corona Schmiel dans son article «“J’ai mis mon bonheur dans rien”» publié dans Masques et métamorphoses de l’auteur dans les contes de Grimm (Presses universitaires de Caen, 2015).
Bonne journée,



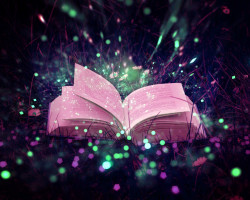
 Chair
Chair