Je cherche des informations sur le formalisme juridique des exhumations en 1812.
Question d'origine :
Bonjour,
A propos d'un décès survenu en 1812, je cherche des informations sur le formalisme juridique des exhumations (rôle et/ou ordre d'intervention des diférentes autorités habilitées).
Dans le cas qui m'intéresse, ce décès n'ayant pas été regardé comme suspect par le maire, c'est seulement à cause de la rumeur publique que la justice s'est mise en route.
Réponse du Guichet
Les exhumations sont implicitement autorisées dans certains cas en 1812 mais nos recherches n’aboutissent pas à un grand degré de précisions sur leurs modalités juridiques.
Définie par Régis Bertrand dans Des morts qui dérogent : à l’écart des normes funéraires, XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Provence, 2023) comme le fait de remettre au jour un cadavre enseveli, l’exhumation est en France une pratique courante, sinon quotidienne, qui est particulièrement discrète et dont les traces écrites sont tout aussi discrètes.
L’exhumation est aujourd’hui réglée par le Code général des collectivités territoriales (art. R. 2223-20, R. 2213-40 s.) : le maire de la commune du lieu de l’exhumation (à Paris, le préfet de police) doit s’assurer, en cas d’exhumation judiciaire de la qualité du plus proche parent de celui qui en fait la demande. (Petit lexique du droit funéraire, Ariane Gailliard, Lefebvre Dalloz, 2024, p. 102).
Régis Bertrand expose dans le livre déjà cité comment l’exhumation est appréhendée dans l’aire chrétienne, loin de l’image réductrice de la violation de sépulture.
L’exhumation est en fait usuellement pratiquée depuis des siècles dans l’aire chrétienne. A noter que le christianisme est le seul monothéisme à accepter une telle extension de principe de l’exhumation. Il explique plus loin (p. 180 et suiv.) que le droit romain instaure l’inhumation comme un acte définitif qui conditionne la paix du mort et celle des vivants, qui transforme le statut juridique du terrain où elle est faite qui devient locus relgiosus (lieu voué aux mânes). L’exhumation est interdite par le droit romain sauf absolue nécessite car elle fait perdre au lieu de sépulture son statut religieux et le rend à l’état profane: c’est une profanation.
La violation de sépulture représente alors un crime contre la religion, un trouble à l’ordre social car elle nuit aux rapports entre les vivants et les morts, et elle porte atteinte aux droits d’un particulier, l’héritier du tombeau qui en a le jus sepulcri.
Le texte qui fonde la doctrine chrétienne de la sépulture est le De curapro mortuis gerenda (sur le soin que l’on doit avoir pour les morts) de saint Augustin et Régis Bertrand expose que par interprétation large des principes définis par Augustin, la sphère catholique occidentale a admis sous l’Ancien Régime puis à l’époque contemporaine le principe de l’exhumation à condition, du moins en France, qu’elle ait à la fois l’aval de l’autorité en charge de la police du cimetière où elle va avoir lieu et l’autorisation de l’ordinaire du lieu (soit l’évêque ou le supérieur majeur pour les religieux exempts de l’autorité de l’ordinaire). En théorie le cadavre doit être identifié de façon certaine.
Il ajoute que l’Eglise avait prescrit l’exhumation selon deux cas :
- La cause en béatification qui comprend l’examen de la dépouille d’un «serviteur de Dieu» (toujours en vigueur à ce jour)
- Le placement d’un excommunié en un lieu profane (n’est plus prescrit depuis le Code de 1983)
Dans les faits, au cours du Moyen Âge, l’exhumation est devenue dans l’aire chrétienne un principe de régulation de lieux de sépultures.
A la fin de l’Ancien Régime, lorsqu’un grand mouvement hygiéniste conduit à l’interdiction des sépultures dans les églises et au transfert des cimetières hors des enceintes, l’exhumation est à ce point entrée dans la conception du cimetière occidental que nombre de législations funéraires, loin de la remettre en cause, en font la règle du nouveau cimetière.
En 1812, c’est le décret sur les sépultures du 23 prairial an XII (12 juin 1804) qui fixe dans les grandes lignes la législation française post-révolutionnaire.
Dans son ouvrage, Régis Bertrand remarque que le mot «exhumation» n’y est employé qu’une seule fois (p.184).
Art. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
Régis Bertrand souligne que les «exhumations non autorisées» impliquent que d’autres le soient. Dans le même décret, l’exhumation est implicite dans l’article qui organise la rotation quinquennale des espaces d’inhumation du cimetière :
Article 6. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années, en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des mots qui peuvent y être enterrés chaque année.
Malheureusement pour votre recherche, aucun texte législatif ou règlementaire ne précise les modalités de l’exhumation.
En revanche, pour déterminer les cas autorisés d’exhumation, Régis Bertrand nous renvoie au Manuel pratique de droit civil ecclésiastique […] d’Alfred Campion (1876,qui précise: qu’«en principe, les exhumations sont défendues […]. Mais il peut être dérogé à cette règle » […]. Dans les trois cas explicites d’exhumation énumérés par Campion, l’identité et l’intégrité du cadavre étaient respectées par une réinhumation. De plus, ces opérations relevaient du monopole des pompes funèbres qu’ont eu de 1804 à 1904 les fabriques catholiques et les consistoires protestants et juifs qui en percevaient les frais et taxes.
Parmi les trois cas relevés, nous notons :
- l’examen médico-légal des restes, en vertu d’un ordre de justice, pour rechercher les causes de la mort d’un individu».[…]
- La normalisation d’inhumations non-conformes à la règlementation: «par mesure d’administration, quand l’inhumation a eu lieu lors des endroits réservés aux sépultures et sans qu’aucune autorisation préalable ait été accordée ou lorsque les prescriptions concernant le dépôt du corps n’ont pas été observées et que la santé publique pet se trouver compromise». Soit les cas d’inhumation clandestine (de victimes d’assassinats par exemple), ou bien improvisées par impossibilité de transporter le corps hors du lieu de décès.
- Le troisième, déjà rencontré sous l’Ancien Régime est l’attribution d’une sépulture privilégiée : «sur la demande des familles, pour donner aux corps une sépulture qu’elles jugent plus convenable».
(Campion, 1876, op. cit, p. 522)
Au regard des informations sur le monopole des pompes funèbres des fabriques ou consistoires, nous pouvons supposer que les modalités d’exhumation devaient leur laisser un rôle important dans l’organisation de l’opération.
B. Gaubert dans son Traité théorique et pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence sur le monopole des inhumations et des pompes funèbres […] (Marseille, M. Lebon, 1875, t. II, p. 214) décrit une contestation courante du monopole des fabriques sur les exhumations et précise que dans un grand nombre de localités, l’indifférence des fabriques et des autorités municipales ont laissé tomber l’exercice de ce droit dans le domaine public. […] Mais la jurisprudence est fixée aujourd’hui. Bien que les décrets organiques du 23 prairial an XII et 18 mai 1806 ne désignent pas expressément les exhumations et réinhumations des corps, parmi les objets des pompes funèbres réservés aux fabriques et consistoires, il est admis et jugé qu’on ne saurait les détacher du monopole.[…] Les fabriques ont donc qualité pour demander à l’autorité municipale de faire figurer, dans le tarif des fournitures dont l’élaboration lui appartient, tout ce qui se rattache aux exhumations, réinhumation et transport des corps. Ordinairement, on distingue, dans ces sortes d’opérations, 1e l’exhumation proprement dite, c’est-à-dire, le déplacement du corps d’un endroit dans un autre et 2e les fournitures que nécessite ce déplacement. L’exhumation seule donne lieu à la perception d’un droit fixe, qui varie suivant l’âge ou l’état du corps des défunts. Quant aux fournitures, elles sont déterminées, soit par les règlements de police qui régissent les exhumations et les transports de corps, en dehors de la commune, soit par les familles.
Le texte donne des exemples de fournitures : les cercueils en plomb ou en chêne ayant les épaisseurs règlementaires, les désinfectants qui doivent y être enfermés et les cercles en fer et à écrou qui les consolident […] les corbillards, porteurs,[…]. Et les tarifs des travaux pour les exhumations sont évalués selon les situations: enfant, adulte, caveau de famille, etc (p. 414).
Le livre déjà cité d’Alfred Campion évoque la délivrance des permis d’exhumation, l’assistance des commissaires de police et de leurs honoraires exposés p. 522 et suivantes mais nous n’avons pas trouvé de description détaillée sur l’exhumation.
Dans son article L’art d’improviser: La pratique des autopsies médico-légales au XIXème siècle (Histoire des sciences médicales – Tome XLVI – n° 2 – 2012 p. 151), Sandra Menenteau écrit qu’à partir du début du XIXème siècle, les missions expertales peuvent être confiées à n’importe quel professionnel de la médecine […]. Elle explique que la Révolution française ayant mis fin au système des offices, celui de médecin ou de chirurgien-juré disparaît […]. En vertu de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803), tous les titulaires du doctorat en médecine ou en chirurgie peuvent être sollicités par l’institution judiciaire (article 27). […] A l’inverse de la loi de ventôse, les textes juridiques ne réservent pas l’exclusivité des expertises médico-légales aux titulaires du doctorat. Le Code d’instruction criminelle, texte de référence pour les procédures judiciaires en matière de crimes et de délits, préconise au procureur de la République de se faire «assister d’un ou de deux officiers de santé» (article 44).
Ce même article précise que les campagnes et petits villages restent le domaine d’exercice des officiers de santé, quand les villes constituent celui des docteurs.
La lecture de l’intégralité de cet article de 12 pages vous permettra d’appréhender les problématiques liées aux conditions dans lesquelles s’effectuaient les autopsies à cette période.
Bonne chance dans la suite de vos recherches



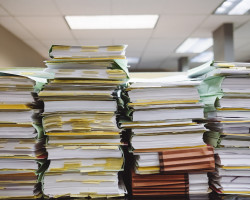
 Vichy et la justice
Vichy et la justice