Question d'origine :
Y-a-t-il des épisodes historiques et des vérités qui sont ignorés, dont nous ne parlons pas? Pourquoi certaines vérités sont elles passées sous silence?
Réponse du Guichet
Outre quelques considérations générales sur le rapport entre vérité et histoire, vous trouverez quelques pistes non exhaustives sur les raisons diverses pour lesquelles certains faits historiques sont parfois ignorés, occultés ou délibérément dissimulés (qui écrit l'histoire ?, secret d’État, accès aux archives...)
Bonjour,
Si nous avons bien compris votre question, vous vous demandez pourquoi la vérité sur certains épisodes historiques est ignorée ou passée sous silence. Voici quelques pistes de réponse, loin d’être exhaustives, étant donné l’ampleur du sujet.
Il faut tout d’abord rappeler que la vérité historique est une notion complexe, au cœur du métier d’historien. Comme la vérité au sens plus large, la vérité historique n’est jamais absolue, elle est toujours incomplète et en évolution, car soumise à l’irréductibilité des multiples points de vue, mais aussi contrainte par l’impossibilité de réduire le temps dans sa durée. Autrement dit une vérité historique ne peut pas être a-temporelle, elle est inscrite dans un présent qui porte un discours sur un passé. Ainsi, le discours historique est en évolution permanente et ce qui est ignoré un jour pourra être dévoilé le lendemain.
Quelles sont alors les raisons pour lesquelles certains faits sont parfois ignorés ?
Dans la continuité de ce qui a été dit plus haut, notre connaissance sur les faits historiques se base sur les écrits et travaux réalisés au fil du temps, et le point de vue sur cette histoire dépend de la position de celui qui la raconte. Or l’histoire a souvent été écrite par les dominants. Nous préférons ici la notion de dominants, plus large que celle de vainqueurs. En effet, c’est Robert Brasillach, homme de lettre et collaborationniste, qui avait déclaré « l’histoire est écrite par les vainqueurs ». Or si l’acceptation s’est avérée juste à certaines époques, comme dans l’antiquité romaine où la damnatio memoriae visait à condamner à l’oubli, elle fut aussi utilisée pour re-légitimer des vaincus, pour leur donner une position de victimes ou de martyrs, devenant parfois à leur tour les acteurs du récit dominant. Ainsi de Vercingétorix, le vaincu qui est devenu par la suite le héros mythique du roman national français, occultant lui-même des pans entiers de l’histoire de France.
De nombreux courants de l’histoire ont tenté de décentrer cette histoire écrite par les dominants, mettant au jour d’autres évènements, d’autres figures, souvent oubliés ou occultés. Le plus célèbre des historiens dans cette voie, est peut-être Howard Zinn avec son œuvre Une histoire populaire des Etats-Unis, déclarant " Tant que les lapins n’auront pas d’historien, l’histoire sera racontée par les chasseurs ". Avant lui, Nathan Wachtel avait écrit en 1971 La vision des vaincus à propos des indiens du Pérou dont l’histoire n’était racontée que par les Conquistadors. Depuis, les subalterns studies et d’autres courants historiographiques comme l’histoire globale… se sont attelés à diversifier les points de vue sur l’histoire et sortir ainsi de l’oubli et du silence, les « invisibles », leurs existences et leurs actions, qu’il s’agisse des femmes, des colonisés, des noirs… Source : La mécanique de l’histoire, chapitre « L’histoire est écrite par les vainqueurs ».
Le fait de « passer sous silence » un fait historique peut aussi relever d’une volonté délibérée d’un pouvoir pour effacer ses responsabilités. « Et lorsqu'un État dissimule activement ou pervertit délibérément des informations sur les violations flagrantes des droits de l'homme - des crimes tellement odieux, tellement graves et tellement dévastateurs qu'ils érodent « la dignité et la valeur de la personne humaine » - les conflits sur la vérité, et pour la vérité, deviennent particulièrement poignants.» dans Les commissions « vérité et réconciliation » : une nouvelle approche de la vérité. On peut citer à cet égard la question du rôle de la France dans l’extermination des juifs et les crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde guerre mondiale. On sait que la France a mis de longues années avant de reconnaître sa responsabilité notamment dans la rafle du Vel d’Hiv en 1942 et qu’il a fallu attendre le discours de Jacques Chirac en 1995 (dont on célèbre les 30 ans) pour que cela devienne officiel. Il existe de nombreux autres exemples du même ordre, à propos de la conquête et de la Guerre d’Algérie (qui fait débat actuellement), du rôle de la France dans le génocide du Rwanda, mais aussi dans d’autres pays, comme la reconnaissance du génocide des arméniens en Turquie, la longue négation par l’URSS de la grande famine en Ukraine en 1932-33, ou encore le rôle du gouvernement dans l’assassinat de Martin Luther King aux Etats-Unis…
Récemment, nous avons acheté ces deux ouvrages qui chacun sur des sujets différents (l'un sur les zones d’ombre de la vie d’Henri IV, l’autre sur les crimes commis par les français engagés volontaires dans la Wehrmacht) illustre cette occultation de certains faits et le travail des historiens et des témoins pour, comme l’un des résumés le dit, « établir une autre vérité » : Le fils secret du Vert-Galant / Robert Muchembled et Un père ordinaire : sur les traces d'Alfred Douroux, de la LVF et de la Waffen SS : récit / Philippe Douroux.
La forme la plus précise de cette volonté de dissimuler certaines informations est certainement le secret d’Etat (et ses services secrets) dans le but de protéger la sécurité et les intérêts de celui-ci. Voir ces deux ouvrages récents : Vie et mort du secret d'État : du secret du roi à Wikileaks / Antoine Lefébure et État secret, état clandestin : essai sur la transparence démocratique / Sébastien-Yves Laurent. Ecouter le podcast Secrets de La fabrique de l’histoire
Enfin, il faut rappeler que l’histoire, plus que par les vainqueurs, s’écrit par les historiens, et que si les vérités de l’histoire sont relatives et partielles, cela ne veut pas dire qu’il est impossible d’établir des faits et un savoir vérifié. Et c’est tout le travail des historiens aujourd’hui. Comme le dit Antoine Prost dans Douze leçons sur l’histoire, « L’histoire dit vrai : mais ses vérités ne sont pas absolues ». Pour résumer son propos, le travail de l’historien repose notamment sur l’impartialité (plus que l’objectivité), assise sur une méthode rigoureuse appliquée à des sources identifiées. « Le souci des faits en histoire est celui même de l’administration de la preuve, et il est indissociable de la référence ». Ainsi, le savoir historique dépend aussi des sources mises à disposition de l’historien, et l’on sait comment cet accès ou non aux documents peut être un frein au travail historique et ainsi à l’élargissement des connaissances. « Cette impossibilité d’accéder à des archives publiques récentes, qui relève des normes d’un Etat démocratique et qui est aussi une protection accordée au citoyen, nourrit sur cette faillite collective face à un génocide le soupçon d’une entreprise de verrouillage de la vérité. » citation de Vincent Duclert (avril 2019) à propos du génocide au Rwanda.
Voir aussi : De l’IGI 1300 à la loi PATR, ou comment restreindre l’accès aux archives publiques
Au delà de ces occultations ou dissimulations liées à différents facteurs, il est toujours de mise de garder son esprit critique, car il existe des auteurs ou éditeurs qui se plaisent à surfer sur la vague de la post-vérité, pour annoncer avec des titres accrocheurs qu’ils dévoilent des "vérités cachées". Si le contenu se base parfois sur des travaux bien réels (mais rarement cités), leurs ouvrages n’en alimentent pas moins l’idée trop répandue qu’un « ON » indéfini voudrait nous cacher des « VERITES » assez peu vérifiées. « Là où le complotiste flatte l’égo, l’historien peut, quant à lui, revêtir ce rôle ingrat de la mise en face de la vérité. Dans cette lutte permanente entre vérité et post-vérité, l’historien doit faire preuve d’humilité dans son combat contre le complotisme et arguer du fait qu’il ne détient pas la vérité, mais une vérité : celle de l’archive, préalable à la preuve, plus convaincante que l’indice, relevant davantage de la supposition que de la validation scientifique. » Source : La mécanique de l’histoire
Concernant cette question de la post-vérité et du complot, nous vous renvoyons vers cette réponse précédente : Comment distinguer la vérité alternative du simple mensonge ?
Voir aussi :
Est-ce que cette citation sur la vérité est correcte ?
Est-ce que l'on peut penser que finalement il n'y a pas de grande vérité ?
Vérités, histoires, réalités [article] / Enrico Castelli Gattinara



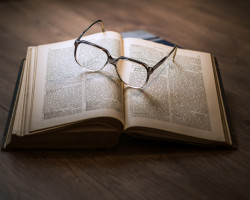
 Estime de soi et fin du monde
Estime de soi et fin du monde