L'éthique et la morale sont-elles aussi sujettes à débats et désaccords philosophiques ?
Question d'origine :
Je croyais parfois qu'il y avait une morale, une éthique où tout le monde pourrait être d'accord, une morale et une éthique qui seraient une vérité sûre...mais apparemment il y a toujours des debats, des discussions sur la morale, l'éthique...tout le monde n'est jamais d'accord...même les philosophes ne sont jamais d'accord...alors on ne sera jamais d'accord sur la morale, l'éthique, il y aura toujours des debats, des discussions, des différences d'opinions sur la morale, l'éthique?
Réponse du Guichet
Quand les Anciens s’appuyaient sur l’ordre du cosmos pour bâtir une éthique des vertus, puis les chrétiens sur les Évangiles, Kant propose une éthique du devoir fondée sur le principe de l'action vertueuse comme fondement du jugement moral universel.
Par opposition, le relativisme moral nietzchien, en affirmant que les valeurs ne valent pas dans l'absolu mais relativement à un contexte, donne l'occasion aux hommes d’affirmer leur propre éthique. Des philosophes contemporains comme Steven Lukes tentent de concilier universalisme et relativisme moral.
Bonjour,
Vous vous interrogez sur les désaccords philosophiques concernant la morale et l'éthique.
Le site de Philosophie Magazine définit la morale comme une discipline normative et la distingue de l'éthique, bien que ces deux notions soient originellement équivalentes. Dans la terminologie contemporaine, la morale serait davantage le fruit de l’éducation subie tandis que l'éthique serait construite par la raison.
Discipline pratique qui dit ce qui est bien ou mal en matière de conduite. La morale est en général prescriptive (elle oblige, recommande ou interdit) et normative (elle inspire nos jugements de valeurs en proposant des règles ou des maximes de conduite). Bien qu’originellement équivalentes, la philosophie a différencié progressivement la morale et l’éthique en leur conférant une connotation presque opposée : la morale, souvent confondue avec le moralisme, a de plus en plus été jugée négativement (tout particulièrement chez Nietzsche), tandis que l’éthique, davantage présentée comme une science, a eu tendance à être valorisée. La morale serait davantage le fruit de l’éducation subie alors que l’éthique serait construite par la raison. Loin d’être d’abord une science philosophique des devoirs, la morale se présente donc à nous comme une existence caractérisée par l’immanence des normes. Comment ces normes peuvent-elles être retournées contre les mœurs dont elles sont pourtant issues ? C’est là le problème central de la philosophie morale : trouver les fondements sur lesquels reposent les normes qui guident nos jugements moraux. Existe-t-il des devoirs inconditionnels, ou bien n’y a-t-il que des obligations relatives ? Si le relativisme moral pose des problèmes redoutables (Pascal disait : « Vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà », Pensées, 294) puisqu’il fait dépendre la valeur des choix moraux des temps et des lieux, l’universalisme moral n’a rien d’évident. En effet, pour qu’un jugement moral fasse l’unanimité, il faudrait soit qu’il puisse être formulé dans un langage universel – or il n’y a pas de mathématique morale (mais il y a des logiques déontiques) ; soit qu’il puisse être éprouvé par tous – or il est difficile de soutenir l’existence d’un sentiment moral unanimement partagé (c’est là l’une des critiques majeures de Kant contre Rousseau). D’où l’idée que certains dilemmes moraux sont insolubles. Est-ce à dire que nous sommes entrés dans l’ère du scepticisme moral ? Ce serait oublier que s’il existe une morale descriptive, la morale demeure une discipline pratique qui demande de choisir et d’agir…
Source : La morale (Philosophie magazine)
Cette définition pose des questions intéressantes rejoignant vos propres questionnements : existe t-il un universalisme moral unanimement partagé et quel est son fondement ? La valeur de nos choix moraux ne dépend-elle pas des temps, des lieux et des sociétés ? Certains dilemmes moraux sont-ils donc condamnés à être insolubles ?
Existe t-il un universalisme moral unanimement partagé et quel est son fondement ?
Le fondement du jugement moral universel réside dans la raison pratique et l'action vertueuse selon Kant. Le philosophe allemand, considéré comme l'un des philosophes majeurs du siècle des lumières, a repris l’idée de l’universalité de la moralité dans la pensée de Rousseau mais contrairement à ce dernier qui associe la morale à la conscience, Kant introduit la notion de raison pratique. Pour Kant, la raison sert de socle à la morale, puisque qu’il me suffit de m’appliquer les règles universelles à mon action afin qu’elle soit morale. C’est le sens de son fameux précepte : « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle ».
Comment fonder une morale si Dieu n’est plus un absolu, mais seulement un postulat de la raison ? Quand les Anciens s’appuyaient sur l’ordre du cosmos pour bâtir une éthique des vertus, puis les chrétiens sur les Évangiles, Kant propose une éthique du devoir, soit déontologique, fondée sur un principe aussi simple qu’intransigeant : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. » Cet impératif catégorique du devoir est énoncé dans "les Fondements de la métaphysique des mœurs" (1785). Contrairement aux formes précédentes d’éthique, qui cherchent à définir un contenu – agir moralement, c’est, par exemple, faire preuve de courage ou tendre l’autre joue –, Kant se concentre sur la forme de l’action vertueuse.
Source : Sous les lumières de Kant, par Victorine de Oliveira, publié le 27 mai 2019 (Philosophie magazine)
La valeur de nos choix moraux ne dépend-elle pas des temps, des lieux et des sociétés ?
Le relativisme moral ou relativisme éthique est la doctrine philosophique qui consiste à considérer que les valeurs morales ne peuvent être évaluées objectivement, contrairement à l'idée d'universalisme morale défendue par Kant. Cette position, affirmant que ce qui est considéré comme bon ou mauvais dépend des normes, des valeurs et des croyances, est notamment soutenue par Nietzsche qui distingue pour autant deux types de nihilisme, un nihilisme passif incarné par Schopenhauer et un nihilisme actif dont il est partisan. Nietzsche célèbre la "Volonté de Puissance" grâce à laquelle l’homme exprime son talent pour inventer ses propres valeurs sans avoir besoin de croire à des religions ou des visions idéalistes du monde.
Être relativiste, c’est penser que les valeurs sont relatives à un lieu, à un temps, à un corps, qu’elles ne valent pas dans l’absolu, mais relativement à un contexte, à une histoire… Être relativiste, c’est penser que les valeurs ont une origine, et non un fondement. Nietzsche, par exemple, est relativiste lorsqu’il montre que les valeurs chrétiennes ne sont pas fondées en Dieu mais viennent d’une histoire au cours de laquelle les chrétiens ont su les imposer aux autres. En faisant la « généalogie de la morale » (chrétienne), il montre qu’elle a une histoire, une origine historique, et qu’elle ne vaut donc pas dans l’absolu. Nietzsche est encore relativiste lorsqu’il écrit qu’« il n’y a pas de vérité, il n’y a que des perspectives sur la vérité ». Mais cela ne veut surtout pas dire que toutes les perspectives se valent. [...]
C’est probablement l’essentiel de la philosophie nietzschéenne : puisqu’il n’y a pas de fondement ultime aux valeurs, c’est à nous de leur donner leur valeur, de l’inventer même. Dans un monde sans Dieu, sans fondement ultime, c’est à nous qu’il appartient de donner leur sens aux choses. C’est moins pour l’absolu qu’il faut se battre, que pour ce qui, justement, dépend de notre combat pour exister – ainsi parlait le relativiste.
Source : Le “nihilisme” chez Nietzsche, c’est quoi ? par Nicolas Tenaillon, publié le 15 mai 2025 (Philosophie magazine)
Certains dilemmes moraux sont-ils donc condamnés à être insolubles, sujets à débats permanents ?
Le nihilisme actif nietzchien, en affirmant que les valeurs morales ne valent pas dans l'absolu mais relativement à un contexte, donne l'occasion aux hommes d’affirmer leur propre éthique. Longtemps limitée par les cadres nationaux, cette préoccupation s'est affirmée sur le plan international lorsque, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a voté, sous le titre de Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte proclamant les principes dont devrait s'inspirer la politique de tous les États et qui commanderaient également l'action des organes de la communauté internationale.
Ayant valeur de simple recommandation, cette déclaration de principes représente un « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». Cependant, l'absence de force juridique contraignante ne saurait minimiser son exceptionnelle portée historique et politique : la Déclaration de 1948 peut être considérée comme l'une des sources d'inspiration d'un grand nombre de règles juridiques internationales mais aussi nationales. C'est ainsi que la Constitution espagnole précise que les normes relatives aux droits fondamentaux doivent être interprétées à sa lumière.
Source : Encyclopédie Universalis
Les notions d'universalisme moral et de relativisme moral sont débattues grandement encore aujourd'hui.
Pour le pape émérite Benoît XVI et un certain nombre de philosophes qui ne sont pas particulièrement religieux, le relativisme moral est une aberration intellectuelle aux effets pratiques désastreux. Il ruinerait nos capacités à justifier le rejet de l’excision, de l’obligation faite aux veuves de se faire brûler vives à la mort de leur époux, du sacrifice humain, de l’inceste, du cannibalisme et d’autres pratiques humaines qu’une bonne partie de l’humanité a fini par juger répugnantes. [...]
Pour d’autres penseurs, ce n’est pas le relativisme moral qui est une aberration. C’est son contraire, l’universalisme. Il serait le masque de l’impérialisme culturel des puissances occidentales. Ces dernières agiteraient une conception des droits de l’homme fondée sur les valeurs de l’individualisme et du libéralisme. [...]
Source : Le Relativisme moral par Ruwen Ogien, publié le 26 mars 2015 sur Philosophie magazine
Dans "Le Relativisme moral", traduit aux éditions Markus Haller, Steven Lukes choisit la voie de la conciliation entre universalisme moral et relativisme moral :
L’idée est qu’il existe plusieurs modes de vie profondément différents qui ont de la valeur aux yeux des gens (la part relativiste de l’argument). Mais pour être moralement acceptables, aucun ne doit contredire certains principes qu’il n’est pas raisonnable de rejeter, ou porter atteinte aux conditions de toute vie humaine décente (la part universaliste).
Source : Le Relativisme moral par Ruwen Ogien, publié le 26 mars 2015 sur Philosophie magazine
Nous vous invitons enfin à consulter notre réponse à la question du Guichet du savoir Pourrait-il y avoir sans cesse des discussions, des débats sur tout ?
Pour approfondir la réflexion
Ressources numériques :
Le relativisme : une excuse pour ne pas penser; par Clara Degiovanni, publié le 08 octobre 2021 sur Philosophie Magazine
L'éthique, par Paul Ricœur (article de l'Encyclopédie Universalis)
Podcasts Radio France sur l'éthique
Des livres consultables à la BmL :
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale [Livre] / sous la dir. de Monique Canto-Sperber, 2004
La philosophie morale [Livre] / Monique Canto-Sperber, Ruwen Ogien, 2017
Calcul moral [Livre] : comment raisonner en éthique / Jean-Pierre Cléro, 2011
Introduction à la philosophie morale [Livre] / Gérard Malkassian, 2015
Belle journée à vous,



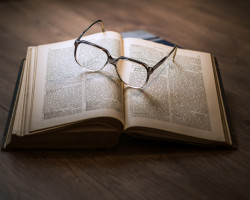
 Zones
Zones