Comment les cimetières sont-ils organisés de manière mathématique ?
Question d'origine :
Bonjour, actuellement élève en terminal, je fais mon grand oral (de spé maths) sur les cimetières et comment ils sont organisés de manière mathématique. Seulement, il y a très peu d'informations à ce sujet sur internet, c'est pourquoi je fais appel à vous.
Merci d'avance, cordialement, Célia J.
Réponse du Guichet
Si les cimetières sont organisés, et ils le sont, les mathématiques ne semblent pas y tenir une grande place… hors quelques célébrités.
Bonjour,
Le cimetière, selon wikipédia :
[…] désigne tout terrain public et sacré où, après une cérémonie, l’on enterre les morts d'un même groupe humain dans des tombes individuelles ou lignagères où leur souvenir est généralement signalé par un monument, des symboles ou des inscriptions. Le terme général de cimetière finit par englober celui de champ funéraire et de nécropole, où l’on peut trouver également ossuaires et columbariums.
Ils sont organisés selon une certaine typologie telle que le propose le CAUE 69 dans son dossier « cimetière, Dessin et composition du cimetière » :
Trame, allées et ordonnancement
L’ordonnancement des allées peut être très varié: linéaire, tramé, curviligne ou aléatoire. En revanche, il doit être organisé par typologie de tombes (pleine terre, caveau ou columbarium) par exemple, permettant ainsi d’avoir une lisibilité et une certaine harmonie dans l’espace.
Les cheminements piétons se prêtent à une plus grande variété de traitement que les voies carrossables. Les impératifs techniques sont la résistance aux déformations du sol et la mise en œuvre de revêtements perméables limitant les eaux de ruissellement et évitant les sols glissants.
Un cimetière bien composé facilite l’orientation du visiteur et évite la mise en place d’une signalétique trop prégnante. Il est important de rendre identifiable depuis l’entrée les différentes parties constituant le cimetière.
Une implantation dans la pente ouvre des vues vers et depuis le cimetière. Par conséquent, il convient de composer avec le relief, d’optimiser les mouvements de terre, de gérer les eaux pluviales.
Une belle illustration de cette typologie, à l’image de ce panneau du cimetière du Père Lachaise :
Outre cela, un cimetière est un lieu défini juridiquement et géré par les collectivités territoriales. Ainsi, selon le site Odella :
Chaque cimetière de France doit faire respecter un règlement strict. Ce dernier a pour vocation de :
Sécuriser le cimetière à la fois pour le personnel et les visiteurs ;
Veiller au respect des défunts et de leur sépulture : faire respecter la tranquillité au sein du cimetière, entre autres ;
Assurer une décence de chaque individu entrant dans le cimetière ;
Garantir la propreté des lieux et des tombes.
Il s’agit des règles de savoir-être au sein du cimetière. Aussi, ce règlement, affiché à l’entrée du lieu, doit :Informer des jours et horaires d’ouverture du cimetière ;
Proposer un plan ;
Préciser si les registres peuvent être consultés à la mairie.
Le gardien du cimetière joue aussi un rôle important puisqu’il veille à la propreté du lieu mais aussi à l’accueil des visiteurs.
Si les cimetières tendent à se laïciser, voire à se séculariser, la religion y reste présente au travers des « carrés confessionnels », comme l’explique très bien un géographe dans cet article de Géoconfluences sur le cimetière de la Guillotière à Lyon :
La loi française interdit le regroupement de personnes de confession commune dans des espaces dédiés au sein des cimetières, aussi appelés "carrés confessionnels". En fait, ces regroupements existent bien, pour des raisons historiques et pratiques. Entre la lettre du droit et son application s'insère ici une forme de pragmatisme local, reconnu et accompagné par l'État.
Ainsi les cimetières sont le reflet de leur époque et après une phase d’austérité toute hygiéniste, nos lieux de recueillement tendent à se naturaliser en acceptant de nouveau plus de nature, comme l’explique l’article « Ce que les cimetières disent de notre rapport au vivant » :
Fermez les yeux et imaginez un cimetière. Comment est-il? Pour certains, ce sera de vieilles tombes recouvertes de mousses entourées de feuilles mortes d’où jaillit parfois un écureuil… Pour d’autres ce sera un alignement de tombes de granit rutilantes séparées par un gazon finement coupé, d’autres encore imaginent un endroit où reposent les morts et voguent les vivants, ici un passant, plus loin, une poussette…
Notre vision du cimetière dit beaucoup de notre rapport à la mort comme à la nature, et l’espace du repos éternel de nos morts est ainsi devenu, ces dernières années, un terrain de bataille idéologique.
Car depuis 2022, les cimetières, comme le reste des espaces publics, ne peuvent plus être désherbés avec des pesticides, ce qui a conduit certaines communes à entamer une réflexion de fond sur la place à accorder à la nature dans les cimetières communaux.
Ou le vade-mecum « construire le cimetière de demain » proposé par la Région AURA et le Patrimoine Aurhalpin.
Et les mathématiques dans tout cela ? Pas grand-chose effectivement.
Une piste, peut-être : la topologie des espaces métriques qui, selon Wikipédia serait :
En mathématiques et plus particulièrement en topologie, un espace métrique est un ensemble au sein duquel une notion de distance entre les éléments de l'ensemble est définie. Les éléments seront, en général, appelés des points.
Tout espace métrique est canoniquement muni d'une topologie. Les espaces métrisables sont les espaces topologiques obtenus de cette manière.
L'exemple correspondant le plus à notre expérience intuitive de l'espace est l'espace euclidien à trois dimensions. La métrique euclidienne de cet espace définit la distance entre deux points comme la longueur du segment les reliant.
A défaut, vous pouvez vous tourner vers des professionnels qui ont dévelopé un logiciel ad-hoc : Cymethis.
Sorti des classiques répertoires de mathématiciens inhumés dans les cimetières ou de l’échange sur le site « mathématiques.net », la seule mathématique qui puisse apparaitre serait issue des recherches architecturales contemporaines, tel l’article « Architecture : à quoi ressembleront les cimetières de demain ? » :
Le mythique cimetière du Père-Lachaise à Paris, le cimetière monumental de Milan, en Italie, véritable témoignage architectural de la ville, la tombe Brion imaginée par l’architecte Carlo Scarpa et située à San Vito d’Altivole, dans la province de Trévise en Italie, ou encore le joyeux cimetière de Sapanta en Roumanie… Les cimetières sont des pièces maîtresses des villes. Pourtant, le sujet semble être moins médiatique que les nouvelles tours de Dubaï ou les centres culturels, alors que les défis des cimetières de demain sont pourtant nombreux. Quel avenir réserve-t-on aux demeures des morts, dans un monde où la population ne cesse d’augmenter, où les usages changent et où la place, parfois, vient à manquer ? Entre cimetières-parcs et gratte-ciels funéraires, les architectes français réfléchissent au devenir de ces lieux réservés à nos défunts, si symboliques et importants pour les vivants.
Ou la magnifique proposition de l’architecte Nicolas Ledoux qui proposait un cimetière pour sa ville utopique de Chaux :
Expliqué par la vidéo : Claude Nicolas Ledoux - Arc-et-Sénans - Cité idéale de Chaux - Le cimetière
Mandala-ment vôtre,
Pour aller plus loin :
Le cimetière pour : histoire d'une conquête sociale de Bertrand Mary
Les cimetières : des lieux de vie et d'histoires inattendues de Marc Faudot
Aux origines des cimetières contemporains : les réformes funéraires de l'Europe occidentale, XVIIIe-XIXe siècle sous la direction de Régis Bertrand & Anne Carol
Les distances : un outil pour tout mesurer, revue



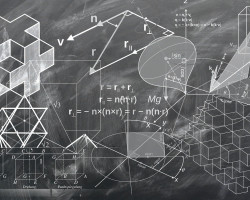
 J’habite ici !
J’habite ici !