Question d'origine :
Les gens vraiment gentils, les gens vraiment bien sont-ils une toute petite minorité? Les gens vraiment bien sont-ils en réalité assez rare?
Réponse du Guichet
Quel paradoxe ! Les français sont très critiques et pessimistes quand on leur demande si leurs concitoyens sont gentils, bienveillants et généreux alors qu'une grande majorité d'entre-eux considèrent l'être ! Réjouissez-vous, les dernières enquêtes montrent que le niveau de compassion pour autrui augmente au fil des ans.
Bonjour,
Rassurez-vous, les gens gentils ne semblent pas être une minorité de la population.
Nous vous proposons de lire les résultats détaillés de l'enquête Ipsos réalisée pour le magazine Psychologies, à l’occasion de la Journée de la gentillesse du 3 novembre auprès de 1 003 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, du 23 au 29 octobre 2015.
Ce sondage montre que, tout comme vous semble-t-il, les français ont une vision pessimiste et sombre de l’être humain, considérant très majoritairement qu’il est par nature égoïste : pour 77 % des Français, l’humain est par nature plutôt égoïste… Pourtant, à titre personnel, 72% se disent altruistes, 96% seraient gentils, 90% attentionnés et 83% généreux. Cela révèle la différence entre la perception de soi et celle d’autrui.
Ils avouent très majoritairement qu’il leur arrive d’aider leurs proches, famille ou amis (92% dont 60% disent « souvent ») et leur entourage comme leurs collègues et leurs connaissances (74%). En revanche, lorsqu’il s’agit d’inconnus que l’on croise dans la rue ou de personnes que l’on aide en donnant ou en s’impliquant dans des associations, leur capacité à venir en aide aux autres se restreint (respectivement seulement 34% et 32% disent qu’il leur arrive de le faire souvent ou parfois). [...]
Malgré leur très fort pessimisme, le sentiment qu’ils n’en font pas assez pour aider les autres est très majoritaire : seuls 31% des Français considèrent aujourd’hui qu’ils en font suffisamment. A contrario, plus d’un tiers d’entre eux se remet en question en avouant qu’ils pourraient en faire plus mais ne savent pas comment faire (35%).
source : Les Français et l'entraide / Pychologies - 10 novembre 2015
Ce sondage IFOP datant de 2019 portant sur les français et le concept de bienveillance indique que 95 % d'entre-eux se jugent bienveillants mais trouvent majoritairement (à 55%) que leurs concitoyens ne le sont pas.
2) UNE VALEUR POSITIVE QUE L’ON S’ATTRIBUE BEAUCOUP PLUS A SOI QU’AUX AUTRES
La bienveillance est une attitude perçue très positivement par les Français. En effet, 94% d’entre eux y voient plus une qualité qu’un défaut (6%) et 88% un signe de force plutôt que le marqueur d’une faiblesse (12%). Sur cette rare unanimité à propos des valeurs entourant la bienveillance, les Français marquent une différence de point de vue selon qu’ils s’auto-évaluent ou qu’ils jugent les autres : unanimement, les Français se trouvent quasiment tous bienveillants (95%) mais sont à peine plus d’un sur deux (55%) à estimer que les autres ne le sont pas. [...]3) UNE ATTITUDE QUI SUSCITE DES CRAINTES ET QUI RESTE DIFFICILE A ADOPTER A L’EGARD DES INCONNUS
Malgré la large popularité de la notion, les freins à la bienveillance restent puissants, notamment parmi les hommes chez qui elle suscite la crainte d’être trop sollicité (83% contre 82% dans l’ensemble) ou de ne pas se faire respecter (76% contre 73% dans l’ensemble). [...]Dans le détail, on notera que le degré de bienveillance varie beaucoup en fonction du niveau de proximité avec la personne fréquentée. Ainsi, 98% des Français déclarent être bienveillants avec leurs enfants et 96% avec leurs amis ou leurs parents. Ce taux tombe à 71% avec des inconnus dans la rue ou 76% en voiture, signe que l’anonymie des relations fait baisser le degré de bienveillance vis-à-vis des autres.
L'ouvrage intitulé La France des valeurs : quarante ans d'évolutions publié sous la direction de Pierre Bréchon, Frédéric Gonthier et Sandrine Astor indique que la valeur de l'altruisme est à la hausse depuis 2008 et que les nouvelles générations le sont davantage qu'auparavant. Voici les conclusions des travaux de Frédéric Gonthier :
D'abord, l'altruisme social est nettement plus affirmé que l'altruisme identitaire. L'altruisme à l'égard des personnes âgées, malades ou handicapées, et des chômeurs est le plus prononcé ; ce qui indique probablement la forte sensibilité de l'opinion aux nouvelles formes de vulnérabilité et de dépendance liées au grand âge, aux situations de handicap ou au chômage de longue durée. L'altruisme à l'égard des immigrés est un peu plus faible, mais il est au même niveau que l'altruisme à l'égard des voisins et des concitoyens.
Cette importance de l'altruisme social tend à contredire les discours alarmistes sur la montée des communautarismes et de l'affaiblissement des solidarités verticales au profit des solidarités horizontales. [...]
Le second constat clé est celui de la progression tendancielle de l'altruisme, qu'il soit social ou identitaire, entre 2008 et 2018. Alors que le nombre de commentateurs de la vie publique s'inquiètent des effets délétères de la Grande Récession, la dernière enquête Valeurs invite à relativiser l'idée d'un recul de la solidarité sociale. Il semble que la crise ait conduit à un plus grand souci des autres, du moins sous la forme de l'altruisme déclaré qui est mesurée ici. [...]
Une hausse plus marquée parmi les jeunes générations
[...]
Comment expliquer cette poussée de l'altruisme parmi les jeunes générations au cours des dix dernières années ? On peut penser qu'elle est solidaire du mouvement général vers une plus grande ouverture et une plus grande tolérance à l'égard d'autrui, lequel est largement sous-tendu par le processus de renouvellement générationnel. Mais on peut aussi y voir un effet du contexte, la Grande Récession, et la mobilisation de plusieurs acteurs politiques ou associatifs en faveur de groupes très défavorisés (comme les sans-abris, les migrants ou les réfugiés) ayant rendu les jeunes générations plus attentives aux conditions de vie des autres.
source : Le souci des autres. Une forte progression parmi les jeunes générations / Frédéric Gonthier
De 1999 à 2008, le niveau global d’altruisme était stable. C’est en fait dans la dernière décennie qu’il se développe. De 2008 à 2018, alors que la crise et la récession économique ont sévi, on aurait pu s’attendre à un repli des individus sur eux-mêmes. C’est l’inverse que l’on observe : la mise en évidence des problèmes sociaux a plutôt renforcé la compassion pour autrui.
Cet indice d’altruisme permet aussi de mieux comprendre le « souci des autres » en observant quelles sont les catégories les plus et les moins altruistes. On n’observe aucune différence de genre, ce qui dément le stéréotype selon lequel les femmes font preuve de plus de compassion que les hommes.
Il est aussi très intéressant de constater que les différences par âge tendent à disparaître. Alors que les 18-29 ans étaient moins altruistes que les autres générations en 2008, ils sont aujourd’hui au même niveau.
En revanche, le niveau d’éducation joue un rôle très important : si 43 % des personnes ayant un faible niveau scolaire font preuve d’un fort altruisme, c’est le cas de 65 % des personnes ayant un niveau scolaire supérieur au baccalauréat.
À travers l’éducation, c’est à la fois les capacités de raisonnements et l’esprit critique qui se transmettent, mais aussi le souci d’autrui et la curiosité pour ce qui se passe en France et dans le monde.
L’enquête confirme par ailleurs que plus on s’intéresse à la politique, plus on tend à être altruiste.
Confiance à autrui
L’altruisme va aussi de pair avec la confiance spontanée aux autres (qui n’est pourtant pas très forte en France). Il est aussi lié à l’adhésion à des associations (tendance stable, autour de 40 % de la population) et par la pratique du bénévolat : ainsi 22 % des habitants en France ont effectué du travail bénévole au cours des 6 derniers mois.
Cette forme d’engagement serait d’ailleurs en hausse sensible selon France Bénévolat.
La confiance à autrui est un élément déterminant : chez les personnes les plus méfiantes, le niveau d’altruisme est de seulement 31 % contre 75 % pour les plus confiants.
source : Les Français sont beaucoup plus solidaires qu’on ne le croit / Psychologies - 27 janvier 2020
Bonne journée



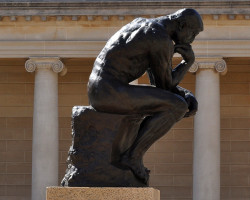
 Zones
Zones