Combats des lumières et obscurantismes : que pouvons nous proposer maintenant ?
Question d'origine :
Combats des lumières et obscurantismes :
Que pouvons nous proposer maintenant?
Réponse du Guichet
La dyade Lumières et obscurantisme existe de longue date et peut servir aujourd’hui à dire ou défendre tout et son contraire, selon ce que chacun considère comme étant de l’ordre du «progrès» ou à l’inverse du «retour en arrière». Voici quelques jalons et références utiles pour mieux comprendre les ambivalences de cette opposition.
Bonjour,
Voici quelques références pour mieux comprendre ce sujet sensible :
Quelques jalons dans l’histoire complexe de deux notions souvent opposées :
Il faut tout d’abord rappeler que ces deux notions sont fortement ancrées dans une temporalité et un espace bien définis. Si la pensée des Lumières a influencé la philosophie occidentale et de nombreux modèles politiques dans le monde, elle est héritière de l’histoire du 18e siècle en France et de la Révolution française.
Quant à la notion d’obscurantisme, comme l’explique l’article de Retronews XIXe siècle : naissance du mot « obscurantisme », elle est née au 19e siècle, pour désigner la période médiévale comme une période sombre et ténébreuse, voire barbare. Or, on sait aujourd’hui que cette vision est erronée et caricaturale pour de nombreux médiévistes. On y voit que la notion d’obscurantisme a ainsi pu servir à cautionner la colonisation de pays jugés barbares et inférieurs. Voir aussi: l’entrée «obscurantisme» dans le Dictionnaire du Moyen âge imaginaire: le médiévalisme, hier et aujourd'hui, sous la direction de Anne Besson, William Blanc et Vincent.
On le voit donc, la lecture du monde opposant lumières et obscurantisme n’est pas si évidente, tant les deux notions sont marquées et empreintes de biais et d’à priori. Aujourd’hui, l’universalité de la philosophie des Lumières est largement questionnée, tout comme la notion de progrès, et le débat continue pour définir l’héritage du mouvement des Lumières (voir par exemple Lumières de la gauche, Stéphanie Roza).
Si les républicains et laïcs français du 19e siècle misaient sur le progrès et la démocratisation des connaissances pour contrer l’obscurantisme et le conservatisme religieux, il n’est pas sûr à l’aune du présent que la recette soit infaillible.
Sans entrer dans le débat très complexe sur les Lumières, nous pouvons peut-être retenir ce qui est mentionné dans le résumé de l’ouvrage Écrasez l'infâme ! : philosopher à l'âge des Lumières.
Bertrand Binoche y note que le plus important à retenir peut-être dans le mouvement des Lumières, c’est le pluriel, le fait que ce qui en a fait la richesse, est justement la pluralité des idées et leur discussion, et le rejet du préjugé.
Il écrit :
"On n'y trouve certes pas une philosophie en bonne et due forme, mais l'infatigable agitation d'intelligences se mouvant en tous sens avec audace et agilité"…"Qu'est-ce donc que les Lumières ? Une nouvelle appréhension de l'activité philosophique tout entière ordonnée à détruire collectivement le "préjugé" et contrainte de ce fait à s'inventer de nouveaux modes d'existence. Il y en eut beaucoup. C'est pourquoi l'on dit les Lumières. Et ce pluriel est une merveille."
Quelques références sur l’actualité des Lumières, qui pourraient nourrir votre questionnement :
Actualité des Lumières: une histoire plurielle, Antoine Lilti à lire aussi en ligne:
«Comment actualiser les Lumières aujourd’hui? Quelles significations peuvent-elles encore revêtir à l’heure du monde global, des réseaux sociaux et de la crise écologique? Comment éviter ces deux écueils que sont, d’une part, la dénonciation caricaturale d’une philosophie identifiée à tort à l’impérialisme européen ou à l’apologie de la modernisation et, d’autre part, la défense figée, et de plus en plus conservatrice, d’une vulgate édifiante qui fait des Lumières l’unique phare du progrès?»
L'héritage des Lumières: ambivalences de la modernité, du même auteur:
«Je suis convaincu que la pertinence actuelle des Lumières, leur potentiel critique contemporain résident précisément dans [leur] pluralité. L’erreur est de croire qu’il faut nécessairement les réduire à une formule intellectuelle simple qui servirait de guide. Cette conception est nécessairement vouée à l’échec, parce que les Lumières n’ont pas d’unité doctrinale: elles sont la scène plurielle des débats et des interrogations suscités par l’ébranlement des sociétés traditionnelles. Les Lumières ne servent pas à justifier la modernité mais à la problématiser.» (Extrait de la conclusion).
Altermodernités des Lumières, Yves Citton :
«Il est aujourd'hui courant d'enrôler les pensées du XVIIIe siècle dans une guerre des civilisations nous contraignant à des prises de positions binaires. Lumières ou Anti-Lumières, République ou communautarisme, laïcité ou fanatisme, modernes ou antimodernes: il faudrait choisir son camp. Ce livre s'efforce de déjouer ces injonctions belliqueuses en esquissant un autre cadre de lecture et en explorant d'autres corpus.» (4e de couv.)
Les Lumières : une révolution de la pensée, sous la direction de Laurent Testot, où l’on retrouve plusieurs interventions insistant sur l’importance de ne pas idéaliser les Lumières mais d’en tirer le meilleur, qui est précisément l’esprit critique et le refus du dogmatisme.
Les Lumières à l'âge du vivant, Corine Pelluchon
«Comment défendre les Lumières aujourd'hui? Leur idéal d'émancipation a-t-il encore un sens? On ne saurait se borner à invoquer un esprit des Lumières immuable dans un contexte marqué par le réveil du nationalisme, les crises environnementales et sanitaires et l'augmentation des inégalités. Faire face au danger d'effondrement de notre civilisation sans renoncer à la rationalité philosophico-scientifique, mais en tenant compte de notre dépendance à l'égard de la nature et des autres vivants: telle est la démarche qui fonde ce livre. Pour combattre les anti-Lumières qui souhaitent rétablir une société hiérarchique ou théocratique et répondre aux accusations des postmodernes qui suspectent tout universalisme d'être hégémonique, il faut donc proposer de nouvelles Lumières.» (4e de couv.)
Les anti-Lumières : une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, Zeev Sternhell
Vous pouvez retrouver une interview de cet auteur dans la revue Humanisme, n°3, 2012 titré: Les anti-Lumières contre la République dont les articles résument quelques enjeux de ces questions délicates.
Soulignons notamment l’article de Jean Zaganiaris : L’obscurantisme : des anti-Lumières à aujourd’hui ?, qui nous enjoint d'ailleurs à parler plutôt des obscurantismes.
En espérant vous avoir un peu éclairé, nous vous souhaitons de bonnes lectures !



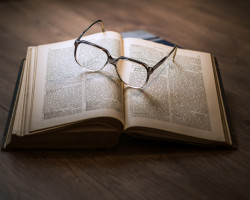
 French Theory
French Theory