Question d'origine :
Pouvez-vous me dire ce que c'est qu' 'une crise des valeurs', s'il vous plaît? Sommes nous en train de vivre 'une crise de valeurs' dans notre époque? Pourquoi certaines personnes pensent-elles que nous sommes en train de vivre 'une crise des valeurs'?
Réponse du Guichet
Les valeurs sont les principes de base guidant nos vies et orientant nos choix et nos actes, tant au niveau individuel que sociétal. L'expression "crise des valeurs" est aujourd'hui souvent employée pour parler de crise des valeurs sociales, tant économiques que morales. Pour questionner la notion de "crise des valeurs", encore faut-il s'interroger sur le concept même de valeurs.
Les références proposées ci-dessous problématisent le concept de valeurs et s'intéressent, sous des angles différents, à la question du socle commun des références et des valeurs d'un pays, aux clivages sociétaux mais également à ce qui nous rassemble.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir ce qu'est une crise des valeurs.
Intéressons-nous d'abord à la définition du concept de valeurs qui se retrouve dans plusieurs domaines : philosophique, économique, esthétique et sociologique... Le site Philosophie Magazine donne les différentes acceptions de cette notion :
Cette notion est issue du latin valere : « valoir », lui-même dérivé du grec axios : « ce qui est digne d’être estimé ». Qualité d’une chose qui la rend objectivement désirable, la valeur, dont la science propre est l’axiologie, se retrouve dans plusieurs domaines. En morale, elle désigne chez Platon ce qui doit guider la conduite, à savoir le Bien. Mais pour Friedrich Nietzsche, qui appelle à renverser toutes les valeurs métaphysiques, c’est la vie comprise comme volonté de puissance qui doit désormais servir de valeur. Jean-Paul Sartre, lui, soutient que la liberté est l’unique fondement des valeurs. En économie, la valeur est la propriété d’une chose à satisfaire les besoins de l’individu. Karl Marx voit dans le capitalisme une perversion du rapport des hommes au produit de leur travail, la valeur d’usage étant remplacée par la valeur d’échange, source de profits. En logique classique, la valeur d’une proposition est ce qui permet de dire si elle est vrai (V) ou fausse (F). S’y ajoute en logique moderne, d’autres valeurs (comme le possible, le probable …). En esthétique, outre la norme du beau qui permet d’évaluer une œuvre, la valeur désigne spécifiquement le degré de clarté ou d’obscurité d’une surface peinte. Le noir et le blanc ne sont donc pas des couleurs mais des valeurs. Rappelons enfin qu’on distingue les faits et les valeurs. Le sociologue Max Weber montre que pour échapper à la partialité et au conflit inhérent aux valeurs, les sciences sociales doivent éviter les « jugements de valeur » mais penser les « rapports aux valeurs », c’est-à-dire adopter une « neutralité axiologique ».
Source : Valeur (Philosophie Magazine)
L'Encyclopédie universalis nous explique que le vocable valeurs est aujourd'hui majoritairement employé dans le débat public au sens sociologique, éthique et morale : il s'agit des idéaux ou principes servant de ciment social et de repères moraux au sein des sociétés humaines :
Plus encore que les normes, les valeurs font aujourd'hui partie de ce vocabulaire de la sociologie qui s'est progressivement imposé dans le langage courant pour désigner des idéaux ou principes régulateurs des meilleures fins humaines, susceptibles d'avoir la priorité sur toute autre considération. Ce sens actuel de la valeur s'écarte des usages économiques ou mathématiques plus classiques du terme, mais ne contredit pas son étymologie : valere qui, en latin, signifie « être fort », puisque c'est bien la puissance de certains idéaux qui semble devoir assurer leur prévalence. La tradition sociologique a fait du prédicat de valeur, originellement attaché à un sujet individuel – par exemple la valeur d'un homme au combat –, une sorte d'entité souveraine reconnue comme telle par une collectivité humaine.
Source : VALEURS, sociologie par Patrick PHARO, directeur de recherche au C.N.R.S.
Quant à la notion de crise, le Dictionnaire CNRTL explique que dans la vie en société, une crise est :
B.− [Dans la vie de la société]
1. En gén. Situation de trouble profond dans laquelle se trouve la société ou un groupe social et laissant craindre ou espérer un changement profond; p. méton., période ainsi caractérisée. Crise morale, des mœurs; crise de la civilisation, des sociétés modernes; issue d'une crise; pressentir une crise; entrer dans une période de crise. Marquer les grandes crises du développement de la société moderne (Guizot, Hist. civilisation,1828, p. 42).Aux jours de crises et de révolutions (Musset, Lettres Dupuis Cotonet,1836, p. 599). Il a bien servi la patrie dans la plus grande crise de son histoire (De Gaulle, Mém. guerre,1954, p. 536) :
7. Pour M. Ferrero, la grande crise du troisième siècle consiste dans une tentative désespérée des empereurs vers un principe d'autorité. Bloch, Destin du Siècle,1931, p. 209.
L'expression "crise des valeurs" est ainsi employée aujourd'hui dans le débat public pour pointer la situation de trouble profond de principes moraux sociétaux. André Béjin dans Crises des valeurs, crises des mesures. In: Communications, 25, 1976 (La notion de crise, sous la direction de André Béjin et Edgar Morin. pp. 39-72) notait qu'en 1932 Paul Valéry parlait déjà de "crise générale des valeurs", touchant l'économie mais également l'ordre moral et politique :
Paul Valéry, s'interrogeant en 1932 sur le discrédit qui affectait toutes les traces écrites d'obligation [...] concluait : "Il s'agit donc d'une crise générale des valeurs. Rien n'y échappe, ni dans l'ordre économique, ni dans l'ordre moral, ni dans l'ordre politique. La liberté elle-même cesse d'être de mode. Les partis les plus avancés qui la réclamaient furieusement, il y a cinquante ans, la renient et l'immolent aujourd'hui !... Cette crise s'étend à tout : les sciences, le Code civil, la mécanique de Newton, les traditions diplomatiques, tout en est affecté. Je ne sais même pas si l'amour lui-même n'est pas en voie d'être évalué tout autrement qu'il ne l'était depuis une demi-douzaine de siècles... En somme, crise de confiance, crise des conceptions fondamentales, c'est bien une crise de tous les rapports humains, c'est-à-dire une crise des valeurs données ou reçues par les esprits » (1957, p. 1036). Sept ans plus tard, le même auteur, dans un texte intitulé « La liberté de l'Esprit », suggérait allusivement que la « crise des valeurs » pouvait n'être pas seulement un brouillage des représentations psychiques qualitatives, qu'elle signifiait aussi, plus profondément, un dérèglement des appréciations quantitatives (cf. Valéry, 1962, p. 258 s.). Ainsi l'expression « crise des valeurs » ne désignerait pas seulement une perturbation du système des jugements éthiques portés par les agents sociaux sur ce qui est désirable, digne d'estime, sur ce qui compte et a du prix ; par cette locution, également, serait qualifiée une altération violente et brusque des instruments d'estimation quantitative, d'établissement des comptes, de fixation des prix, et par là même des modalités et des résultats des évaluations opérées à l'aide de ces instruments.
Source : André Béjin dans Crises des valeurs, crises des mesures. In:Communications, 25, 1976 (La notion de crise, sous la direction de André Béjin et Edgar Morin. pp. 39-72)
Yves Michaux, dans un article paru dans Philosophie Magazine en 2012, Aux valeurs !, questionne l'usage problématique, par les politiques, de cette notion car les valeurs, réputées immuables, sont loin d'être absolues et ne peuvent pas désigner tout et n'importe quoi :
Les hommes politiques, surtout à l’approche d’un scrutin, aiment à en appeler aux valeurs. Réputées immuables, rassembleuses, elles seraient de vrais refuges pour une société qui doute. Sauf que ces valeurs sont plutôt floues et loin d’être absolues. [...]
En période électorale reviennent les « valeurs » et les « choix de valeurs » – mais ces absolus sont plus problématiques qu’il n’y paraît. Première remarque : la représentation de l’action politique et morale en terme de valeurs est un pur produit de la pensée du XIXe siècle. La notion apparaît au croisement d’une généralisation de la question kantienne « qu’est-ce qui vaut ? » (réponse de Kant : la volonté bonne) chez des philosophes néokantiens comme Heinrich Rickert ou Wilhelm Windelband, de la théorie hégélienne de l’extériorisation et de l’objectivation de l’Esprit chez des penseurs comme Wilhelm Dilthey, et de la découverte de la société et de la sociologie (chez tout le monde…). Les valeurs sont ce qui donne de la valeur.
Ces nouvelles idéalités platoniciennes qui servent de normes aux jugements et inspirent les actions sont interprétées de trois manières. Soit ce sont des absolus métaphysiques posés par Dieu. Telle est la version de Victor Cousin dans Du Vrai, du Beau et du Bien (1853). Soit ce sont des émanations de l’esprit collectif – la société ou le vouloir organique des hommes en communauté chez les sociologues Émile Durkheim ou Ferdinand Tönnies. Soit ce sont les produits de la volonté tout court – que ce soit la volonté de l’homme en général (l’homme kantien ou l’humanité avec sa volonté bonne) ou d’un homme en particulier subjuguant ses partisans par son charisme. [...@
Si les valeurs sont les produits d’actes de la volonté posant ce qui vaut et lui conférant une transcendance, on ne peut pas invoquer n’importe quoi comme valeur. Sur ce point, le discours politique est souvent confondant. Car la famille, le travail, l’école ne sont nullement des valeurs. La famille est une forme d’organisation sociale, le travail, un mode de rapport aux choses, et l’école, un mode de transmission. Et encore je ne parle pas du drapeau, de la France ou de l’argent, qui ne sont pas non plus des valeurs mais que l’on voit souvent invoqués comme tels. En revanche, la justice, la solidarité, l’effort, l’éducation sont des valeurs. Toujours du point de vue de l’analyse conceptuelle, il faut être conscient qu’il y a des valeurs négatives comme des valeurs positives : ce que l’on peut ou doit vouloir et ce que l’on ne peut ou ne doit pas vouloir. L’amour actif de la patrie (patriotisme) peut être une valeur positive qui a pour corrélat un certain refus de l’étranger. De même, la valeur de l’enrichissement a pour corrélat une valeur négative comme la cupidité.
Il y a donc beaucoup de confusions enveloppées dans le discours sur les valeurs, et mieux vaudrait s’en méfier. Ce serait déjà un pas en avant de fait que de parler tout simplement de ce que l’on veut et ne veut pas. En politique comme ailleurs, les absolus métaphysiques ne mènent qu’à la tromperie – mais c’est peut-être pour cela même qu’on ressort ces marionnettes…
Nous vous invitons aussi à lire :
Une culture peut-elle être porteuse de valeurs universelles ? (Aïda N’Diaye publié le 10 mai 2022 dans Philosophie Magazine)
Le sens des valeurs.. In: Revue française de sociologie, 2000, 41-2. pp. 402-405 / Desbois Dominique. Boudon Raymond
Concernant la question de la crise des valeurs sociales, nous vous indiquons des ouvrages issus de nos collections :
Des valeurs [Livre] : une approche sociologique / Nathalie Heinich, 2017
Mobilisant les outils des sciences sociales, N. Heinich interroge les valeurs en adoptant une approche descriptive et compréhensive montrant qu'elles sont des représentations collectives, cohérentes et agissantes. Elle éclaire ainsi les processus par lesquels les acteurs attribuent de la valeur à des choses, à des actions ou à des personnes par le prix, le jugement ou l'attachement. (c) Electre
Psychologie des valeurs [Livre] / Christine Chataigné ; préface de Serge Guimont, 2014
Les valeurs sont les principes de base guidant nos vies et orientant nos choix et nos actes, tant au niveau individuel que sociétal. Bien comprendre ces valeurs et leurs relations permet de les promouvoir, les invoquer ou les modifier selon nos objectifs pour, au final, faire évoluer et améliorer sa propre vie, celle de ses groupes d'appartenance et de la société dans son ensemble. En se basant tant sur les travaux fondateurs que sur les découvertes les plus récentes sur les valeurs humaines de base, cet ouvrage expose sous le prisme de la Psychologie Sociale la nature des valeurs individuelles, groupales et sociétales, ainsi que leur mode d'internalisation.
La crise des temps modernes [Livre] : dialectique de la morale / Karel Kosik, 2003
Critique de la civilisation moderne d'un point de vue éthique, humaniste et radical, remettant en cause l'économie, la société et la politique moderne. Le philosophe tchèque considère les formes culturelles du passé comme une source d'inspiration pour construire un meilleur avenir.
Les nouvelles passions françaises [Livre] : réinventer la société et répondre à la crise / François Miquet-Marty, 2013
Le quotidien et les aspirations des Français à l'heure de toutes les incertitudes. Partout se réinventent des manières de vivre, des imaginaires du quotidien, des projets essentiels, des espérances pour demain. Pour l'auteur, les Français développent une vision sociétale plutôt qu'économique de la crise.
La crise morale de la France et des Français [Livre] : enquête sur l'individu trop certain / Michel Fize, 2017
Un pamphlet sur la perte de valeurs en France. L'auteur analyse ce qu'il perçoit comme une amoralisation individuelle et collective, et propose quelques pistes pour y remédier. ©Electre
Ce qui nous rassemble [Livre] : comment peut-on encore être français ? / Thierry Keller, Arnaud Zegierman, 2017
Une enquête sociologique sur l'identité collective française, construite dans un esprit de neutralité politique. Les auteurs ont réalisé des entretiens sur un échantillon représentatif de la population. Il apparaît qu'au-delà des clivages, un socle de valeurs communes est présent. Les Français y apparaissent attachés à leur modèle social, hédonistes et prêts à traverser ensemble le XXIe siècle. ©Electre 2017
L'archipel français [Livre] : naissance d'une nation multiple et divisée / Jérôme Fourquet ; avec la coll. de Sylvain Manternach, 2019
Analyste politique, expert en géographie électorale, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France, montrant combien s'est affaibli le socle commun des références et des valeurs dans le pays. Entre sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société multiculturelle, un bouleversement anthropologique est à l'oeuvre. ©Electre 2019
En quête de valeur(s) [Livre] / Jean-Marie Harribey, 2024
Comparant la valeur des marchandises et celle de la justice, de la liberté ou de la démocratie, l'économiste s'interroge sur le sens de ce mot, menant une enquête à la fois philosophique, anthropologique et économique. Il montre comment et pourquoi la valeur pour l'actionnaire s'est érigée en valeur suprême et propose des pistes pour sortir de cette impasse. © Electre 2024
Bien à vous



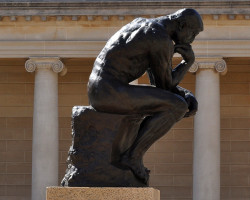
 French Theory
French Theory