Existe-t-il un terme désignant les romans truffés de références ?
Question d'origine :
Bonjour
Existe-t-il un terme générique pour désigner les romans dont le scenario est "hâché" par d'importantes digressions didactiques truffées de références ?
Je pense à des auteurs comme Denuzière, E.E.Schmitt, Dan Brown, etc.
J'invente deux exemples à peine caricaturaux :
1 - Il goûta la soupe puis, en terminant sa réponse à Marta, il tendit la main vers la salière disposée sur la table.
Le sel, depuis la nuit des temps [...] s'ensuit un cours complet sur son histoire, sa production, sa commercialisation etc. Trois quatre pages.
Puis soudain on reprend le fil :
Marta le regardait saupoudrer trop largement son assiette. Il releva les yeux et, portant la cuillère à ses lèvres, il ajouta : "tu sais [...]".
Commentaire : la soupe a eu le temps de refroidir, hihi !
2 - Il s'empara de l'arme.
C'était un Sig Sauer de la série xxx [...] Tout sur cette arme pendant trois quatre pages.
Puis soudain on reprend le fil :
Il tira sans état d'âme.
Commentaire : ô temps suspends ton vol : son adversaire a eu le temps de s'esquiver, hihi !
Cette technique d'écriture est à la fois passionnante - on peut apprendre plein de choses, et agaçante - comme les coups de sifflet d'un arbitre de rugby trop pointilleux.
Merci par avance de votre réponse.
Réponse du Guichet
La digression, définie en tant que figure de rhétorique ou figure de technique narrative, est désignée par Patrick Bacry, dans son ouvrage Les figures de style et autres procédés stylistiques, par le terme générique "figures de l'organisation du discours". Cette pratique apparaît en philologie comme un indice de modernité qui présuppose une conception de la littérature privilégiant le désordre, la déliaison, la fragmentation.
L'auteur distingue ainsi la digression (procédé produisant des développements de dimensions très variables et de différentes natures : théorique, didactique mais aussi narrative), de l'épiphonème (procédé qui entrecoupe le cours d'un récit de remarques de portée générale, de maximes formulées par l'auteur à propos de ce qui va être raconté, ou de ce qui vient de l'être), ou encore de l'épiphrase (commentaire rapide de l'auteur en quelques mots et/ou sous forme de parenthèse à propos de ce qu'il est en train d'évoquer).
La parabase, quant à elle, désigne une digression dans le théâtre antique grec, pendant laquelle le coryphée interpelle les spectateurs sur des sujets d'ordre divers, n'ayant rien à voir avec l'intrigue.
Bonjour,
C'est avec un mélange d'admiration et d'agacement que vous constatez l'emploi de la digression chez des écrivains qui manient à merveille l'art des vagabondages de la pensée pour mettre en suspens le déroulé narratif principal de leur récit. Vous citez des auteurs comme Denuzière, E.E.Schmitt, Dan Brown, etc. Vous vous demandez alors si il existe un terme générique pour désigner les romans dont le scenario est interrompu par d'importantes digressions.
Dans Dictionnaire des termes littéraires (éd. H. Champion, 2001), la digression (lat. digression = action de s'éloigner) est définie en tant que figure de rhétorique et en tant que technique narrative :
En rhétorique, partie du discours judiciaire qui sort du sujet principal, mais avec l'intention de mieux disposer l'auditoire : il s'agit de distraire celui-ci par des informations successives quand la matière devient trop sèche, d'exposer des faits ou des événements tragiques dans un contexte religieux qui en atténue les effets (cf. les Oraisons funèbres de Bossuet), ou encore de renforcer la tension par une suspension du thème central au moment même d'un tournant décisif (effet de retardement).
En tant que technique narrative, la digression a été abondamment mobilisée au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, au point de devenir l'axe même autour duquel le récit s'articule : cf. Tristan Shandy (1760) de L. Sterne, et Jacques le fataliste (1778) de Diderot.
[Sources bibliographiques]«Digression régression (arabesques)», Poétique, n°40, p.395-407, 1979 ;
Narration et interprétation / par Gothot-Mersch, Claudine, et al., éditeurs. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1984 ;
Le récit excentrique [Livre] : Gautier, de Maistre, Nerval, Nodier / Daniel Sangsue, 1987 ;
Stratégies discursives. Digression, transition, suspens. / par Bayle Ariane. Randa Sabry. In: Mots, n°39, juin 1994. Environnement, Écologie, Verts, sous la direction de Lamria Chetouani et Maurice Tournier. pp. 123-124.
Dans Les figures de style et autres procédés stylistiques (2017), Patrick Bacry explique et commente le procédé de la digression qu'il classe parmi un groupe de figures de style : les figures de l'organisation du discours. La digression produit ainsi des développements annexes de dimensions variables et de différentes natures : théorique, didactique mais aussi narrative. Cela pose la question de la linéarité du récit, explorée par le roman moderne.
Il y a digression (littéralement "action de s'éloigner, de s'écarter") quand, au milieu d'un développement, intervient un autre développement relativement long sur un sujet annexe, ne se rapportant pas directement au thème traité, mais sur lequel, pour une raison ou une autre, on désire s'attarder. L'occasion fait alors le larron. On saisit au vol le sujet qui s'est rencontré, et l'on abandonne pour un temps, quitte à y revenir plus tard, le droit chemin que l'on suivait jusque là. [...]
Montaigne, dans son refus permanent et obstiné de toute contrainte, fait sans doute partie de ceux qui ont su user de cette liberté de la manière la plus remarquable et la plus élégante. [...] Certains auteurs préviennent ouvertement le lecteur de ces changements provisoires de sujet. C'est ce que fait Saint-Simon, quand il interrompt le cours chronologique de ses Mémoires pour faire un commentaire général sur un point qui vient d'apparaître dans son récit. L'une des "manchettes" qui ponctuent son texte annonce par exemple : "Digression sur le prétendu droit des fils de France de présenter au Roi des sujets pour êtres faits chevaliers de l'Ordre" - problème auquel il consacre sept longues pages [...] avant de revenir à son exposé chronologique. [...]
Dans la langue courante, et dès qu'on sort du cadre restreint du lexique de la rhétorique, le terme de parenthèse est souvant employé dans le sens de "digression". [...] Mais, dans un sens plus strict, la digression ne saurait se confondre avec la parenthèse. Cette dernière (cf. p. 193) est en effet de taille modeste et s'inscrit toujours dans les limites d'une phrase, alors que la digression est un procédé beaucoup plus large, produisant, des développements de dimension très variable et s'inscrivant, comme nous l'avons dit des figures auxquelles ce chapitre est consacré, dans le cadre de l'organisation générale du discours.
On parle d'ailleurs aussi de digressions à propos d'"épisodes entiers" interpolés dans le cours d'un récit : c'est le cas des quatre célèbres narrations qu'on trouve dans La Princesse de Clèves et qui n'ont pas de rapport direct avec le récit principal. [...]
Car, loin des textes théoriques ou didactiques, il existe aussi des digressions narratives. [...] Le roman moderne s'est reposé cette question de la linéarité du récit. [...]
Dans l'ouvrage sus-cité, Patrick Bacry présente d'autres figures de style qui sont d'autres manières d'interrompre le cours d'un récit. Il s'agit de l'épiphonème et de l'épiphrase :
L'épiphonème consiste à entrecouper le cours d'un récit de remarques de portée générale, de maximes formulées par l'auteur à propos de ce qui va être raconté, ou de ce qui vient de l'être :
Cette figure est appelée épiphonème (mittéralement "parole ajoutée, ou exclamation", donc "commentaire [exclamatif] à propos de quelques chose"). La rareté du nom savant dont use la rhétorique traditionnelle pour désigner cette figure ne doit pas cacher la fréquence du procédé lui-même : dans tout roman de Balzac, on compte par dizaines les épiphonèmes, l'auteur aimant commenter l'action qi'il met en scène. Les "morales " qui accompagnent les fables de La Fontaine et des autres fabulistes sont, d'un point de vue technique, des épiphonèmes. [...]
Enfin Marcel Proust commence une lettre adressée à Gaston Gallimard par cette réflexion le concernant directement, mais qui, formulée de manière générale, constitue bien un épiphonème (initiatif) : "je suis un homme qui au point de vue santé (lequel commande tout le reste) ai [sic] peu de chance. Vous allez le voir dans un instant..."
Source : Les figures de style et autres procédés stylistiques (2017) par Patrick Bacry
L'épiphrase, dont le sens étymologique ("explication ajoutée") est assez voisin de celui d'épiphonème, ne se confond toutefois pas tout à fait avec ce dernier :
Le terme d'épiphrase - au reste assez peu usité- désigne parfois un commentaire rapide de l'auteur (en quelques mots, sous forme de parenthèse) à propos de ce qu'il est en train d'évoquer, comme dans cette pharse de Dumas, rencontrée ailleurs, où la parenthèse de double d'une anacoluthe :" Sa fortune était sinon faite, on ne faisait pas sa fortune auprès de lui, mais sa position assurée".
Parrallèlement à ces figures de style relevant prinipalement de l'organisation du discours et de la narration dans le roman moderne, il existe aussi une figure de style, la parabase, utilisée comme élément de structure du théâtre grec antique :
C'est une partie d'une comédie grecque, généralement située au milieu de la pièce, qui consiste essentiellement en un discours du coryphée. Dans cette sorte de digression, l'auteur fait connaître aux spectateurs ses intentions, ses opinions personnelles. La parabase est prononcée par le chœur qui a ôté son masque et enlevé son manteau ; seul en scène. Elle disparaît peu à peu dans les pièces du IVe siècle av J.C. (Wikipédia)
Véronique KLAUBER lui consacre un article dans l'Encyclopédie universalis :
La parabase est une partie de la comédie grecque où l'auteur s'adresse directement au public, par la bouche du coryphée qui interpelle les spectateurs, pendant que le chœur se range au bord de la scène. Le sujet de la parabase n'a rien à voir avec l'intrigue qui, ainsi interrompue, reprendra son cours après l'exposé du coryphée. Cette digression porte sur l'actualité politique, la religion, des faits divers, des remarques personnelles de l'auteur dont les principaux adversaires, les autres dramaturges morts ou vivants, sont criblés de flèches oratoires. L'auditoire est évidemment appelé à témoigner en faveur de l'auteur. C'est toute la cité qui est sollicitée. La forme canonique de la parabase est constituée de six parties : la chanson d'introduction (commation), un long développement des griefs en anapestes (pnigos), la strophe ou l'ode (melos), le commentaire (épirrhème), l'antode ou antistrophe et l'antépirrhème. Aristophane porta à la perfection cette sorte d'intermède dont la satire mordante fut peu appréciée du pouvoir.
Source : PARABASE, poétique
Une publications de l'ENS et des éditions Sahar, La Digression (2008) s'est penchée sur les enjeux de la digression du point de vue philologique :
« La digression est un objet flou qui se dérobe au discours critique », affirme Aude Déruelle au début de son livre Balzac et la digression. Difficile à classer ou à définir, la digression a été souvent considérée comme un défaut, une déviation superflue, un symptôme de désordre et d'excès, un « vice d'éloquence, où l'on tombe lorsqu'un Orateur sort de son principal sujet pour en traiter un autre », ayant, selon Aristote, une dangereuse capacité à manipuler les passions de l'auditoire. En outre, c'est un phénomène de l'hétérogénéité et de la déconstruction qui porte atteinte à la continuité et à la cohérence du texte.
Or des études consacrées à des auteurs comme Montaigne, Diderot, Balzac, Proust, Sterne, suggèrent, comme le note Randa Sabry, une problématique de la digression, mais qui n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie.
Derrière la feinte du détour involontaire, à travers le trajet sinueux, au-delà des fragments textuels hétéroclites se dissimulent une technique narrative ou argumentative et une stratégie discursive. L'autonomie de la digression et sa gratuité ne sont qu'apparentes. Ce débrayage énonciatif déstabilise le processus narratif ou discursif pour leur imposer une autre dynamique. Cette forme de « détour » est, comme le dit R. Sabry, une mise en scène, un simulacre, un autre trajet possible pour aboutir à la même destination : « Ce qui est improvisation prolixe, heureux hasards, fil perdu, dans l'expérience banale de la digressivité se retourne chez l'auteur digressionniste en effets de hasard et de disparate, en simulacres de dérive ou de caprice, en jeux d'une écriture suffisamment maîtresse d'elle-même pour se montrer par instants en train de perdre la maîtrise de ce qu'elle écrit » Indice de modernité, la digression présuppose une conception de la littérature privilégiant le désordre, la déliaison, la fragmentation.
La digression, vue ainsi comme 'indice de modernité", est déjà présente dans les récits fictionnels de l’époque classique XVIIe-XVIIIe s. À ce sujet, vous pouvez lire Digressions, dissertations, réflexions dans les récits factuels et dans les récits fictionnels de l’époque classique XVIIe-XVIIIe s. (SIEFAR, 2 juillet 2018) :
Dans l’édition de 1762 du Dictionnaire de l’Académie française la digression est définie comme ce qui est dans un discours « hors du principal sujet », la dissertation comme un « discours où l’on examine soigneusement quelque matière, quelque question, quelque ouvrage d’esprit, etc. ». Rapportées à la dynamique de progression d’un récit, dissertation et digression correspondent à des ralentissements de la « vitesse narrative » (Genette) ou du tempo (Weinrich), voire à une immobilisation de la tension narrative. [...]
Dans la continuité des volets antérieurs du programme « Récit et vérité à l’époque classique », qui repose sur la rencontre et sur le dialogue entre spécialistes du récit de fiction (roman, conte, fable, nouvelle, etc.) et du récit non fictionnel (récit historique, Mémoires, autobiographie, récit de voyage…) aux XVIIe et XVIIIe siècles, on se demandera si les pratiques digressives, dissertatives, réflexives des récits de l’époque classique, aux différents niveaux de l’énonciation (discours de l’auteur, du narrateur, des personnages) participent de fonctionnements similaires de deux côtés de la frontière histoire/fiction, si l’on observe des interactions et des influences d’un champ sur l’autre, si au contraire d’irréductibles différences subsistent en termes de sujets traités, de modalités d’inscription dans le continuum narratif de la digression ou de la dissertation. Le corpus peut s’étendre de la fin du XVIe siècle (Montaigne, Monluc, Brantôme…) au début du XIXe siècle (Chateaubriand, Constant, Stendhal, Balzac…) et inclure également des auteurs étrangers (Milton, Swift, Defoe, Richardson, Gibbon, Goethe…). [...]
Nous vous conseillons également la lecture de cet article Littérature CRLA-Archivos : « La figure de la parenthèse et de la digression en littérature » :
"La mise en tension d’un récit par l’introduction de parenthèses ou de digressions peut se jouer à plusieurs niveaux, celui de la diégèse, de la narration, du discours ou de la structure. [...] Au sein de cette grille d’analyse [de Barthes] , on pourrait considérer que la parenthèse ou la digression serait le moyen de différer la fermeture d’une séquence (« Une séquence est une suite logique de noyaux, unis entre eux par une relation de solidarité, la séquence s’ouvre lorsque l’un de ses termes n’a point d’antécédent solidaire et elle se ferme lorsqu’un autre de ses termes n’a plus de conséquent »[2]). Au XIXème siècle, l’art de la description, notamment pour la période romantique et réaliste, est un recours fréquent pour différer la fermeture d’une séquence. Qu’en est-il des formes littéraires plus contemporaines et plus expérimentales qui, dégagées de la priorité de « raconter une histoire » font de la parenthèse non pas un accessoire mais l’objet même du récit, dès lors contredit dans son principe de linéarité ? [...] Dans quel but ? Quels sont ces effets ? Est-elle un élément de composition secondaire, qui, n’occupant pas une fonction cardinale, pourrait être supprimée ? Ou au contraire, maintient-elle une fonction phatique entre le narrateur et le narrataire absolument indispensable ? La digression pose inexorablement la question de la forme et du rôle de l’écart par rapport à un thème (une structure, une parole) considéré comme principal".
Bien à vous



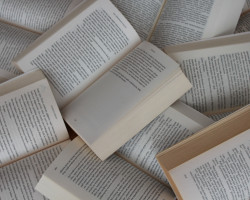
 Chair
Chair